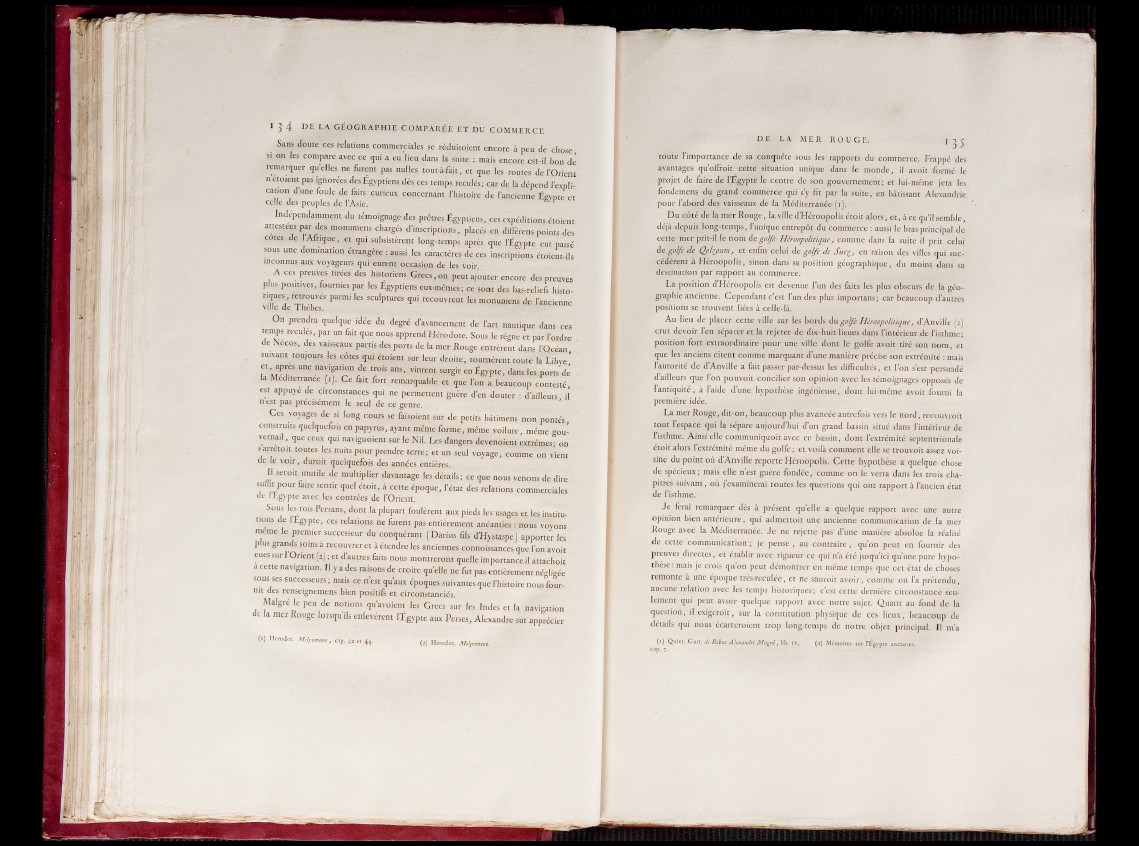
I | 4 D E L A g é o g r a p h i e c o m p a r é e e t d u c o m m e r c e
Sans doute ces relations commerciales se réduisoient encore à peu de chose
si on les compare avec ce qui a eu lieu dans Ja suite : mais encore est-il hon dé
remarquer quelles ne furent pas nulles tout-à-fkit, et que les routes de l’Orient
n etoient pas ignorées des Égyptiens dès ces temps reculés; car de là dépend l’explication
d’une foule de faits curieux concernant l’histoire de l’ancienne Egypte et
celle des peuples de TAsie.
Indépendamment du témoignage des prêtres Égyptiens, ces expéditions étoient
attestas par des monumens chargés d’inscriptions, placés en différais points des
cotes de- 1 Afrique, et qui subsistèrent long-temps après que l’Égypte eut passé
sous une domination étrangère : aussi les caractères de ces inscriptions étoient-ils
inconnus aux -voyageurs qui eurent occasion de les voir.
A ces preuves tirées des historiens Grecs,on peut ajouter encore des preuves
plus positives, fournies par les Egyptiens eux-mêmes; ce sont des bas-reliefs historiques
retrouvés parmi les sculptures qui recouvrent les monumens de l’ancienne
ville de TJiebes.
On prendra quelque idée du degré d’avancement de l’art nautique dans ces
temps recules, par un fkit que nous apprend Hérodote. Sous le règne et par l’ordre
de Necos, des vaisseaux partis des ports de la mer Rouge entrèrent dans l’Qcéan
suivant toujours les côtes qui étoient sur leur droite, tournèrent toute la Libye’
et après une navigation de trois ans, vinrent surgir en Égypte, dans les ports dé
la Mediterranee (i). Ce fait fort remarquable et que l’on a beaucoup contesté,
est appuyé de circonstances qui ne permettent guère d’en douter : d’ailleurs il
n est pas précisément le seul de ce genre.
Ce s voyages de si long cours se feisoient sur de petits bâtimens non pontés ■
construits quelquefois en papyrus, ayant même forme, même voilure, même gouvernail
, que ceux qui naviguaient sur le Nil. Les dangers devenoient extrêmes; on
sarretoit toutes les nuits pour prendre terre; et un seul voyage, comme on vient
de le vo ir, ciuroit quelquefois des années entières.
II seroit inutile de multiplier davantage les détails; ce que nous venons de dire '
suffit pour faire sentir quel étoit, à cette époque, l’état des relations commerciales
de 1 Egypte avec les contrées de l’Orient.
■ SOUf 1“ ro,sPersans> dont la plupart foulèrent aux pieds les usages et les. institutions
de 1 Egypte, ces relations ne frirent pas entièrement anéanties : nous voyons
meme le premier successeur du conquérant (Darius fils d’Hystaspe) apporter les
plus grands soins à recouvrer et à étendre les anciennes connoissances que l’on avoit
eues sur 1 Orient (a) ; et d’autres faits nous montreront quelle importance il attachoit
a cette navigation. Il y a des raisons de croire qu’elle ne fut pas entièrement négligée
sous ses successeurs; mais ce n’est qu’aux époques suivantes que l’histoire nous fournit
des renseignemens bien positifs et circonstanciés, i
Malgré le peu de notions qu’avoient les Grecs sur les Indes et la navigation
de la mer Rouge lorsqu’ils enlevèrent l’Égypte aux Perses, Alexandre sut apprécier
( i ) Herodot. Melpemene, cap. 42 et 44.
(-) Herodot. Alelpomene.
toute l’importance de sa conquête sous les rapports du commerce. Frappé des
avantages qu’offroit cette situation unique dans le monde, il avoit formé le
projet de faire de 1 Égypte le centre de son gouvernement; et lui-même jeta les
fondemens du grand commerce qui s’y fît par la suite, en bâtissant Alexandrie
pour l’abord des vaisseaux de la Méditerranée (i).
Du côté de la mer Rouge, la ville d’Héroopolis étoit alors, et, à ce qu’il semble,
déjà depuis long-temps, l’unique entrepôt du commerce : aussi le bras principal de
cette mer prit-il le nom de golfe Héroopolitique, comme dans la suite il prit celui
de golfe de Qolzoum, et enfin celui de golfe de Suez, en raison des villes qui succédèrent
a Heroopolis, sinon dans sa jrosition géographique, du moins dans sa
destination par rapport au commerce.
La position d Heroopolis est devenue l’un des faits les plus obscurs de la géographie
ancienne. Cependant c’est l’un des plus importans ; car beaucoup d’autres
positions se trouvent liées à celle-là.
Au lieu de placer cette ville sur les bords du golfe Héroopoiitique, d’Anville (2)
crut devoir len séparer et la rejeter de dix-huit lieues dans l’intérieur de l’isthme;
position fort extraordinaire pour une ville dont le golfe avoit tiré son nom, et
que les anciens citent comme marquant d’une manière précise son extrémité : mais
1 autorité de d’Anville a fait passer par-dessus les difficultés, et l’on s’est persuadé
d’ailleurs que l’on pouvoit concilier son opinion avec les témoignages opposés de
1 antiquité., à laide d’une hypothèse ingénieuse, dont lui-même avoit fourni la
première idée.
La mer Rouge, dit-on, beaucoup plus avancée autrefois vers le nord, recouvroit
tout 1 espace qui la sépare aujourd’hui d’un grand bassin situé dans l’intérieur de
1 isthme. Ainsi elle communiquoit avec ce bassin, dont l’extrémité septentrionale
etoit alors 1 extrémité même du golfe ; et voilà comment elle se trouvoit assez voisine
du point où d Anville reporte Héroopolis. Cette hypothèse a quelque chose
de spécieux ; mais elle n’est guère fondée, comme on le verra dans les trois chapitres
suivans, où j examinerai toutes les questions qui ont rapport à l’ancien état
de l’isthme.
Je ferai remarquer dès à présent qu’elle a quelque rapport avec une autre
opinion bien antérieure, qui admettoit une ancienne communication de la mer
Rouge avec la Méditerranée. Je ne rejette pas d’une manière absolue la réalité
de cette communication ; je pense , au contraire , qu’on peut en fournir des
preuves directes, et établir avec rigueur ce qui n’a été jusqu’ici qu’une pure hypothèse:
mais je crois quon peut démontrer en même temps que cet état de choses
remonte a une epoque tres-reculée, et ne sauroit avoir, comme on l’a prétendu,
aucune relation avec les temps historiques; c’est cette dernière circonstance seulement
qui peut avoir quelque rapport avec notre sujet. Quant au fond de la
question, il exigeroit, sur la constitution physique de ces lieux, beaucoup de
détails qui nous écarteroient trop long-temps de notre objet principal. Il m’a
(1) Quint. Curt. de Rtbus 4 lexmdri M a çn i, lib. IV, (2) Mémoires sur l’Égypte ancienne,
cap. 7.