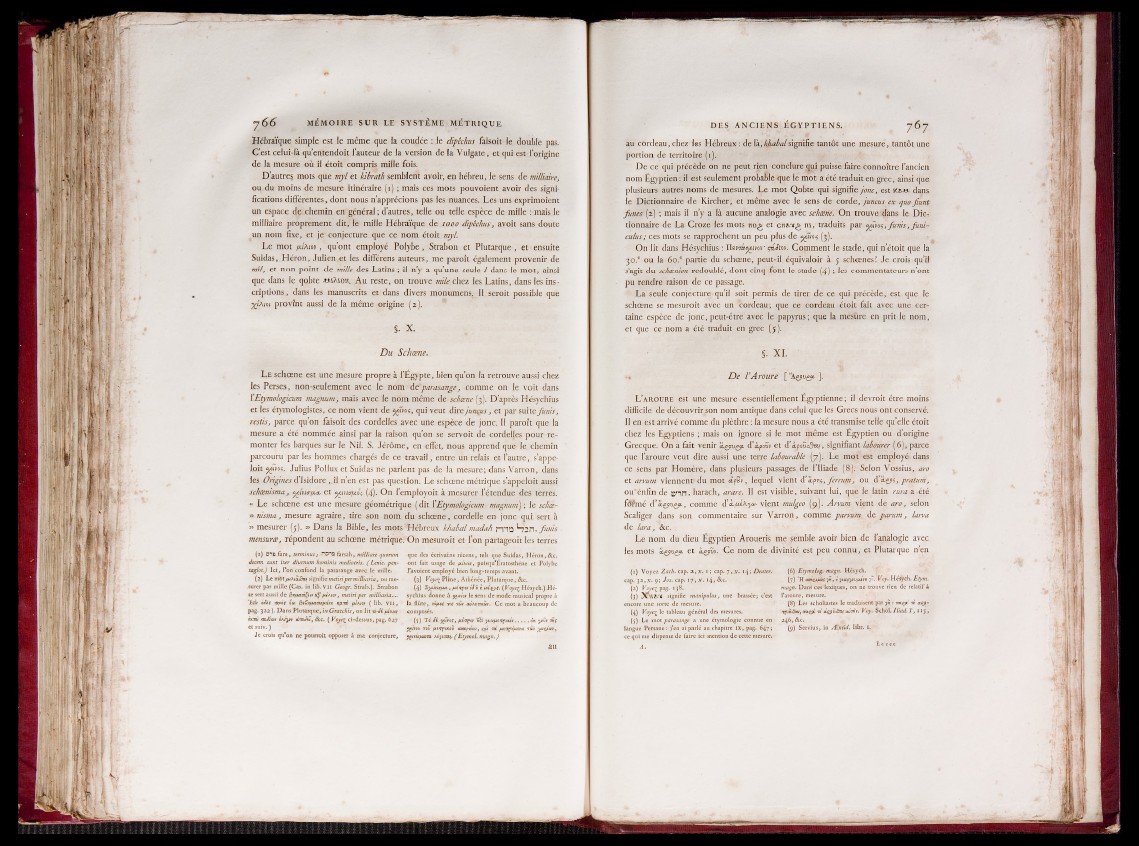
Hébraïque simple est le même que la coudée : Je dipêchus faisoit le double pas.
C ’est celui-là qu’entendoit l’auteur de la version de la Vulgate, et qui est l’origine
de la mesure où il étoit compris mille fois.
D'autre? mots que myl et kibrath semblent avoir, en hébreu, le sens de milliaire,
ou du moins de mesure itinéraire (i) ; mais ces mots pouvoient avoir des significations
différentes, dont nous n’apprécions pas les nuances. Les uns exprimoient
un espace de chemin en général ; d’autres, telle ou telle espèce de mille : mais le
milliaire proprement dit, le mille Hébraïque de iooo dipêchus, avoit sans doute
un nom fixe, et je conjecture que ce nom étoit myl.
L e mot j tu A io v , qu’ont employé Polybe , Strabon et Plutarque , et ensuite
Suidas, Héron, Julien,et les différens auteurs, me paroît également provenir de
mil, et non point de mille des Latins ; il n’y a qu’une seule l dans le mot, ainsi
que dans le qobte « s As cm. A u reste, on trouve mile chez les Latins, dans les in scriptions,
dans les manuscrits et dans divers monumens. Il seroit possible que
yç/Aioi provint aussi de la même origine (2).
§. X.
Du Schoene.
L e schoene est une mesure propre à l’Egypte, bien qu’on la retrouve aussi chez
les Perses, non-seulement avec le nom de"parasange, comme on le voit dans
1 Etymologicum magnum, mais avec le nom même de schoene (3). D ’après Hésychius
et les étymologistes, ce nom vient de %>Tm, qui veut dire juncus, et par suite fin is ,
restis, parce qu’on fàisoit des cordelles avec une espèce de jonc. Il paroît que la
mesure a été nommée ainsi par la raison qu’on se servoit de cordelles pour remonter
les barques sur le Nil. S. Jérôme, en effet, nous apprend que le chemin
parcouru par les hommes chargés de ce travail, entre un relais et l’autre, s’appe-
loit jjuoç. Julius Pollux et Suidas ne parlent pas de la mesure; dans Varron, dans
les Origines d’Isidore, il n’en est pas question. L e schoene métrique s’appeloit aussi
schoenisma, a^iti<r/A.a. et 04 (4). On l’employoit à mesurer l’étendue des terres.
« L e schoene est une mesure géométrique ( dit Y Etymologicum magnum) ; le schoe-
» nisma, mesure agraire, tire son nom,du schoene, cordelle en jonc qui sert à
y> mesurer (y). » Dans la Bible, les mots Hébreux khabal madah n o j'unis .
mensurce, répondent au schoene métrique. On mesurait et l’on partageoit les terres
(1) Oia fars, terminus; fa rsa h , million quorum que des écrivains récens, tels que Suidas, H é ro n ,& c . decem sunt iter diumum hominis mediocris. (Lexic. pen- ont fait usage de /xixtov, puisqu’Ératosthéne et Polybe taglot.) I c i , l’on confond la parasange avec le mille. l’avoient employé bien long*temps avant.
(2) Le motpuMÔLSitf signifie metiriperinilliaria, ou me- (3) Voyeç P lin e , Athénée, Plutarque, &c.
.surer par mille (Cas. in lib. v i l Geogr, Strab.). Strabon (4) p.i'rçov o'îTî n pùçyç. ( Voye^ Hésych.) Hése
sert aussi de (¡MpuL-jtÇar x j'pixior, metiri per milliaria.... sychius donne à pctviov le sens de mode musical propre à
Eçir ¿Jiç <aypoç ta (itCnfm.no//.tvn ngcid ¡uMor ( lib. V I I , la flûte, vôfioç nç 7ur cwmitikûiy. C e mot a beaucoup de
pag. 3 2 2 ). Dans Plutarque, in Gracchis, on lit li'Sè puxtor composés. 0x1a ittSlav oa/jpk armSii, & c . ( Voye^ ci-dessus, pag. 627 (5) To Si ygivoç, p.i'tçov ’éü ytafitTfnàv ¿k y>uy 7i f
et suiv. ) 4 o^ivou tou pvtçnwv cantptiou, xgi nt pATÇ'éy.tva. tuv ^eyav.y
Je crois qu on ne pourrait opposer a ma conjecture, ^iriepAïa. Aijvraj. (Etymohmagn.)
au
au cordeau, chez les Hébreux : de là, khabal signifie tantôt une mesure, tantôt une
portion de territoire (i).
D e ce qui précède on ne peut rien conclure qui puisse faire connoître l’ancien
nom Égyptien : il est seulement probable que le mot a été traduit en grec, ainsi que
plusieurs autres noms de mesures. L e mot Qobte qui signifie jonc, est k&ju. dans
le Dictionnaire de Kircher, et même avec le sens de corde, juncus ex quo Jiunt
funes (2) ; mais il n’y a là aucune analogie avec schoene. On trouve dans le D ic tionnaire
de La Croze les mots tto,g et cnz-t^ m, traduits par mImç , fu n is, fu ni-
cit/us; ces mots se rapprochent un peu plus de agîm (3).
On lit dans Hésychius : n£V7KG(0iN>r çaJiov. Comment le stade, qui n’étoit que la
30.“ ou la 6o.c partie du schoene, peut-il équivaloir à y schoenes! Je crois qu’il
s’agit du schoenion redoublé, dont cinq font le stade (4) ; les commentateurs n’ont
pu rendre raison de ce passage.
L a seule conjecture-qu’il soit permis de tirer de ce qui précède, est, que le
schoene se mesurait avec un cordeau; que ce cordeau étoit fait avec une certaine
espèce de jonc, peut-être avec le papyrus; que la mesüre en prit le nom,
et que ce nom a été traduit en grec (y).
§. XI.
•. De l’A roure [ ].
L ’a r o u r e est une mesure essentiellement Egyptienne ; il devrait être moins
difficile de découvrir son nom antique dans celui que les Grecs nous ont conservé.
Il en est arrivé comme du plèthre ; la mesure nous a été transmise telle qu’elle étoit
chez les Egyptiens ; mais on ignore si le mot même est Égyptien ou d’origine
Grecque. On a fait venir ‘¿.çjuçjl d’ipotb et d’ ifoïoSo/, signifiant labourer (6), parce
que l’aroure veut dire aussi une terre labourable (7). L e mot est employé, dans
ce sens par Homère, dans plusieurs passages de l’Iliade (8). Selon Vossius, àro
et armm viennent du mot ¿ ¡S i, lequel vient d’ â/m 5, fe r mm, ou d’ ig^i, pratum,
ou’ énfin de a n n . harach, arare. Il est visible, suivant lui, que le latin rura a été
fdfmé d’ agjugjt, comme d’à.,oéAy». vient mulgeo (9). Arvum vient de aro, selon
Scaliger dans son commentaire sur Varron, comme parvum de parum, larva
de lara, &c. .
L e nom du dieu Égyptien AroueriS me semble avoir bien de l’analogie avec
les mots et àg,û*. C e nom de divinité est peu connu, et Plutarque n’en
(1) V o y e z Zach. cap. 2 , jt. 1 ; cap. 7 , y . 14 ; Deuter.• (6) Etymolog. magn. Hésych. ■
cap. 32, jf. 9; Jos. cap. 1 7 , jf. 14 , &c, (7) 'H amej/Eot yiï, jî ^apyv/Ajirn Voy. Hé^ch. Etym.
(2) Voye% Pag- *38. magn. Dans cesiexiques, on ne trouve rien de relatif à
(3) signifie manipulus, une brassée; c’est l’aroure, mesure.
encore une sorte de mesure. (8) Les scholiastes le traduisent par yn : Tztçgt to agyj-
(4) Voye^ le tableau général des mesures. tçiScdttf, m&o tv agpSoSa/c«îtoV. Voy. Schol, Iliad, T, 1 1 5 ,
(5) Le mot parasange a une étymologie connue en 246, & c .
langue Persane: j’en ai parlé au chapitre IX, pag. 6 47; (9) Servius, in Æ n é id, Iibr. I.
ce qui me dispense de faire ici mention de cette mesure.
A. '