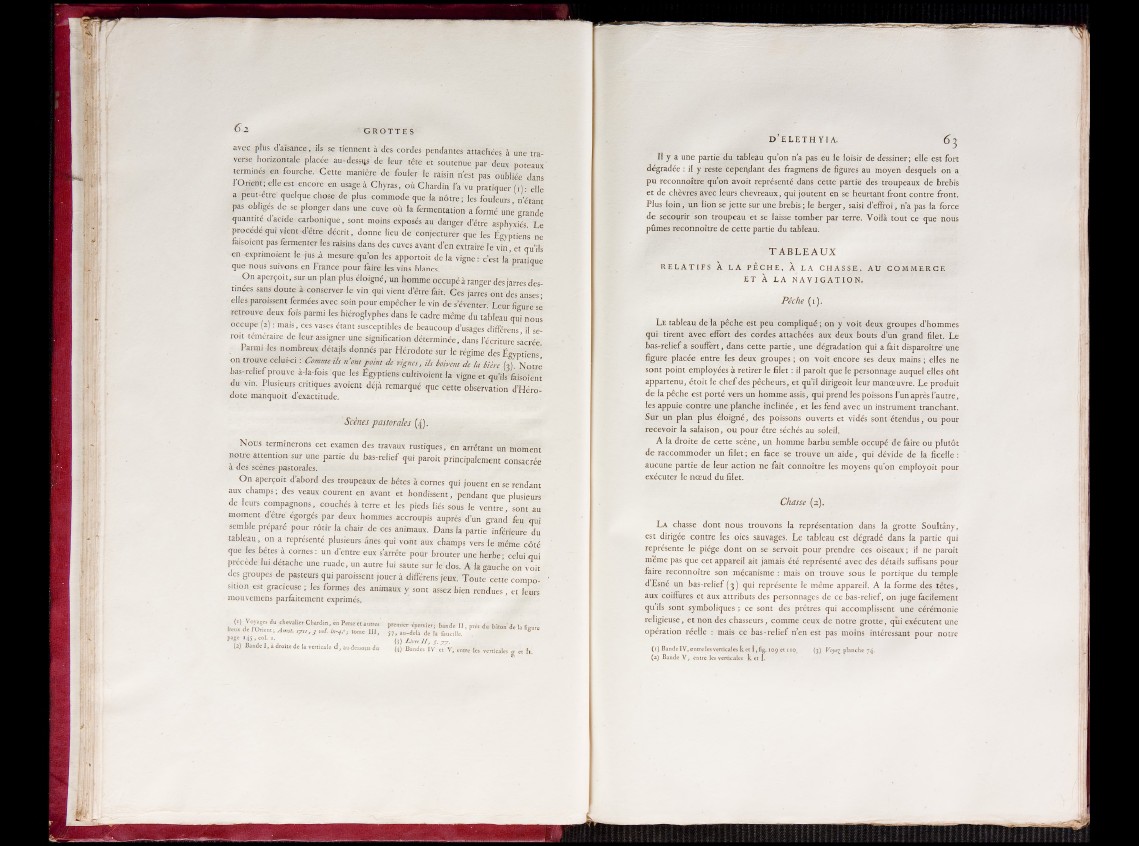
avec plus d’aisance, ils se tiennent à dés cordes pendantes attachées à une traverse
horizontale placée au-dessus de leur tête et soutenue par deux poteaux'
terminés en fourche. Cette manière de fouler le raisin n’est pas oubliée dans
l ’Orient; elle est encore en usage à Chyras, où Chardin l’a vu pratiquer (i) : elle
a peut-être’ quelque chose de plus commode que la nôtre; les fouleurs, n’étant
pas obligés de se plonger dans une cuve où la fermentation a formé une grande
■quantité d’acide carbonique, sont moins exposés au danger d’être asphyxiés. Le
procede qui vient d’être décrit, donne lieu de conjecturer que les Égyptiens ne
faisoient pas fermenter les raisins dans des cuves avant d’en extraire le vin, et qu’ils
en exprimoient le jus à mesure qu’on les apportoit de la vigne : c’est la pratique
que nous suivons en France pour faire les vins blancs. ~
On aperçoit, sur un plan plus éloigné, un homme occupé à ranger des jarres destinées
sans doute à-conserver le vin qui vient d’être fait. Ces jarres ont des anses;
elles paroissent fermées avec soin pour empêcher le vin de s’éventer. Leur figure sé
retrouve deux fois parmi les hiéroglyphes dans le cadre même du tableau qui nous
occupe (2) : mais, ces vases étant susceptibles de beaucoup d’usages différens, il se-
roit téméraire de leur assigner une signification déterminée, dans l’écriture sacrée.
Parmi -les nombreux détails donnés par Hérodote sur le régime des Égyptiens
on trouve celui-ci : Comme ils n ont point de vignes¡ ils boivent de la bière h ). Notre
bas-relief prouve à-la-fois que les Égyptiens cultivoient la vigne et qu’ils feisoient
du vin. Plusieurs critiques avoient déjà remarqué que cette observation d’Héro-
dote manquoit d’exactitude.
Scènes pastorales (4 ).
Nous terminerons cet examen des travaux rustiques, en arrêtant un moment
notre attention sur une partie du bas-relief qui paroît principalement consacrée
a des scènes pastorales.
On aperçoit d’abord des troupeaux de bêtes à cornes qui jouent en se rendant
aux champs; des veaux courent en avant et bondissent, pendant que plusieurs
de leurs compagnons, couchés à terre et les pieds liés sous le ventre, sont au
moment detre égorgés par deux hommes accroupis auprès d’un grand feu qui
semble préparé pour rôtir la chair de ces animaux. Dans la partie inférieure du
tableau, on a représenté plusieurs ânes qui vont aux champs vers le même coté
que les betes a cornes : un d’entre eux s’arrête pour brouter une herbe ; celui qui
précède lui détache une ruade, un autre lui saute sur le dos. A la gauche on voit
des groupes de pasteurs qui paroissent jouer à différens jeux. Toute cette compo- ’
sinon est gracieuse ; les formes des animaux y sont assez bien rendues , et leurs
mouvemens parfaitement exprimés.
É É Ë I S l d“ i ” 3“ " C h a id i" ’ Perse “ “ « • ’ i « » « « ‘épervier; bande I I , prés du bâton’ de la figure
de 1 ° n tm ; Ams!- I7" , 3 roi. tome I I I , au-delà de la faucille , S
page 14 5 , col. 1. | | | Livre I I
(a) Bande 1, à droite de la verticale d , au-dessous du (4) B a ld e , IV ' e f v , entre les verticales g e, f i.
Il y a une partie du tableau qu’on n’a pas eu le loisir de dessiner; elle est fort
dégradée : il y reste cependant des fragmens de figures au moyen desquels on a
pu reconnoître qu’on avoit représenté dans cette partie des troupeaux de brebis
et de chèvres avec leurs chevreaux, qui joutent en se heurtant front contre front.
Plus loin, un lion se jette sur une brebis ; le berger, saisi d’effroi, n’a pas la force
de secourir son troupeau et se laisse tomber par terre. Voilà tout ce que nous
pûmes reconnoître de cette partie du tableau.
TABLEAUX
R E L A T I F S À L A P Ê C H E , À L A C H A S S E , A U C O M M E R C E
E T À L A N A V I G A T I O N .
Pêche (1).
L e tableau de la pêche est peu compliqué ; on y voit deux groupes d’hommes
qui tirent avec effort des cordes attachées aux deux bouts d’un grand filet. Le
bas-relief a souffert, dans cette partie, une dégradation qui a frit disparoître' une
figure placée entre les deux groupes; on voit encore ses.deux mains; elles ne
sont point employées à retirer le filet ; il paroît que le personnage auquel elles ofit
appartenu, étoit le chef des pêcheurs, et qu’il dirigeoit leur manoeuvre. Le produit
de la pêche est porté vers un homme assis, qui prend les poissons l’un après l’autre,
les appuie contre une planche inclinée, et les fend avec un instrument tranchant.
Sur un plan plus éloigné, des poissons ouverts et vidés sont étendus, ou pour
recevoir la salaison, ou pour être séchés au soleil.
A la droite de cette scène, un homme barbu semble occupé de faire ou plutôt
de raccommoder un filet; en face se trouve un aide, qui dévide de la ficelle :
aucune partie de leur action ne fait connoître les moyens qu’on empioyoit pour
exécuter le noeud du filet.
Chasse (2).
L a chasse dont nous trouvons la représentation dans la grotte Soultâny,
est dirigée contre les oies sauvages. Le tableau est dégradé dans la partie qui
represente le piège dont on se servoit pour prendre ces oiseaux ; il ne paroît
meme pas que cet appareil ait jamais été représenté avec des détails suffisans pour
faire reconnoître son mécanisme : mais on trouve sous le portique du temple
dEsné un bas-relief (3) qui représente le même appareil. A la forme des têtes,
aux coiffures et aux attributs des personnages de ce bas-relief, on juge facilement
quils sont symboliques; ce sont des prêtres qui accomplissent une cérémonie
religieuse, et non des chasseurs, comme ceux de notre grotte, qui exécutent une
opération réelle : mais ce bas-relief n’en est pas moins intéressant pour notre
(1) Bande IV, entre les verticales k et I , fig. 109 et 110. (3) Voye^ planche 74.
(2) Bande V , entre les verticales k et 1.