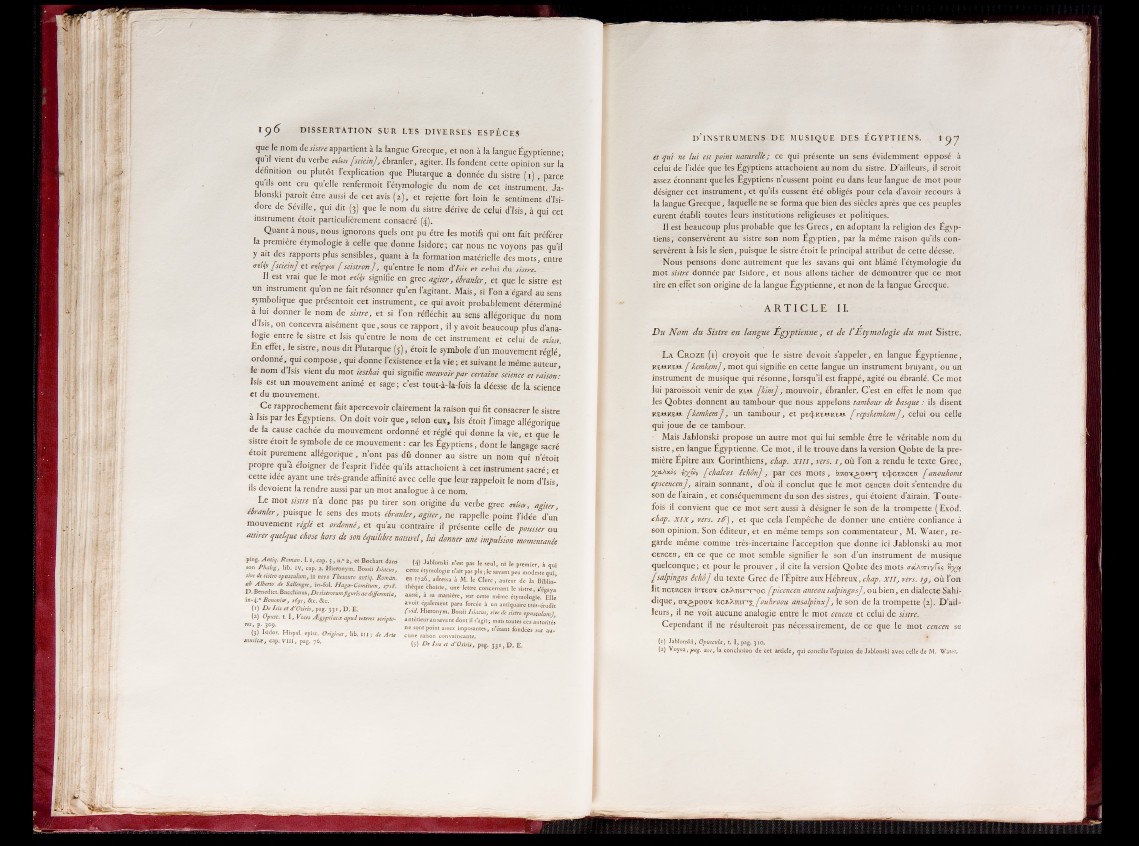
que le nom de sistre appartient à la langue Grecque, et non à la langue Égyptienne;
qu’il vient du verbe $ $ $ [seiein], ébranler, agiter. Ils fondent cette opinion sur la
définition ou plutôt l’explication que Plutarque a donnée du sistre (i) , parce
qu’ils ont cru quelle renfermoit i'étymologie du nom de cet instrument. Ja-
blonski paroît être aussi de cet avis (2), et rejette fort loin le sentiment d’Isidore
de Séville, qui dit (3) que le nom du sistre dérive de celui d’Isis, à qui cet
instrument étoit particulièrement consacré (4).
Quant à nous, nous ignorons quels ont pu être les motifs qui ont fait préférer
la première étymologie à celle que donne Isidore; car nous ne voyons pas qu’il
y ait des rapports plus sensibles, quant à la formation matérielle des mots, entre
vety [seiein] et Ê Ë 0 [ seistron], qu’entre le nom d'Isis et celui du sistre.
II est vrai que le mot «-¡# signifie en grec agiter, ébranler, et que le sistre est
un instrument qu’on ne fait résonner qu’en l’agitant. Mais, si l’on a égard au sens
symbolique que présentoir cet instrument, ce qui avoir probablement déterminé
a lui donner le nom de sistre, et si l’on réfléchit au sens allégorique du nom
d’Isis, on concevra aisément que,sous ce rapport, il y avoir beaucoup plus d’analogie
entre le sistre et Isis qu’entre le nom de cet instrument et celui de nka .
En effet , le sistre, nous dit Plutarque (y), étoit le symbole d’un mouvement réglé,
ordonné, qui compose, qui donne l’existence et la vie; et suivant le même auteur*
le nom dlsis vient du mot iesthai qui signifie mouvoir par certaine science et raison:
Isis est un mouvement animé et sage; c’est tout-à-Ia-fois la déesse de la science
et du mouvement.
C e rapprochement fait apercevoir clairement la raison qui fit consacrer le sistre
à Isis par les Égyptiens. On doit voir que, selon eux, Isis étoit l’image allégorique
de la cause cachée du mouvement ordonné et réglé qui donne la vie, et que le
sistre étoit le symbole de ce mouvement : car les Égyptiens, dont le langage sacré
étoit purement allégorique, n’ont pas dû donner au sistre un nom qui n’étoit
propre quà éloigner de l’esprit l’idée qu'ils attachoient à cet instrument sacré; et
cette idée ayant une très-grande affinité avec celle que leur rappeloit le nom d’Isis,
ils devoient la rendre aussi par un mot analogue à ce nom.
Le mot sistre na donc pas pu tirer son origine du verbe grec É B fe agiter,
ébranler, puisque le sens des mots ébranler, agiter, ne rappelle point l’idée d’un
mouvement réglé et ordonné, et qu’au contraire il présente celle de pousser ou
attirer quelque chose hors de son équilibre naturel, lui donner une impulsion momentanée
ping. Antîq. Roman. 1. 1 , cap. 5 , n.° 2 , et Bochart dans
son Phaleg, Iib. i v , cap. 2. Hieronym. Bossii lsiacus,
sive de sistro opusculum, in novo Thesauro antiq. Roman,
ab Alberto de Sallengre, in-fol. Hagce-Comîtum, ryi8.
D . Benedict. Bacchinus, Desistrorumjîguris ac dijferentia
in-4.0 Bononioe, tdpi, & c . & c .
(1) D e Isis et d Osiris, pag. 3 3 1 , D . E.
(2) Opnsc. t. I , Voces Ægyptiacoe apud veteres scripto-
res , p. 300.
(3) Isidor. Hispal. episc. Origines, Iib. n i ; de A rte
musical, cap. v i n , pag. 76.
( 4) Jablonski n’est pas le seul, ni le premier, à qui
cette étymologie n’ait pas plu ; le savant peu modeste qui,
en 1726, adressa à M. le C le r c , auteur de la Bibliothèque
choisie, une lettre concernant le sistre, s’égaya
aussi, à sa manière, sur cette même étymologie. Elle
avoit également paru forcée à un antiquaire très-érudit
(vid. Hieronym. Bossii lsiacus, sive de sistro opusculum) ,
antérieur au savant dont il s’agit; mais toutes ces autorités
ne sont point assez imposantes, n’étant fondées sur aucune
raison convaincante.
( 5) D * M * t t d ’ Osiris, pag. 331, D . E.
et qui ne lui est point naturelle ; ce qui présente un sens évidemment opp osé à
celui de l’idée que les Égyptiens atta cho ient au nom du sistre. D ’ailleurs, il seroit
assez étonnant que les Égyptiens n’eussent p o in t eu dans leur langue de m o t pour
désigner ce t instrument, e t qu’ils eussent été obligés pour cela d’a vo ir recours à
la langue G r e c q u e , laquelle ne se forma que bien des siècles après que ces peuples
eurent établi toutes leurs institutions religieuses e t politiques.
II est beaucoup plus probable que les G r e c s , en adoptant la religion des Égyptiens
, conservèrent au sistre son n om É g y p tie n , par la même raison qu’ils c o n servèrent
à Isis le sien, puisque le sistre é to it le principal attribut de c e tte déesse.
N ou s pensons d on c autrement que les savans qui o n t blâmé l’é tymo lo g ie du
m o t sistre donnée par Isid o re , e t nous allons tâcher d e d émon trer que ce m o t
tire en effet son origine de la langue Ég yp tien ne , e t n on de la langue G recq u e .
A R T I C L E II.
Du Nom du Sistre en langue Egyptienne, et de 1‘Etymologie du mot Sistre.
L a C r o z e (i) c ro y o it que le sistre d ev o it s’a p p e le r , en langue É g yp tien n e ,
keju-keu. [lemkem], m o t qui signifie en cette langue un instrument bruyant, ou un
instrument de musique qui ré sonn e , lorsqu’il est frapp é, agité ou ébranlé. C e m o t
lui paroissoit venir de k i u [kimj, m o u v o ir , ébranler. C ’est e n effet le n om que
les Q o b te s donnent au tambour que nous appelons tambour de basque : ils disent
k e m - K e « . [lemkem] , un tam b o u r , e t p e 4 > k e « - k e « . [repskemkem], celui ou celle
qui jou e de ce tambour.
Mais Jablon ski propose un autre m o t qui lui semble être le véritable nom du
sistre, en langue Égyptienne. C e m o t , il le tro u v e dans la version Q o b t e de la première
Épître aux C o r in th ien s , chap. x m , vers, r, o ù l’on a rendu le texte G r e c ,
%üâjtbf -hx“ * [chalcos êchon], par ces m o t s , ««osf^oury EtfCEitCEit [anouhomt
epscencen], airain sonnant, d’o ù il con c lu t que le m o t c e h c e h d o it s’entendre du
son de l’airain, e t conséquemment du son des sistres, qui é to ien t d’airain. T o u t e fois
il con vien t que ce m o t sert aussi à désigner le son de la trompe tte (E xô d .
chap. x i x , vers, id ) , et que ce la l’empêche de donner une entière confiance à
son opinion. S on éditeu r, e t en même temps son com m en tateu r , M . W a te r , re garde
même comme très-incertaine l’a c c ep tion que donne ici Jab lon ski au m o t
CEHCEtt, en ce que ce m o t semble signifier le son d ’un instrument de musique
qu elconqu e ; et p ou r le p r o u v e r , il c ite la version Q o b t e des mots o-<tA7nyJôs ¡j^ a
[salpingos écho] du texte G r e c de l’Épître aux H éb reu x , chap. x i i , vers, iy, o ù l’on
lit ncEncEsv i t t e o 'î cz-À ns r'r'oc [picencen anteou salpingosl, ou b ien , en dialecte Sahi-
d iqu e , o t^ p o o f KCAPour'j[ ouhroou ansalpinx], le son de la trom pe tte (2). D ’ailleurs
, il ne v o it aucune analogie entre le m o t cencen e t celui de sistre.
Cep en d ant il ne résulteroit pas nécessairement, de ce que le m o t cencen se
(1) Jablonski, Op usai la , 1 . 1, pag. 310.
(2) V o y e z ,pag. ¡tôt, la conclusion de cet article, qui concilie l’opinion de Jablonski avec celle de M. Water.