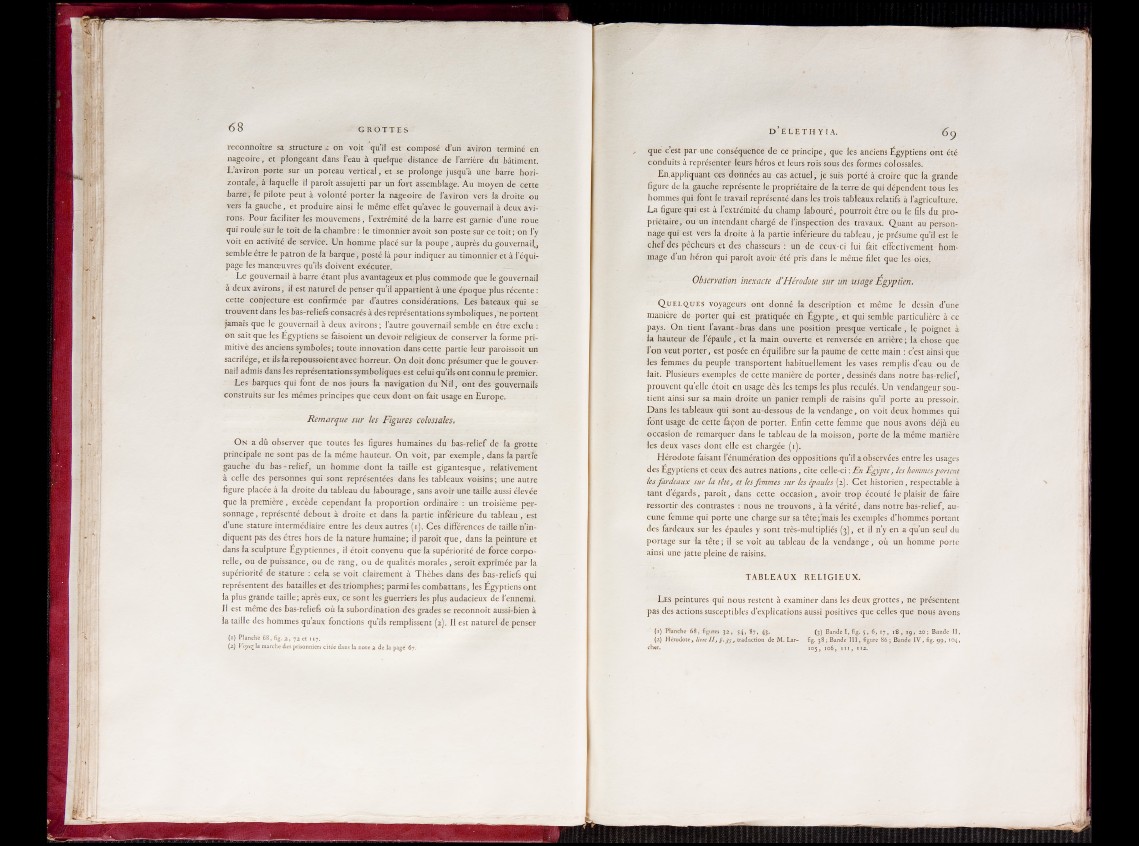
6 8 G R O T T E S
reconnoître sa structure ; on voit qu’il est composé d’un aviron terminé en
nageoire, et plongeant dans l’eau à quelque distance de l’arrière du bâtiment.
Laviron porte sur un poteau vertical, et se prolonge jusqua une barre horizontale,
à laquelle il paraît assujetti par un fort assemblage. Au moyen de cette
barre, le pilote peut à volonté porter la nageoire de l’aviron vers la droite ou
vers la gauche, et produire ainsi le même effet qu’avec le gouvernail à deux avirons.
Pour faciliter les mouvemens, l’extrémité de la barre est garnie d’une roue
qui roule sur le toit de la chambre : le timonnier avoit son poste sur ce toit; on l’y
voit en activité de service. Un homme placé sur la poupe, auprès du gouvernail.,
semble etre le patron de la barque, posté là pour indiquer au timonnier et à l’équipage
les manoeuvres qu’ils doivent exécuter.
Le gouvernail à barre étant plus avantageux et plus commode que le gouvernail
à deux avirons, il est naturel de penser qu’il appartient à une époque plus récente :
cette conjecture est confirmée par d’autres considérations. Les bateaux qui se
trouvent dans les bas reliefs consacrés à des représentations symboliques, ne portent
jamais que le gouvernail à deux avirons ; l’autre gouvernail semble en être exclu :
on sait que les Egyptiens se fkisoient un devoir religieux de conserver la forme primitive
des anciens symboles; toute innovation dans cette partie leur paroissoit un
sacrilege, et ils la repoussoient avec horreur. On doit donc présumer que le gouvernail
admis dans les représentations symboliques est celui qu’ils ont connu le premier.
Les barques qui font de nos jours la navigation du N il, ont des gouvernails
construits sur les mêmes principes que ceux dont on fait usage en Europe.
Remarque sur les Figures colossales.
O n a dû observer que toutes les figures humaines du bas-relief de la grotte
principale ne sont pas de la même hauteur. On voit, par exemple, dans la partie
gauche du bas-relief, un homme dont la taille est gigantesque, relativement
à celle des personnes qui sont représentées dans les tableaux voisins ; une autre
figure placée à la droite du tableau du labourage, sans avoir une taille aussi élevée
que la première, excède cependant la proportion ordinaire : un troisième personnage
, représenté debout à droite et dans la partie inférieure du tableau , est
d’une stature intermédiaire entre les deux autres (i). Ces différences de taille n’indiquent
pas des êtres hors de la nature humaine; il paraît que, dans la peinture et
dans la sculpture Égyptiennes, il étoit convenu que la supériorité de force corporelle,
ou de puissance, ou de rang, ou de qualités morales, serait exprimée par la
supériorité de stature : cela se voit clairement à Thèbes dans des bas-reliefs qui
représentent des batailles et des triomphes; parmi les combattans, les Égyptiens ont
la plus grande taille; après eux, ce sont les guerriers les plus audacieux de l’ennemi.
II est meme des bas-reliefs où la subordination des grades se reconnoît aussi-bien à
la taille des hommes qu’aux fonctions qu’ils remplissent (2). II est naturel de penser
(1) Planche 68, fig. 2, 72 et 117.
(2) Vvyei la marche des prisonniers citée dans la note 2 de la page 67.
d ’ e l e t h y i a . 6 9
que c’est par une conséquence de ce principe, que les anciens Égyptiens ont été
conduits à représenter leurs héros et leurs rois sous des formes colossales.
En.appliquant ces données au cas actuel, je suis porté à croire que la grande
figure de la gauche représente le propriétaire de la terre de qui dépendent tous les
hommes qui font le travail représenté dans les trois tableaux relatifs à l’agriculture.
La figure qui est à l’extrémité du champ labouré, pourroit être ou le fils du propriétaire,
ou un intendant chargé de l’inspection des travaux. Quant au personnage
qui est vers la droite à la partie inférieure du tableau, je présume qu’il est le
chef des pêcheurs et des chasseurs : un de ceux-ci lui fait effectivement hommage
d un héron qui paroît avoir été pris dans le même filet que les oies.
Observation inexacte d’Hérodote sur un usage Egyptien.
Q u e l q u e s voyageurs ont donné la description et même le dessin d’une
manière de porter qui est pratiquée en Égypte, et qui semble particulière à ce
pays. On tient l’avant-bras dans une position presque verticale , le poignet à
la hauteur de l’épaule, et la main ouverte et renversée en arrière ; la chose que
l’on veut porter, est posée en équilibre sur la paume de cette main : c’est ainsi que
les femmes du peuple transportent habituellement les vases remplis d’eau ou de
lait. Plusieurs exemples de cette manière de porter, dessinés dans notre bas-relief,
prouvent qu’elle étoit en usage dès les temps les plus reculés. Un vendangeur soutient
ainsi sur sa main droite un panier rempli de raisins qu’il porte au pressoir.
Dans les tableaux qui sont au-dessous de la vendange, on voit deux hommes qui
font usage de cette façon de porter. Enfin cette femme que nous avons déjà eu
occasion de remarquer dans le tableau de la moisson, porte de la même manière
les deux vases dont elle est chargée (i).
Hérodote faisant l’énumération des oppositions qu’il a observées entre les usages
des Égyptiens et ceux des autres nations, cite celle-ci : En Egypte, les hommes portent
les fardeaux sur la tète, et les femmes sur les épaules (2). Cet historien, respectable à
tant d’égards, paroît, dans cette occasion, avoir trop écouté le plaisir de faire
ressortir des contrastes : nous ne trouvons, à la vérité, dans notre bas-relief, aucune
femme qui porte une charge sur sa tête;'mais les exemples d’hommes portant
des fardeaux sur les épaules y sont très-multipliés (3), et il n’y en a qu’un seul du
portage sur la tête ; il se voit au tableau de la vendange, où un homme porte
ainsi une jatte pleine de raisins.
T A B L E A U X R E L I G I E U X .
Les peintures qui nous restent à examiner dans les deux grottes, ne présentent
pas des actions susceptibles d’explications aussi positives que celles que nous avons
(1) Planche 68, figures 3 2 , 54, 87, 43* (3) Bande I , fig. 5 , 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 ; Bande I I ,
(2) Hérodote, livre I I , f . j f , traduction de M . Lar- fig. 38 ; Bande I I I , figure 86 j Bande I V , fig. 9 9 , 104,
cher. 105, 106, m , 112.