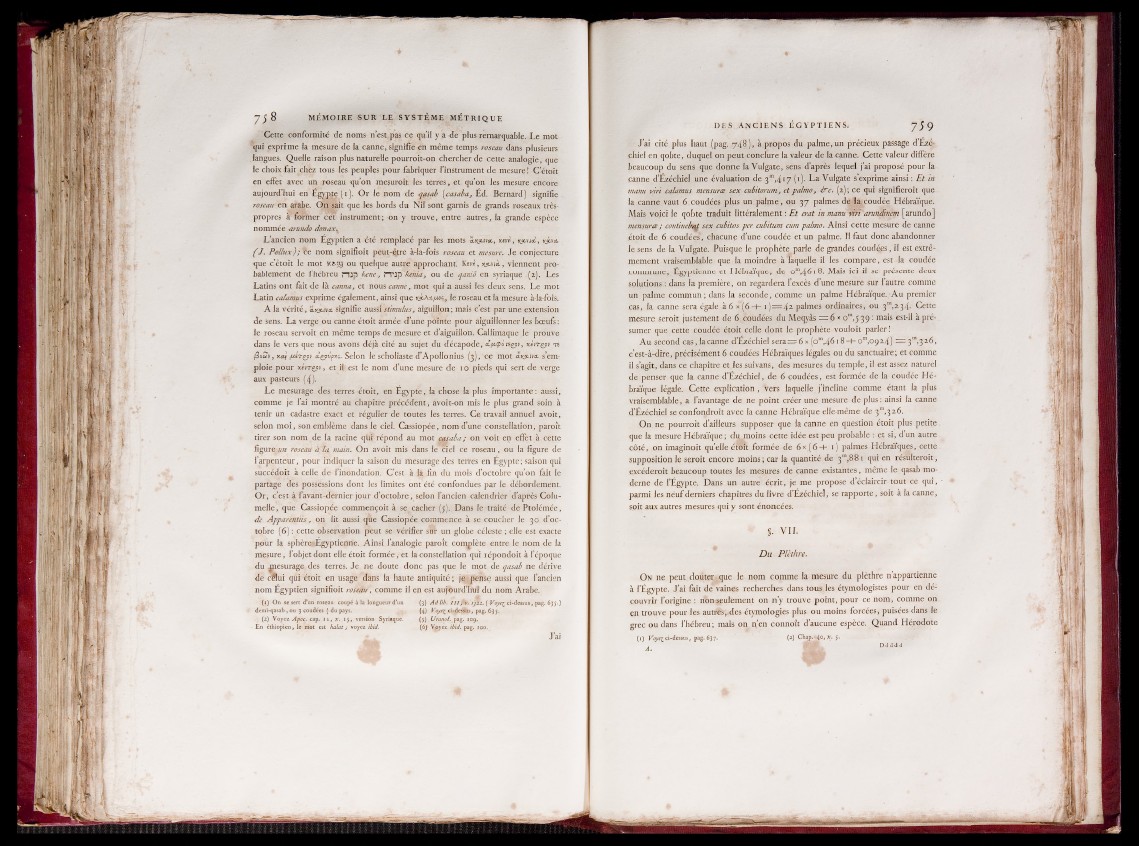
Cette conformité de noms n’est pas ce qu’il y a de plus remarquable. Le mot
qui exprime la mesure de la canne, signifie en même temps roseau dans plusieurs
langues. Quelle raison plus naturelle pourroit-on chercher de cette analogie, que
le choix fait chez tous les peuples pour fabriquer l’instrument de mesure ! C’étoit
en effet avec un roseau qu’on mesurait les terres, et qu’on les mesure encore
aujourdhui en Egypte (i). Or le nom de qasab (casaba, Ed. Bernard) signifie
roseau en arabe. On sait que les bords du Nil sont garnis de grands roseaux très-
propres à former cet instrument; on y trouve, entre autres, la grande espèce
nommée arundo donax4
L ’ancien nom Egyptien a été remplacé par les mots !Louv«., xstvia, xsb*
( J . P e llu x ); ce nom signifioit peut-qtrc à-la-fois roseau et mesure. Je conjecture
que c’ètoit le mot Kz-tg ou quelque autre approchant; Ksn!, xstvià., viennent probablement
de l’hébreu n 3p h u e , m p ken'm, ou de qaniô en syriaque (2). Les
Latins ont fait de là canna, et nous canne, mot qui a aussi les deux sens. Le mot
Latin calamus exprime également, ainsi que xsLàAjUîç , le roseau et la mesure à-la-fois.
A la vérité, axsuva- signifie aussi stimulus, aiguillon ; mais c’est par une extension
de sens. La verge ou canne étoit armée d’une pointe pour aiguillonner les boeufs :
le roseau servoit en même temps de mesure et d’aiguillon. Callimaque le prouve
dans le vers que nous avons déjà cité au sujet du décapode, à/r^o'rtgjv, xirrgjv it
/3o«y, xaj /uÀTçyt ¿çytlpiK. Selon le scholiaste d’Apollonius (3),'ce mot èinjuna. s’emploie
pour xevrgjy, et il est le nom d’une mesure de 1 o pieds qui sert de verge
aux pasteurs (4).
Le mesurage des terres étoit, en Egypte, la chose la plus importante: aussi,
comme je l’ai montré au chapitre précédent, avoit-on mis le plus grand soin à
tenir un cadastre exact et régulier de toutes les terres. Ce travail annuel avoit,
selon moi, son emblème dans le ciel. Cassiopée, nom d’une constellation, paroît
tirer son nom de la racine qui répond au mot casaba ; on voit en effet à cette
figure un roseau à la main. On avoit mis dans le ciel ce roseau, ou la figure de
l’arpenteur, pour indiquer la saison du mesurage des terres en Egypte; saison qui
succédoit à celle de l’inondation. C’est à la fin du mois d’octobre qu’on fait le
partage des possessions dont les limites ont été confondues par le débordement.
Or, c’est à l’avant-dernier jour d’octobre, selon l’ancien calendrier d’après Colu-
melle, que Cassiopée commençoit à se cacher (y). Dans le traité dePtolémée,
de Apparentiis, on lit aussi que Cassiopée commence à se coucher le 30 d’octobre
(6) : cette observation peut se vérifier sur un globe céleste ; elle est exacte
pour la sphèreaEgyptienne. Ainsi l’analogie paroît complète entre le nom de la
mesure, l’objet dont elle étoit formée, et la constellation qui tépondoit à l’époque
du mesurage des terres. Je ne doute donc pas que le mot de qasab ne dérive
de celui qui étoit en usage dans la haute antiquité; j^pense aussi que l’ancien
nom Egyptien signifioit roseau, comme il en est aujourd’hui du nom Arabe.
( j) On se sert d’un roseau- coupé à la longueur d’un (3) A d lib . m , v. 1J22, ( Voyeç ci-dessus, pag. 635.)
demi-qasab, ou 3 coudées | du pays. | (4) Voye^ ci-dessus, pag. 635.
(2) Voyez Apoc. cap. 1 1 , jf. 15., version Syriaque. (5) (Jranol._pag. 100.
En éthiopien, le mot est halat ; voyez ibid. (6) Voyez ibid. pag. 100,
J ai
J’ai cite plus haut ,(pag. 748), à propos du palme, un précieux passage d’Êzé-
chiel en qobte, duquel on peut conclure la valeur de la canne. Cette valeur diffère
beaucoup du sens que donne la Vulgate, sens d’après lequel j’ai proposé pour la
canne d’Ézéchiel une évaluation de 3m,417 (0- Vulgate s’exprime ainsi : E t itt
manu viri calamus mensuroe sex cubitorum, et palmo, fr et (2); ce qui signifieroit que
la canne vaut 6.coudées plus un,palme, ou 37 palmes de la,coudée Hébraïque.
Mais voici le qobte traduit littéralement ; E t erat in manu viri’ arundincm [arundo]
mensuroe ; continebrU sex cubitos per cubitum cum palmo. Ainsi cette mesure de canne
.étoit de 6 coudées', chacune d’une coudée et un palme. Il faut donc abandonner
le sens de la Vulgate. Puisque le prophète parle de grandes coudées, il est extrêmement
vraisemblable que la moindre à laquelle il les compare, est la coudée
.commune, Égyptienne et Hébraïque, de om,46i 8. Mais ici il se présente deux
solutions : dans la première, on regardera l’excès d’une mesure sur l’autre comme
un palme commun ; dans la seconde, comme un palme Hébraïque. Au premier
cas, la canne sera égale à 6 x (6 H- 1 ) — 4* palmes ordinaires, ou 3m,234- Cette
mesure serait justement de 6 coudées du Meqyâs — 6 * om,y 39 : mais est-il à présumer
que cette coudée étoit celle dont le prophète vouloit parler !
Au second cas, la canne d’Ézéchiel sera = 6 x (om,4618-+- o”, 09 24) = 3m,326,
c’est-à-dire, précisément 6 coudées Hébraïques légales ou du sanctuaire; et comme
il s’agit, dans ce chapitre et les suivans, des mesures du temple, il est assez naturel
de penser que la canne d’Ézéchiel, de 6 coudées, est formée de la coudée Hébraïque
légale. Cette explication , Vers laquelle j’incline comme étant la plus
vraisemblable, a l’avantage de ne point créer une mesure déplus: ainsi la canne
d’Ézéchiel se confondrait avec la canne Hébraïque elle-même de 3m,326.
On ne pourrait d’ailleurs supposer que la canne en question étoit plus petite,
que la mesure Hébraïque ; dumoins cette idée est peu probable : et si, d un autre
côté, on imaginoit qu’elle étôit formée de 6* (6-t- 1) palmes Hébraïques, cette
supposition le seroit encore moins; car la quantité de 3m,88i qui en résulterait,
excéderait beaucoup toutes les mesures de canne existantes, même le qasab moderne
de l’Egypte. Dans un autre écrit, je me propose d’éclaircir tout ce qui,
parmi les neuf derniers chapitres du livre d’Ézéchiel, se rapporte, soit a la canne,
soit aux autres mesures qui y sont énoncées.
§. VII.
D u Plèthre.
On ne peut douter- que le nom comme la mesure du plèthre n appartienne
à l’Egypte. J’ai fait de vaines recherches dans tous, les étymologistes pour en découvrir
l’origine : non-s.eulement on n’y trouve point, pour ce nom, comme on
en trouve pour les autres, des étymologies plus ou moins forcées, puisées dans le
grec ou dans l’hébreu ; mais on n’en connoît d’aucune espèce. Quand Hérodote
(1) Voyez ci-dessus, pag. 637. (2) C hap.jnjo , Jt> 5*
â l É É L D cl cl cl ci
A .