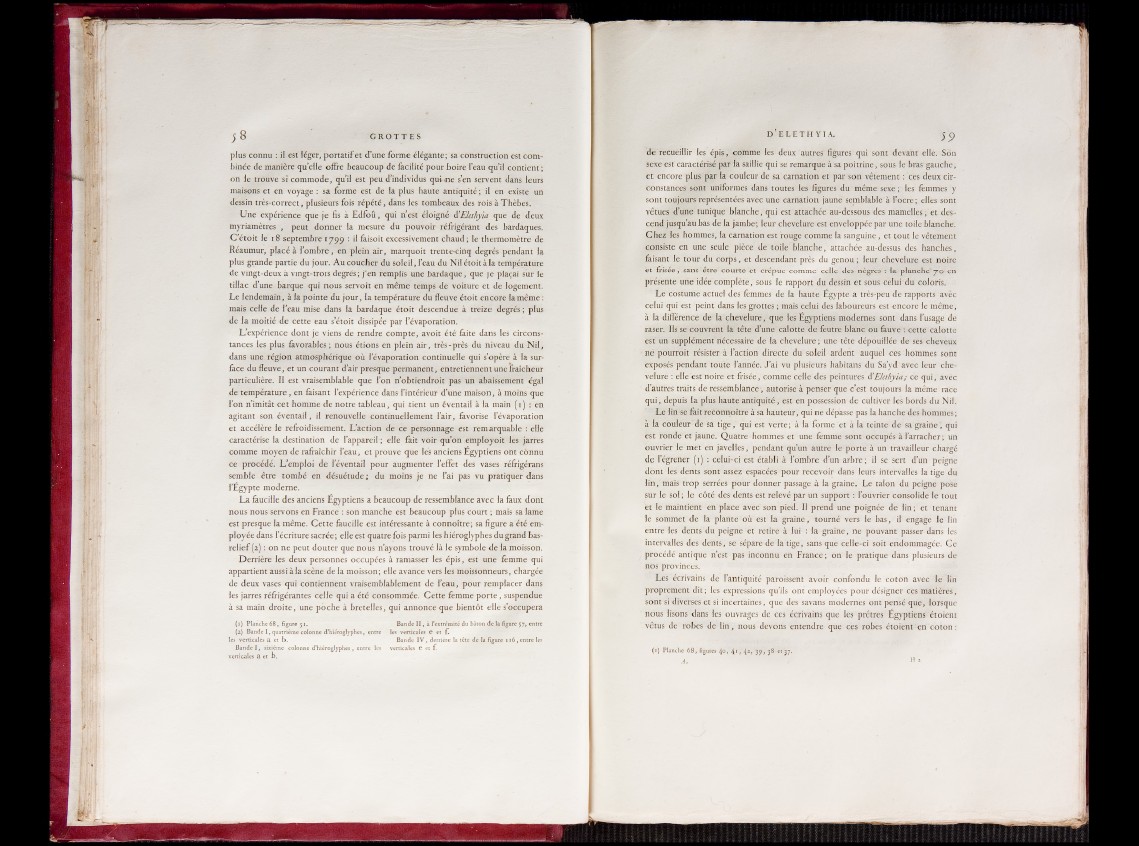
plus connu : il est léger, portatif et d’une forme élégante; sa construction est combinée
de manière qu elle offre beaucoup de facilité pour boire l’eau qu’il contient ;
on le trouve si commode, qu’il est peu d’individus qui .ne s’en servent dans leurs
maisons et en voyage : sa forme est de la plus haute antiquité ; il en existe un
dessin très-correct, plusieurs fois répété, dans les tombeaux des rois à Thèbes.
Une expérience que je fis à Edfoû, qui n’est éloigné d’E/et/yia que de deux
myriamètres , peut donner la mesure du pouvoir réfrigérant des bardaques.
C ’étoit le 18 septembre 1799 : il faisoit excessivement chaud ; le thermomètre de
Réaumur, placé à l’ombre, en plein air, marquoit trente-cinq degrés pendant la
plus grande partie du jour. Au coucher du soleil, l’eau du Nil étoit àla température
de vingt-deux à vingt-trois degrés; j’en remplis une bardaque, que je plaçai sur le
tillac d’une barque qui nous servoit en même temps de voiture et de logement.
Le lendemain, à la pointe du jour, la température du fleuve étoit encore la même :
mais celle de l’eau mise dans la bardaque étoit descendue à treize degrés ; plus
de la moitié de cette eau s’étoit dissipée par l’évaporation.
L expérience dont je viens de rendre compte, avoit été faite dans les circonstances
les plus favorables; nous étions en plein air, très-près du niveau du Nil,
dans une. région atmosphérique où l’évaporation continuelle qui s’opère à la surface
du fleuve, et un courant d’air presque permanent, entretiennent une fraîcheur
particulière. Il est vraisemblable que l’on n’obtiendroit pas un abaissement égal
de température, en faisant l’expérience dans l’intérieur d’une maison, à moins que
l’on n’imitât cet homme de notre tableau, qui tient un éventail à la main ( 1 ) : en
agitant son éventail, il renouvelle continuellement l’air, favorise l’évaporation
et accélère le refroidissement. L ’action de ce personnage est remarquable : elle
caractérise la destination de l’appareil ; elle fait voir qu’on employoit les jarres
comme moyen de rafraîchir l’eau, et prouve que les anciens Egyptiens ont connu
ce procédé. L ’emploi de l’éventail pour augmenter l’effet des vases réfrigérans
semble être tombé en désuétude; du moins je ne l’ai pas vu pratiquer dans
l’Egypte moderne.
La faucille des anciens Égyptiens a beaucoup de ressemblance avec la feux dont
nous nous servons en France : son manche est beaucoup plus court ; mais sa lame
est presque la même. Cette feucille est intéressante à connoître; sa figure a été employée
dans l’écriture sacrée ; elle est quatre fois parmi les hiéroglyphes du grand bas-
relief (2) : on ne peut douter que nous n’ayons trouvé là le symbole de la moisson.
Derrière les deux personnes occupées à ramasser les épis, est une femme qui
appartient aussi à la scène de la moisson; elle avance vers les moissonneurs, chargée
de deux vases qui contiennent vraisemblablement de l’eau, pour remplacer dans
les jarres réfrigérantes celle qui a été consommée. Cette femme porte, suspendue
à sa main droite, une poche à bretelles, qui annonce que bientôt elle s’occupera
(1) Planche 68, figure 51. Bande I I , à l’extrémité du bâton de la figure 57, entre
(2) Bande I , quatrième colonne d’hiéroglyphes, entre les verticales 6 et f.
les verticales a et h . Bande I V , derrière la tête de la figure 1 1 6 , entre les
Bande I , sixième colonne d’h iéroglyphes, entre les verticales e et I.
verticales a et b.
de recueillir les épis, comme les deux autres figures qui sont devant elle. Son
sexe est caractérisé par la saillie qui se remarque à sa poitrine, sous le bras gauche,
et encore plus par la couleur de sa carnation et par son vêtement : ces deux circonstances
sont uniformes dans toutes les figures du même sexe ; les femmes y
sont toujours représentées avec une carnation jaune semblable à l’ocre ; elles sont
vêtues d’une tunique blanche, qui est attachée au-dessous des mamelles; et descend
jusqu’au bas de la jambe; leur chevelure est enveloppée par une toile blanche.
Chez les hommes, la carnation est rouge comme la sanguine, et tout le vêtement
consiste en une seule pièce de toile blanche, attachée au-dessus des hanches,
faisant le tour du corps, et descendant près du genou ; leur chevelure est noire
et frisée, sans être courte et crépue comme celle des nègres : la planche' 70 en
présente une idée complète, sous le rapport du dessin et sous celui du coloris.
Le costume actuel des femmes de la haute Egypte a très-peu de rapports avec
celui qui est peint dans les grottes ; mais celui des laboureurs est encore le même,
à la différence de la chevelure, que les Égyptiens modernes sont dans l’usage de
raser. Us se couvrent la tête d’une calotte de feutre blanc ou feuve : cette calotte
est un supplément nécessaire de la chevelure ; une tête dépouillée de ses cheveux
né pourroit résister à l’action directe du soleil ardent auquel ces hommes sont
exposés pendant toute l’année. J’ai vu plusieurs habitans du Sa’yd avec leur chevelure
: elle est noire et frisée, comme celle des peintures A’Elahyia; ce qui, avec
d’autres traits de ressemblance; autorise à penser que c’est toujours la même race
qui, depuis la plus haute antiquité, est en possession de cultiver les bords du Nil.
Le lin se feit reconnoître à sa hauteur, qui ne dépasse pas la hanche des hommes;
à la couleur de sa tige, qui est verte; à la forme et à la teinte de sa graine', qui
est ronde et jaune. Quatre hommes et une femme sont occupés à l’arracher ; un
ouvrier le met en javelles, pendant qu’un autre le porte à un travailleur chargé
de l’égrener (1) : celui-ci est établi à l’ombre d’un arbre; il se sert d’un peigne
dont les dents sont assez espacées pour recevoir dans leurs intervalles la tige du
lin, mais trop serrées pour donner passage à la graine. Le talon du peigne pose
sur le sol ; le côté des dents est relevé par un support : l’ouvrier consolide le tout
et le maintient en place avec son pied. Il prend une poignée de lin ; et tenant
le sommet de la plante où est la graine, tourné vers le bas, il engage le lin
entre les dents du peigne et retire à lui : la graine, ne pouvant passer dans les
intervalles des dents, se sépare de la tige, sans que celle-ci soit endommagée. Ce
procédé antique n’est pas inconnu en France; on le pratique dans plusieurs de
nos provinces.
Les écrivains de l’antiquité paroissent avoir confondu le coton avec le lin
proprement dit ; les expressions qu’ils ont employées pour désigner ces matières,
sont si diverses et si incertaines, que des savans modernes ont pensé que, lorsque
nous lisons dans les ouvrages de ces écrivains que les prêtres Égyptiens étoiént
vêtus de robes de lin, nous devons entendre que ces robes étoient en coton:
(1) Planche 68, figures 40, 41 > 42 > 39> 38 et 37.
A .