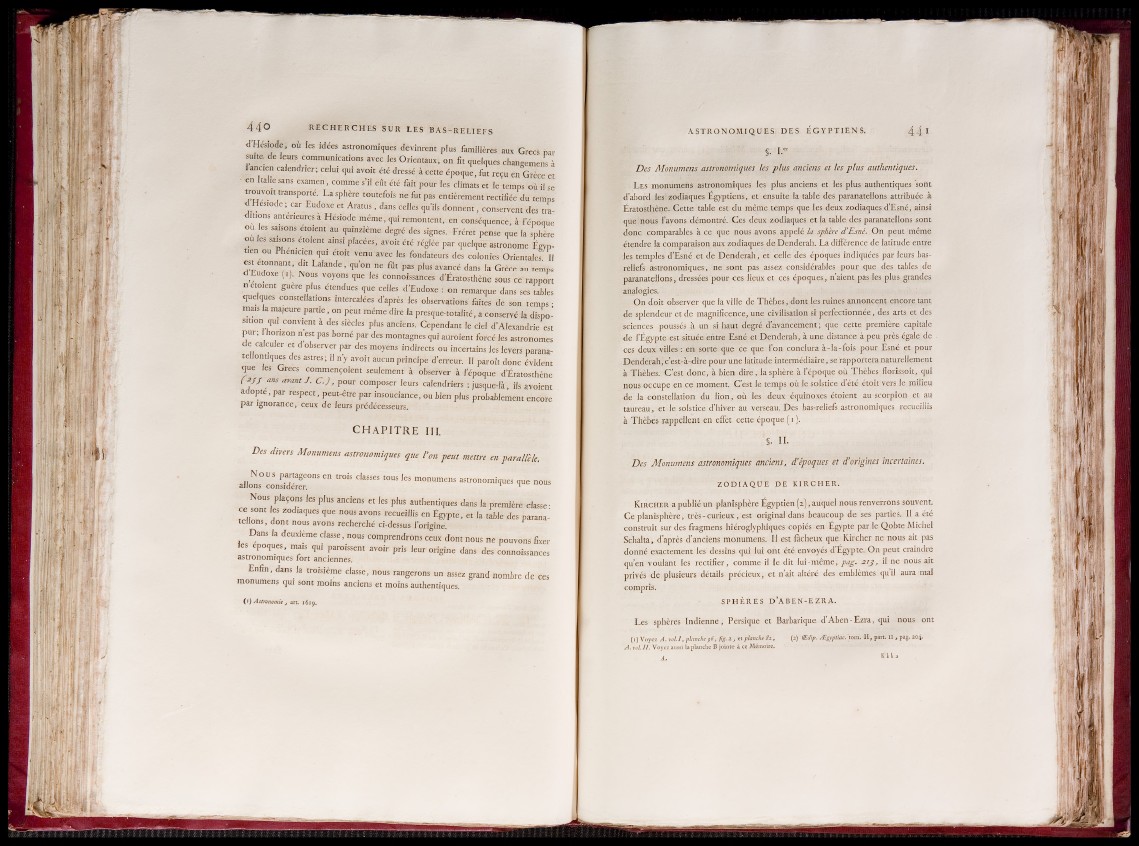
d ’Hésiode, où les idées astronomiques devinrent plus familières aux Grecs par
suite, de leurs communications avec les Orientaux, on fit quelques changerons à
1 ancien calendrier; celui qui avoit été dressé à cette époque, fut reçu en Grèce et
• en Italie sans examen, comme s’il eût été fait pour les climats et le temps où il se
trouyoït transporté. La sphère toutefois ne fut pas entièrement rectifiée du temps
d Hesiode ; car Eudoxe et Aratus, dans celles qu’ils donnent, conservent des traditions
antérieures à Hésiode même, qui remontent, en conséquence, à l’épogue
ou les saisons etoient au quinzième degré des signes.-Fréret pense que la sphère
ou Jes saisons etoient ainsi placées, avoit été réglée par quelque astronome Égyptien
ou Phemcien qui étoit venu avec les fondateurs des colonies Orientales II
est étonnant dit Lalande, qu’on ne fût pas plus avancé dans la Grèce au temps
d Eudoxe (t). Nous voyons que les connoissances d’Ératosthène sous ce rapport
n étoient guere plus étendues que celles d’Eudoxe : on remarque dans ses tahles
quelques constellations intercalées d’après les observations fhites de son temps 1
mais fa majeure partie, on peut même dire la presque-totalité, a conservé la disposition
cjui convient a des siècles plus anciens. Cependant le ciel d’Alexandrie est
pur; 1 horizon n est pas borné par des montagnes qui auroient forcé les astronomes
de calculer et d observer par des moyens indirects ou incertains les levers parana-
tellontiques des astres; il n'y avoit aucun principe d’erreur. Il paroît donc évident
que Jes Grecs commençoient seulement à observer à l’époque d’Ératosthène
( y j ans avant J . C .) , pour composer leurs calendriers : jusque-là, ils avoient
adopte, par respect, peut-être par insouciance, ou bien plus probablement encore
par ignorance, ceux de leurs prédécesseurs.
C H A P I T R E I I I .
DlS dtVers Monumens astronomiques que l'on peut mettre en parallèle.
allon^ considérer°nS| H ^ ^ T * nous
Nous plaçons les plus anciens et les plus authentiques dans la première classe-
ce sont les zodiaques que nous avons recueillis en Égypte, et la table des parana-
telions, dont nous avons recherché ci-dessus l’origine.
Dans la deuxième classe, nous comprendrons ceux dont nous ne pouvons fixer
les époques, mais qui paraissent avoir pris leur origine dans des connoissances
astronomiques fort anciennes.
Enfin, dans la troisième classe, nous rangerons un assez grand nombre de ces
monumens qui sont moins anciens et moins authentiques.
( i ) A s t r o n o m i e , art. 16 19 .
§. 1,"
Des Monumens astronomiques les p lu s anciens et les plu s authentiques.
L e s monumens astronomiques les plus anciens et les plus authentiques sont
d’abord les zodiaques Égyptiens, et ensuite la table des paranatellons attribuée à
Ératosthène. Cette table est du même temps que les deux zodiaques d’Esné, ainsi
que nous l’avons démontré. Ces deux zodiaques et la table des paranatellons sont
donc comparables à ce que nous avons appelé la sphère d ’Esné. On peut même
étendre la comparaison aux zodiaques de Denderah. La différence de latitude entre
les temples d’Esné et de Denderah, et celle des époques indiquées par leurs bas-
reliefs astronomiques, ne sont pas assez considérables pour que des tables de
paranatellons, dressées pour ces lieux et ces époques, n’aient pas les plus grandes
analogies.
On doit observer que la ville de Thèbes, dont les ruines annoncent encore tant
de splendeur et de magnificence, une civilisation si perfectionnée, des arts et des
sciences poussés à un si haut degré d’avancement; que cette première capitale
de l’Égypte est située entre Esné et Denderah, à une distance à peu près égale de .
ces deux villes : en sorte que ce que l’on conclura à-la-fois pour Esné et pour
Denderah, c’est-à-dire pour une latitude intermédiaire, se rapportera naturellement
à Thèbes. C ’est donc, à bien dire, la sphère à l’époque où Thèbes florissoit, qui
nous occupe en ce moment. C’est le temps où le solstice d’été étoit vers le milieu
de la constellation du lion, où les deux équinoxes étoient au scorpion et au
taureau, et le solstice d’hiver au verseau. Des bas-reliefs astronomiques recueillis
à Thèbes rappellent en effet cette époque ( i ).
§. II.
Des Monumens astronomiques anciens, d’époques et d’origines incertaines.
Z O D I A Q U E D E K I R C H E R .
K i r c h e r a publié un planisphère Égyptien ( 2 ) , auquel nous renverrons souvent.
Ce planisphère, très - curieux, est original dans beaucoup de ses parties. Il a été
construit sur des fragmens hiéroglyphiques copiés en Égypte par le Qobte Michel
Schalta, d’après d’anciens monumens. Il est fâcheux que Kircher ne nous ait pas
donné exactement les dessins qui lui ont été envoyés d’Égypte. On peut craindre
qu’en voulant les rectifier, comme il le dit lui-même, pag. 2 t j , il ne nous ait
privés de plusieurs détails précieux, et n’ait altéré des emblèmes quil aura mal
compris.
S P H È R E S d ’A B E N - E Z R A .
Les sphères Indienne, Persique et Barbarique d’Aben-Ezra, qui nous ont
( 1 ) Voyez A . vol. 1 , p l a n c h e et planche & , (2) (Edip. Æ g y p t ia c .'tom . I I , part. I I , pag. 204.
A . vol. I I , Voyez aussi la planche B jointe à ce Mémoire.
4. Kkka