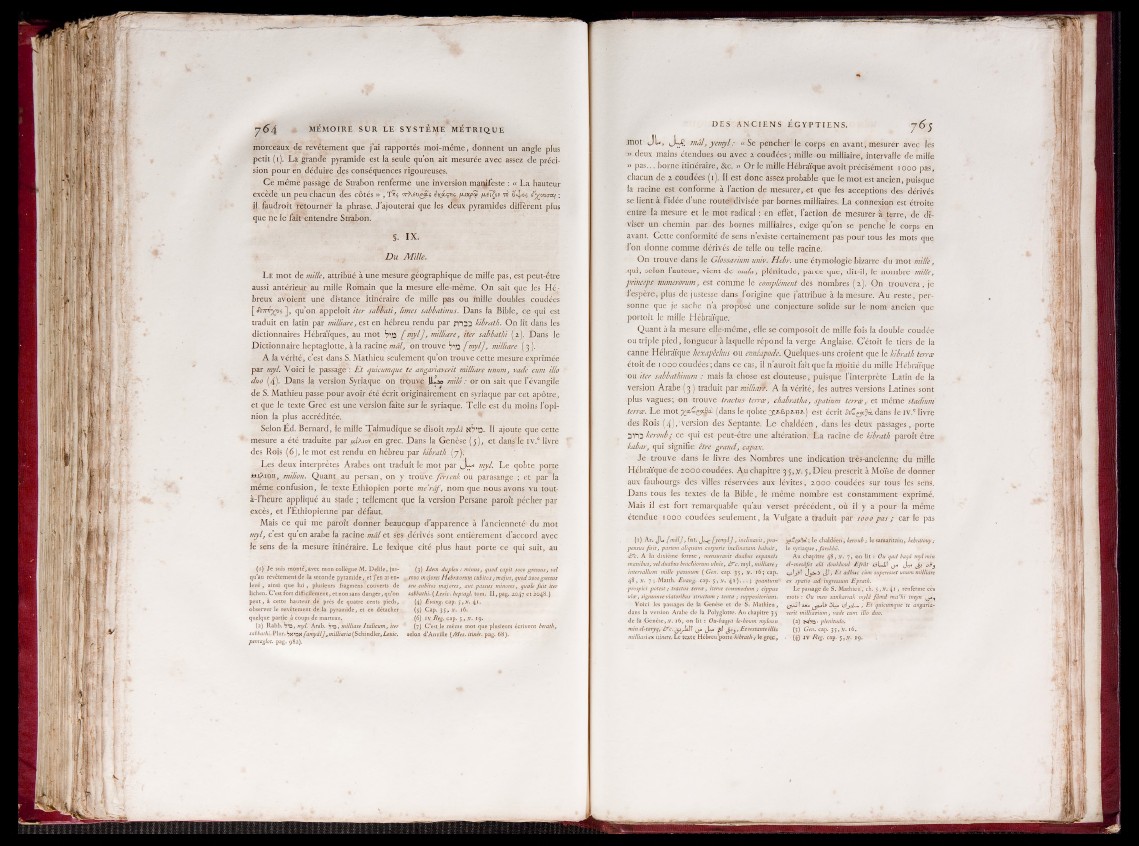
morceaux de revêtement que j’ai rapportés moi-même, donnent un angle plus
petit (i). La grande pyramide est la seule qu’on ait mesurée avec assez de précision
pour en déduire des conséquences rigoureuses.
Ce même passage de Strabon renferme une inversion manifeste : « La hauteur
excède un peu chacun des côtés » , T«* arktvçy.f i a fm p.ixpa ixéiêyi tE|/os éymmp :
il faudroit retourner la phrase. J’ajouterai que les deux pyramides diffèrent plus
que ne le fait entendre Strabon.
§. IX .
D u M ille .
L e mot de mille, attribué à une mesure géographique de mille pas, est peut-être
aussi antérieur au mille Romain que la mesure elle-même. On sait que les Hébreux
avoient une distance itinéraire de mille pas ou mille doubles coudées
[ li7niyyf ], qu’on appeloit iter sabbati, limes sabbatinus. Dans la Bible, ce qui est
traduit en latin par milliare, est en hébreu rendu par flIDD kibrath. On lit dans les
dictionnaires Hébraïques, au mot ^<¡3 [myl] , milliare, iter sabbathi (2). Dans le
Dictionnaire heptaglotte, à la racine mal, on trouve b'Ki [ myl], milliare ( 3 ).
A la vérité, c’est dans S. Mathieu seulement qu’on trouve cette mesure exprimée
par myl. Voici le passage : Et quicumque te angariaverit milliare unum, vade cum illo
duo ( 4 ) - Dans la version Syriaque on trouve JUJÎso milô : or on sait que l’évangile
de S. Mathieu passe pour avoir été écrit originairement en syriaque par cet apôtre,
et que le texte Grec est une version faite sur le syriaque. Telle est du moins l’opinion
la plus accréditée.
Selon Ed. Bernard, le mille Talmudique se disoit mylâ K^’n. Il ajoute que cette
mesure a été traduite par /Jaiou en grec. Dans la Genèse (y), et dans le iv.' livre
des Rois (6), le mot est rendu en hébreu par kibrath (7).
Les deux interprètes Arabes ont traduit le mot par myl. Le qobte porte
«jhson, milion. Quant au persan, on y trouve férsenk ou parasange ; et par la
même confusion, le texte Ethiopien porte me’râf, nom que nous avons vu tout-
à-l’heure appliqué au stade ; tellement que la version Persane paroît pécher par
excès, et l’Ethiopienne par défaut.
Mais ce qui me paroît donner beaucoup d’apparence à l’ancienneté du mot
myl, c’est qu’en arabe la racine mâl et ses dérivés sont entièrement d’accord avec
le sens de la mesure itinéraire. Le lexique cité plus haut porte ce qui suit, au
(1) Je suis monte,avec mon collègue M. D e lile , jus- (3) Idem duplex : minus, quod capit 1000 gressus, vel
qu’au revêtement de la seconde pyramide, et j’en ai en- /ooo majores Hebroeorum cubitus ; majus, quod2000gressus
leve , ainsi que l u i , plusieurs fragmcns. couverts de seu cubitos majores,, aut passus minores, quale fuit iter
lichen. C ’est fort difficilement, et non sans danger, qu’on sabbathi. ( Lexic. hepragl. tom. I I , pag. 2047 et 2048.)
p eu t , à cette hauteur de près de quatre cents pieds, (4) Evang. cap. 5 ,# . 4*-
observer le revêtement de la pyramide, et en détacher (5) Cap. 35, jt. 16.
quelque partie à coups de marteau. (6) i v Reg. cap. 5 , y. 19.
(2) Rabb. ?’D, myl. Arab. S'D, milliare Italicum, iter ' (7) C ’est le même mot que plusieurs écrivent berath,
sabbathi. Plur. hwaH [amyâlj, milliaria (Schindler, Lexic. selon d’A n ville {Mes. itinér. pag. 68). pcntaglot. pag. 982).
mot J L , 1J7A. mâl,yemyl: « Se pencher le corps en avant, mesurer avec les
» deux mains étendues ou avec 2 coudées; mille ou milliaire, intervalle de mille
» pas... horne itinéraire, &c. >•> O r Je mille Hébraïque avoit précisément 1000 pas,
chacun de 2 coudées (1). Il est donc assez probable que le mot est ancien, puisque
la racine est conforme à l’action de mesurer, et que ies acceptions des dérivés
se lient à l’idée d’une route^divisée par bornes miliiaires. La connexion est étroite
entre la mesure et le mot radical : en effet, l’action de mesurer à terre, de diviser
un chemin par. des bornes miliiaires, exige qu’on se penche le corps en
avant. Cette conformité de sens n’existe certainement pas pouf tous les mots que
l’on donne comme dérivés de telle ou telle racine.
On trouve dans le Glossarium univ. Hebr. une étymologie bizarre du mot mille,
.qui, selon l’auteur, vient de mala, plénitude, parce que, dit-il, le nombre mille,
princeps numerorum, est comme le complément des nombres (2). On trouvera, je
l’espère, plus.de justesse dans l’origine que j’attribue à la mesure. A u reste, personne
que je sache n’a proposé une conjecture solide sur le nom ancien que
portoit Je mille Hébraïque.
Quant à la mesure elle-même, elle se composoit de mille fois la double coudée
ou triple pied, longueur à laquelle répond la verge Anglaise. C ’étoit le tiers de ia
canne Hébraïque hcxapêchus ou enneapode. Quelques-uns croient que le kibrath terroe
étoit de 1000 coudées ; dans ce cas, il n’auroit fait que la moitié du mille Hébraïque
ou iter sabbathinum ; mais la chose est douteuse, puisque l’interprète Latin de Ja
version Arabe (3 ) traduit par milliarf. A la vérité, les autres versions Latines sont
plus vagues; on trouve tractus terroe, chabralha, spatium terroe,■ et même stadium
terroe. L e mot (dans le qobte ^Rps-uz.) est écrit S&çyfu. dans ie iv .c livre
des Rois (4 ), version des Septante. Le- chaldéen, dans les deux passages, porte
3VD keronb; ce qui est peut-être une altération. L a racine de kibrath paroît être
kabar, qui signifie être grand, capax.
Je trouve dans le livre des Nombres une indication très-ancienne du mille
Hébraïque de 2000 coudées. A u chapitre 3 5, tt. 5, Dieu prescrit à Moïse de donner
aux faubourgs des villes réservées aux lévites, 2000 coudées sur tous ies sens.
Dans tous les textes de la Bible, le même nombre est constamment exprimé.
Mais il est fort remarquable qu’au verset précédent, où il y a pour la même
étendue 1000 coudées seulement, la Vulgate a traduit par 1000 pas ; car ie pas
( 1 ) Ar. J L [mal], fut. J ^ r [yemyl], uKlinavit, pro- ; le chaldéen , keroub ; le samaritain, kebratouy
pensus fuit, partem aliquam corporis inclinatam habuit, le syriaque, farskhô.
¿7c. A la dixième forme , mensuravit duabus expansis A u chapitre 48, y. 7 , on lit : Ou qad baqà myl min
manibus, vel duabus brachiorum ulnis,.<l?c. myl, milliare s el-mesâfet eld doukhoul Efrât ^ Jû o i j intervallum mille passuum ( Gen. cap. 3 5 , y. 16; cap. o f J * i O J.\, Et adhuc citm superesset unum milliare
48 , y. 7 ; Matth. Evang. cap. 5 , y, 41 ) • • . ; quantum '■ ex spatio ad ingressum Eprath.
■prospici potest; tractus terroe, iterve commodum ; cippus Le passage de S. Mathieu, ch. 5 , y . 4* > renferme ces vioe, signumve viatoribus structura ; tenta ; suppositorium. -mots : Ou men sanharrak mylâ fâmd ma’hi tneyn
V oici les passages de la Genèse et de S . Mathieu, ja-oli JL* c i ) , Et quicumque te angariadans
la version Arabe de la Polyglotte. Au chapitre 35 verit milliarium, vade cum illo duo.
de Ja Genèse,»v. 16 , on lit : Ou-baqyâ le-houm myloun (2) îk S d ’ plenitudo,
min el-taryq,- c. ^ J^o gà J u j , Et restante illis (3) Gen. cap. 35, y. 16. milliari ex itinere, Le texte Hébreu porte, kibrath-j le .grec , » (4) JV Reg. cap. 5 ,y. ro.