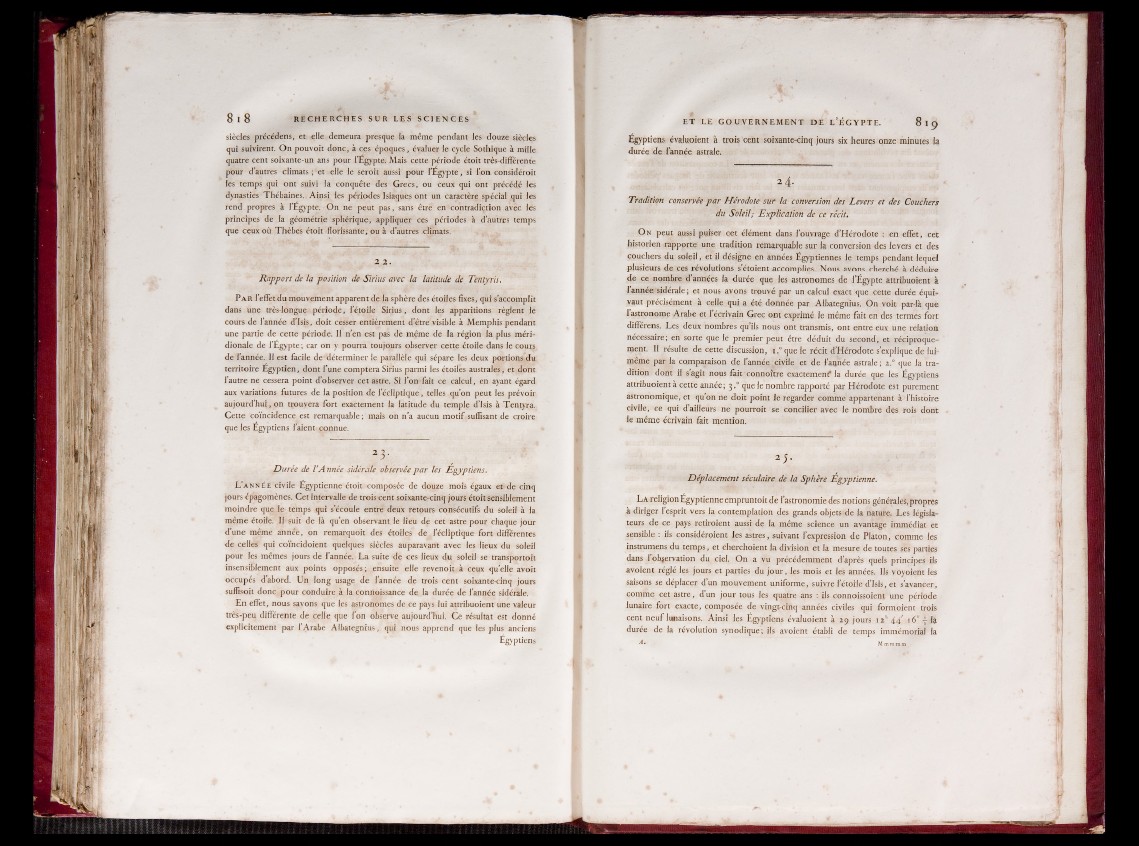
siècles précédens, et elle demeura presque la même pendant les douze siècles
qui suivirent. On pouvoit donc, à ces époques, évaluer le cycle Sothique à mille
quatre cent soixante-un ans pour l’Egypte. Mais cette période étoit très-différente
pour d’autres climats ; et elle le seroit aussi pour l’Egypte, si l’on considéroit
les temps qui ont suivi la conquête des Grecs, ou ceux qui ont précédé les
dynasties Thébaines. Ainsi les périodes Isiaques ont un caractère spécial qui les
rend propres à l’Egypte. O n ne peut pas, sans être en contradiction avec les
principes de la géométrie sphérique, appliquer ces périodes à d’autres temps
que ceux où Thèbes étoit florissante, ou à d’autres climats.
2 2 .
Rapport de la position de S iriu s avec la latitude de Terityris.
P a r l’effet du mouvement apparent de la sphère des étoiles fixes, qui s’accomplit
dans une très-longue période, l’étoile Sirius, dont les apparitions règlent le
cours de l’année d’Isis, doit cesser entièrement d’être visible à Memphis pendant
une partie de cette période. Il n’en est pas de même de la région la plus méridionale
de l’Egypte; car on y pourra toujours observer cette étoile dans le cours
de l’année. Il est facile de déterminer le parallèle qui sépare les deux portions du
territoire Egyptien, dont l’une comptera Sirius parmi les étoiles australes, et dont
l’autre ne cessera point d’observer cet astre. Si l’on fait ce calcul, en ayant égard
aux variations futures de la position de l’écliptique, telles qu’on peut les prévoir
aujourd’h u i, on trouvera fort exactement la latitude du temple d’Isis à Tentyra.
Cette coïncidence est remarquable ; mais on n’a aucun motif suffisant de croire
que les Egyptiens l’aient connue.
2 3 ‘
D urée de l ’A n n ée sidérale observée p a r les Egyptien s.
L ’a n n é e civile Egyptienne étoit composée de douze mois égaux et de cinq
jours épagomènes. C e t intervalle de trois cent soixante-cinq jours étoit sensiblement
moindre que le temps qui s’écoule entre deux retours consécutifs du soleil à la
même étoile. Il suit de là qu’en observant le lieu de cet astre pour chaque jour
d’une même année, on remarquoit des étoiles de l’écliptique fort différentes
de celles qui coïncidoient quelques siècles auparavant avec les lieux du soleil
pour les mêmes jours de l’année. L a suite de ces lieux du soleil se transportoit
insensiblement aux points opposés; ensuite elle revenoit à ceux qu’elle avoit
occupés d’abord. Un long usage de l’année de trois cent soixante-cinq jours
suffisoit donc pour conduire à la connoissance de la durée de l’année sidérale.
En effet, nous savons que les astronomes de ce pays lui attribuoient une valeur
très-peu différente de celle que l’on observe aujourd’hui. C e résultat est donné
explicitement par l’Arabe Albategnius, qui nous apprend que les plus anciens
Égyptiens
Egyptiens évaluoient à trois cent soixante-cinq jours six heures onze minutes la
durée de l’année astrale.
2 4 .
Tradition conservée p a r Hérodote sur la conversion des Levers et des Couchers
du S o leil; E xp lica tion de ce récit.
O n peut aussi puiser cet élément dans l’ouvrage d’H érodote : en effet, cet
historien rapporte une tradition remarquable sur la conversion des levers et des
couchers du soleil , et il désigne en années Égyptiennes le temps pendant lequel
plusieurs de ces révolutions s’étoient accomplies. Nous avons cherché à déduire
de ce nombre d’années la durée que les astronomes de l’Egypte attribuoient à
l’année sidérale ; et nous avons trouvé par un calcul exact que cette durée équL
vaut précisément à celle qui a été donnée par Albategnius. On voit par-là que
1 astronome Arabe et l’écrivain Grec ont exprimé le même fait en des termes fort
differens. Les deux nombres qu’ils nous ont transmis, ont entre eux une relation
nécessaire; en sorte que le premier peut être déduit du second, et réciproquement.
Il résulte de cette discussion, i,° que le récit d’Hérodote s’explique de lui-
meme par la comparaison de l’année civile et de l’année astrale ; z.° que la tradition
dont il s’agit nous fait connoître exactement1 la durée que les Égyptiens
attribuoient a cette année ; 3 que le nombre rapporté par Hérodote est purement
astronomique, et qu’on ne doit point le regarder comme appartenant à l’histoire
civile, ce qui d’ailleurs ne pourroit se concilier avec le nombre des rois dont
le même écrivain fait mention.
2 ; .
D éplacem ent séculaire de la Sphère Egyptienne.
L a religion Égyptienne empruntoit de l’astronomie des notions générales, propres
a diriger I esprit vers la contemplation des grands objets de la nature. Les législateurs
de ce pays retiroient aussi de la même science un avantage immédiat et
sensible : ils considéroient les astres, suivant l’expression de Platon, comme les
instrumens du temps, et cherchoient la division et la mesure de toutes ses parties
dans 1 obgervation du ciel. O n a vu précédemment d’après quels principes ils
avoient réglé les jours et parties du jou r, les mois et les années. Ils voyoient les
saisons se déplacer d’un mouvement uniforme, suivre l’étoile d’Isis, et s’avancer,
comme cet astre, d un jour tous les quatre ans : ils connoissoient une période
lunaire fort exacte, composée de vingt-cinq années civiles qui formoient trois
cent neuf lunaisons. Ainsi les Égyptiens évaluoient à 29 jours 1 z 1' 44' 16" ~ la
durée de la révolution synodique; ils avoient établi de temps immémorial la
M mmmm