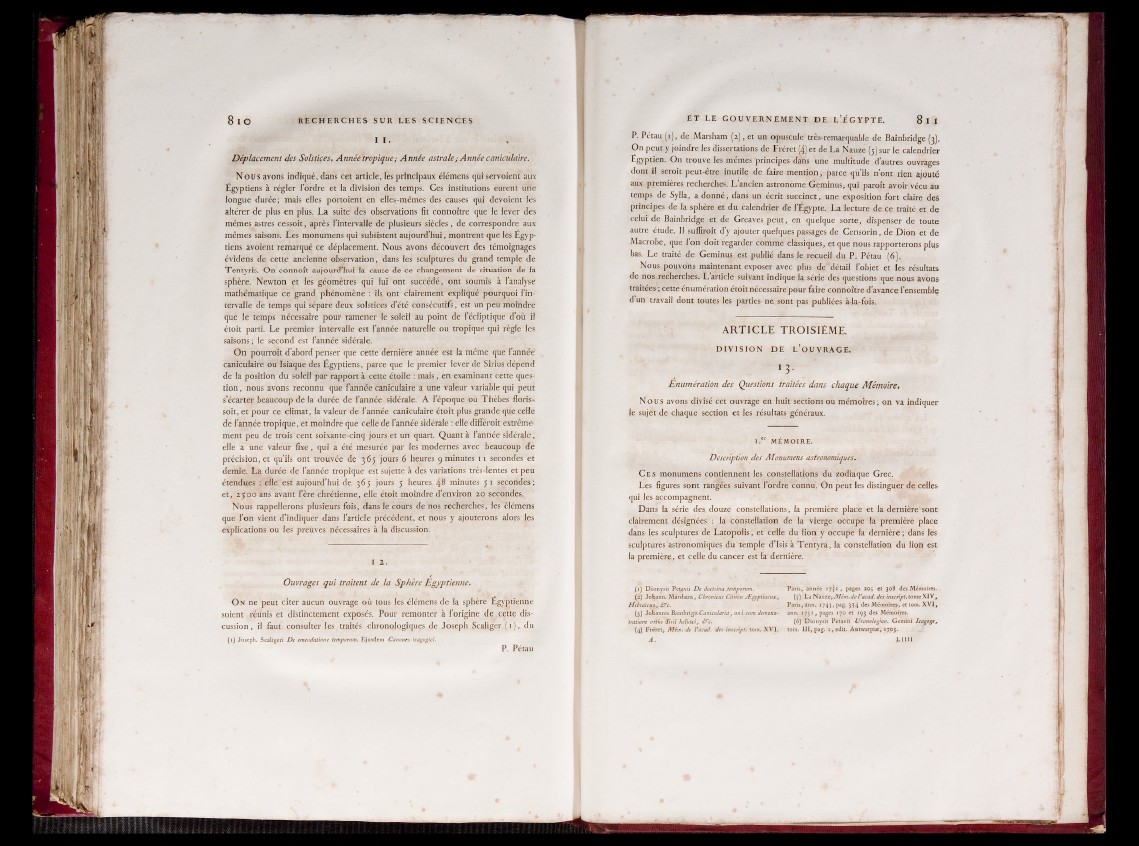
I I .
Dépl^çemen t des Solstices. A n n é e tropique ; A n n é e astrale ; A n n é e caniculaire.
N o u s avons indiqué, dans cet article, les principaux élémens qui servoient aux
Égyptiens à régler l’ordre et la division des temps. Ces institutions eurent une
longue durée; mais elles portoient. en elles-mêmes des causes qui devoient les
altérer de plus en plus. L a suite des observations fit connoître que le lever des
mêmes astres cessoit, après l’intervalle de plusieurs siècles, de correspondre aux
mêmes saisons. Les monumens qui subsistent aujourd’h u i, montrent que les Égyptiens
avoient remarqué ce déplacement. Nous avons découvert des témoignages
évidens de cette ancienne observation, dans les sculptures du grand temple de
Tentyris. On connoît aujourd’hui la cause de ce changement de situation de la
sphère. Newton et les géomètres qui lui ont succédé, ont soumis à l’analyse'
mathématique ce grand phénomène : ils ont clairement expliqué pourquoi l’intervalle
de temps qui sépare deux solstices d’été consécutifs, est un peu moindre
que le temps nécessaire pour ramener le soleil au point de l’écliptique d’où il
étoit parti. L e premier intervalle est l’année naturelle ou tropique qui règle les
saisons; le second est l’année sidérale.
On pourrait d’abord penser que cette dernière année est la même que l’année
caniculaire ou Isiaque des Égyptiens, parce que le premier lever de Sirius dépend
de la position du soleil par rapport à cette étoile : mais, en examinant cette question
, nous avons reconnu que l’année caniculaire a une valeur variable qui peut
s’écarter beaucoup de la durée de l’année sidérale. A l’époque où Thèbes floris-
soit, et pour ce climat, la valeur de l’année caniculaire étoit plus grande que celle
de l’année tropique, et moindre que celle de l’année sidérale : elle différait extrêmement
peu de trois cent soixante-cinq jours et un quart. Quant à l’année sidérale,
elle a une valeur fix e , qui a été mesurée par les modernes avec beaucoup de
précision, et qu’ils ont trouvée de 365 jours 6 heures 9 minutes 1 1 secondes et
demie. L a durée de l’année tropique est sujette à des variations très-lentes et peu
étendues : elle est aujourd’hui de 365 jours 5 heures 48 minutes 51 secondes;
e t, 2500 ans avant l’ère chrétienne, elle étoit moindre d’environ 20 secondes.
Nous rappellerons plusieurs fois, dans le cours de nos recherches, les élémens
que l’on vient d’indiquer dans l’article précédent, et nous y ajouterons alors les
explications ou les preuves nécessaires à la discussion.
I 2.
Ouvrages q u i traitent de ¡a Sp hè re Egyptienne.
On ne peut citer aucun ouvrage où tous les élémens de la sphère Egyptienne
soient réunis et distinctement exposés. Pour remonter à l’origine de cette discussion,
il faut consulter les traités chronologiques de Joseph Scaliger (1), du
(1) Joseph. Scaligeri De einendatiorie temponnn. Ejusdem Canones isagogici.
P. Pétau
P. Pétau (1), de Marsham (2), et un opuscule très-remarquable de Bainbridge (3).
On peut y joindre les dissertations de Fréret (4) et de La Nauze (5) sur le calendrier
^■Syp^^. On trouve les mcmes principes dans une multitude d autres ouvrages
dont il serait peut-être inutile de faire mention, parce qu’ils n’ont rien ajouté
aux premières recherches. L ’ancien astronome Geminus, qui paraît avoir vécu au
temps de Sylla, a donné, dans un écrit succinct, une exposition fort claire des
principes de la sphère et du calendrier de l’Égypte. L a lecture de ce traité et de
celui de Bainbridge et de Greaves peut, en quelque sorte, dispenser de toute
autre étude. Il suffirait d’y ajouter quelques passages de Censorin, de Dion et de
Macrobe, que l’on doit regarder comme classiques, et que nous rapporterons plu^
bas. L e traité de Geminus est publié dans le recueil du P. Pétau (6).
Nous pouvons maintenant exposer avec plus de détail l’objet et les résultats
de nos recherches. L ’article suivant indique la série des questions que nous avons
traitées ; cette énumération étoit nécessaire pour faire connoître d’avance l’ensemble
d’un travail dont toutes les parties n e sont pas publiées à-la-fois.
A R T I C L E T R O IS IÈM E .
D I V I S I O N D E L ’ O U V R A G E .
1 3 -
Enumération des Questions traitées dans chaque M émoire.
No u s avons divisé cet ouvrage en huit sections ou mémoires; on va indiquer
le sujet de chaque section et les résultats généraux.
1 . " MÉMO I R E .
Description des Monumens astronomiques.
Ce s monumens contiennent les constellations du zodiaque Grec.
Les figures sont rangées suivant l’ordre connu. On peut les distinguer de celles
qui les accompagnent.
Dans la série des douze constellations, la première place -et la dernière sont
clairement désignées : la constellation de la vierge occupe la première place
dans' les sculptures de Latopolis, et celle du lion y occupe la dernière ; dans les
sculptures astronomiques du temple d’Isis à Tentyra, la constellation du lion est
la première, et celle du cancer est la dernière.
(1) Dionysii Petavii De doctrina,teinporum. Paris, année 1751 , pages 205 et 308 des Mémoires.
(2) Johann. Marsham, Chronicus Canon Ægyptiacus., (5) La Nauze, AIém.del’acad. des inscript.tom eX IV , Hebraicus, ¿7c. Paris, ann. 174 3, pag. 334 des Mémoires, et tom. X V I ,
(3) Johannis Bainbrigii Canicularia, unà cum démons- ann. 1 7 5 1 , pages 170 et 193 des Mémoires. tratione oriûs Sirii heliaci, ¿7c. (6) Dionysii Petavii Uranologion. Gemini Isagoge,
'(4) Fréret, Mém. de l’acad. des inscript. tom. X V I , tom. 111, pag. 1 , edit. Antwerpiæ, 1703•
A. L i l i l