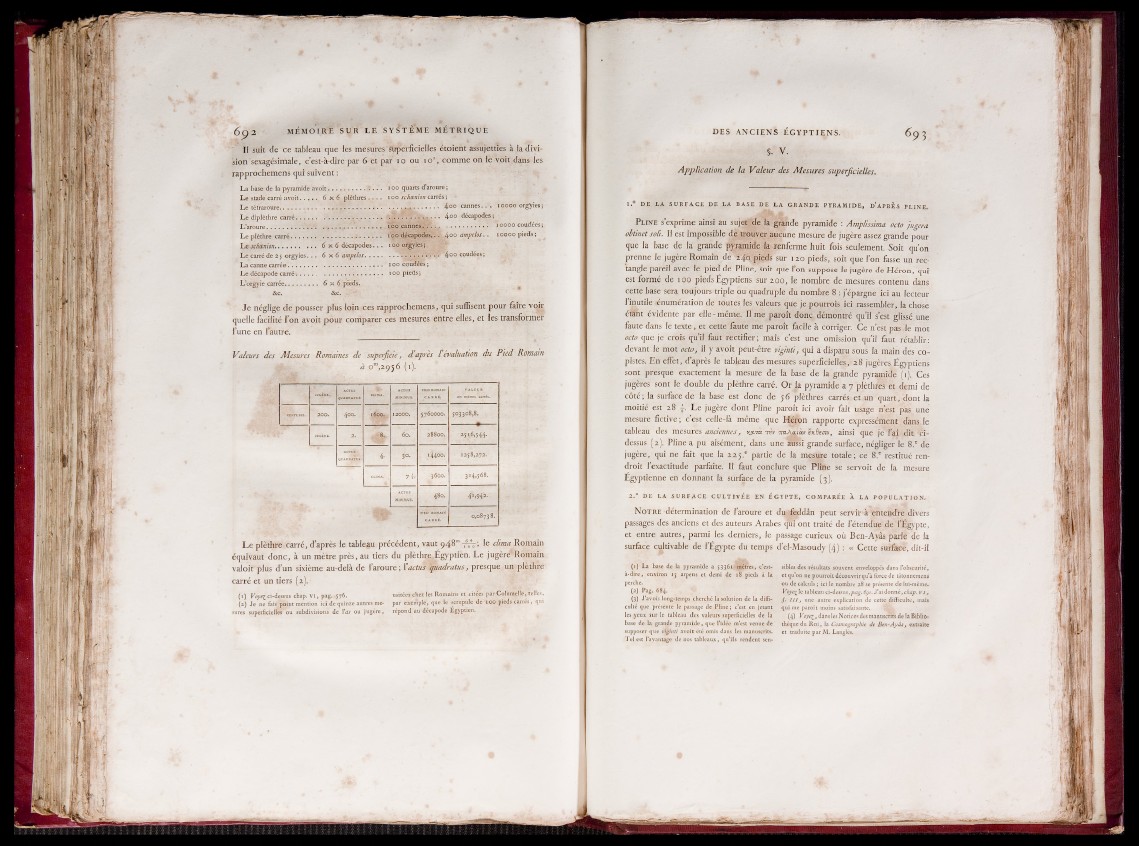
II suit de ce tableau que les mesures‘Superficielles étoient assujetties à la division
sexagésimale, c’est-à-dire par 6 et par 10 ou ic r , comme on le voit dans les
rapprochemens qui suivent :
L a b a s e d e la p y r am id e a v o i t ................................: . . . i o o q u a r t s d ’a r o u r e ;
L e s ta d e c a r r é a v o i t 6 x 6 p l è t h r e s . . . . 1 0 0 s c h oe n i o n c a r r é s ; pi
L e té t r a r o u r e . .................... ^ • • • • • • • • • • 4© o c a n n e s . . . i o o o o o r g y i e s ;
L e d ip lè th r e c a r r é ............................................................... ■ • • • 4° ° d é c a p o d e s ;
L ’a r o u r e . . 1 .................... . . io o c a n n e s * : / . • i o o o o c o u d é e s ;
L e p l è t h r e c a r r é .............................................................................. i p o d é c a p o d e s . . . ^ 4° ° a m P e^0 S • • i o o o o p i e d s ;
L e s c h oe n i o n . . . 6 x 6 d é c a p o d e s . . . i o o o r g y ië s ;
L e c a r r é d e 2 5 o r g y i e s . . . 6 x 6 a m p c l o s ........................... * ‘4° ° c o u d é e s ;
L a c a n n e c a r r é e ............................................ .................................... 1 0 0 c o u d é e s ;
L e d é c a p o d e c a r r é - . ....................................................................... 1 0 0 p ie d s ;
L ’o r g y ie c a r r é e ............................ 6 x 6 p ie d s .
& c . & c . * *
Je néglige de pousser plus loin ces rapprochemens, qui suffisent pour faire vqir
quelle facilité l’on avoit pour comparer ces mesures entre elles, et les transformer
l’une en l’autre.
Valeurs des Aiesures Romaines de superficie, d’après l évaluation du Pied Romain
à om,2956 (1).
1600. 5 760000.
14400.
3600.
503308,8.
2S «,6.544-
1258,272.
314,568-
4 1 ,9 4 2 .
0,08738.
Le plèthre carré, d’après le tableau précédent, vaut 948” le clima Romain
équivaut donc, à un mètre près, au tiers du plèthre,Égyptien. Le jugere Romain
valoir plus d’un sixième au-delà de l’aroure ; l’actus 'quadratus, presque un plèthre
carré et un tiers (2).
( 1) Voyei ci-dessus chap. V I , pag. 576. usitées chez les Romains et citées par C olume ile, telles,
(2) J e ne fais point mention ici de quinze autres me- par exemple, que le scrupule de to o pieds carrés, qui
sures superficielles ou subdivisions de Vas ou ju gère, repond au decapode Egyptien.
D E S A N C I E N S É G Y P T I E N S . 6 9 3
§• V.
Application de la Valeur des Mesures superficielles.
1.° DE LA SURFAC E DE LA BASE DE LA GRANDE PYRAMIDE, D’APRES PLINE.
P l in e s’exprime ainsi au sujet d e la grande pyramide : Amplissima octo jugera
obtinet soli. Il est impossible d e trouver aucune mesure de jugère assez grande pour
que la base de la grande pyramide la renferme huit fois seulement. Soit qu’on
prenne le jugère Romain dé pieds sur 120 pieds, soit que l’on fasse un rectangle
pareil avec le pied de Pline, soit que l’on suppose le jugère de Héron, qui
est formé de 100 pieds Égyptiens sur 200, le nombre de mesures contenu Ame
cette base sera toujours triple ou quadruple du nombre 8 : j’épargne ici au lecteur
1 inutile ¡énumération de toutes les valeurs que je pourrois ici rassembler, la chose
étSht évidente par elle-même. Il me paroît donc démontré qu’il s’est glissé une
faute dans le texte, et cette faute me paroît facile à corriger. Ce n’est pas le mot
octo que je crois qu’il faut rectifier; mais c’est une omission qu’il faut rétablir:
devant le mot octo, il y avoit peut-être viginti, qui a disparu sous la main des copistes.
En effet, d’après le tableau des mesures superficielles, 28 jugères. Égyptiens
sont presque exactement la mesure de la base de la grande pyramide (1). Ces
jugères sont le double du plèthre carré. Or la pyramide a 7 plèthres et demi de
côté; la surface de la base est donc de 56 plèthres carrés;et un quart, dont la
moitié est 28 j . Le jugère dont Pline paroît ici avoir fait usage n’est pas une
mesure fictive ; c’est celle-là même que Héron rapporte expressément dans le
tableau des mesures anciennes, nÿ.izt tjjv eitQeoiv, ainsi que je Tai dit cidessus
(2). Pline a pu aisément, dans une aussi grande surface, négliger le 8.c de
jugère, qui ne fait que la 225.' partie de la mesure totale; ce 8.' restitué ren-
droit l’exactitude parfaite. Il faut conclure que Pline se servoit de la mesure
Égyptienne en donnant la surface de la pyramide (3).
2. ° D E L A S U R F A C E C U L T I V E E EN E G Y P T E , C O M P A R É E À L A P O P U L A T IO N .
N o t r e détermination de l’aroure et du feddân peut servir à entendre divers
passages des anciens et des auteurs Arabes qui ont traité de l’étendue de l’Égypte,
et entre autres, parmi les derniers, le passage curieux où Ben-Ayâs parlé de la
surface cultivable de l’Égypte du temps d’el-Masoudy (4 ) : « Cette surface”, dit-il
(1) L a base de la pyramide a y33^1.riiSetres, c est- sibles des résultats souvent enveloppés dans l’obscurité,
à-dire, environ 15 arpens et demi de 18 pieds à la et qu’on ne pourrait découvrirqu’à force de tâtonnement
perche. ou de calculs; ici le nombre 28 se présente de lui-même.
(2) Pag. 684. Voye^ le tableau ci-d essus,pag. 6fit. J’ai donné, chap. v i j
(3 ) J avois long-temps cherche la solütion de la diffi- j , m , une autre explication de cette difficulté, mais
culté que présente le passage de Pline; c’est en jetant qui me paroît moins satisfaisante,.
les yeux sur le tableau des valeurs superficielles de la (4) Voye^j dans les Notices des manuscrits de la Biblio-
base de la grande pyramide, que l’idée m’est venue de thèquedu R o i, la Cosmographie de Ben-Ayâs, extraite
supposer que viginti avoit été omis dans les manuscrits, et traduite par M. Langlès.
T e l est l’avantage de nos tableaux, qu’ils rendent sen