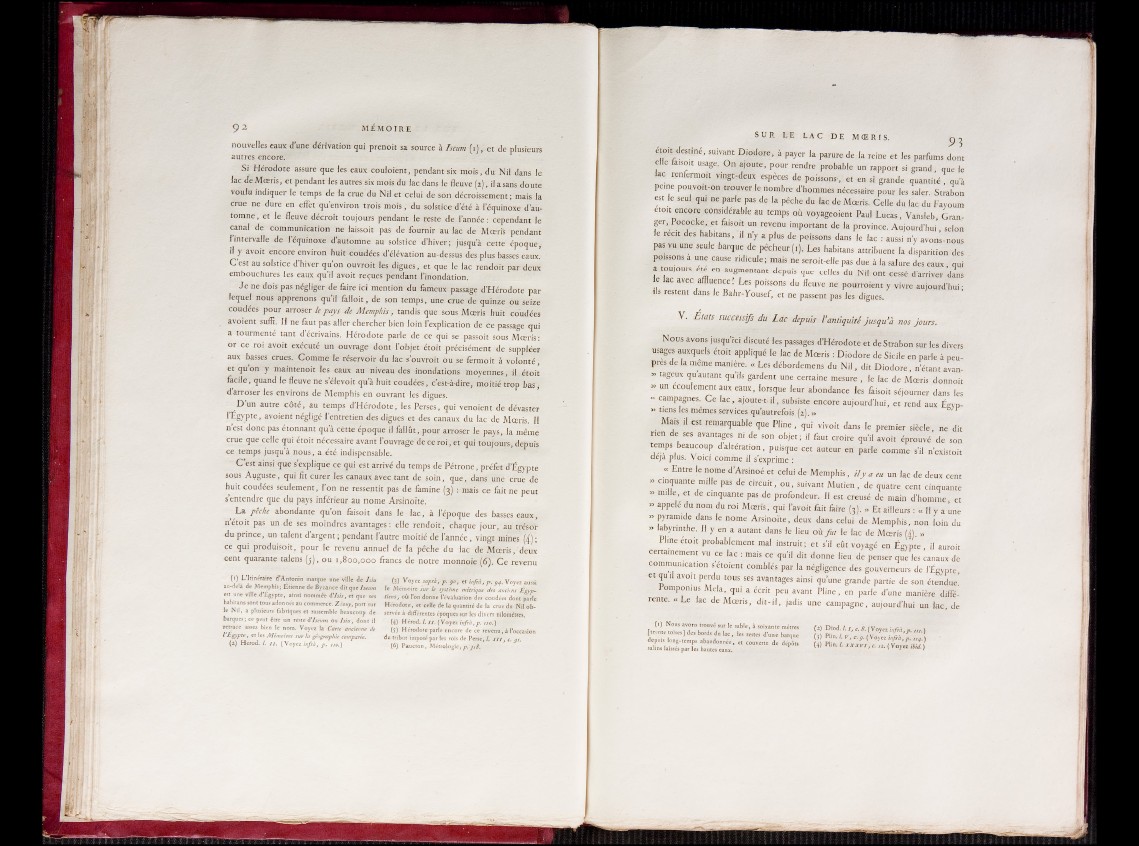
nouvelles eaux d’une dérivation qui prenoit sa source à Iseum (i), et de plusieurs
autres encore.
Si Hérodote assure que les eaux couloient, pendant six mois, du Nil dans le
lac de Moeris, et pendant les autres six mois du lac dans le fleuve (2), il a sans doute
voulu indiquer le temps de la crue du Nil et celui de son décroissement; mais la
crue ne dure en effet qu’environ trois mois, du solstice d’été à l’équinoxe d’automne
, et le fleuve décroît toujours pendant le reste de l’année : cependant le
canal de communication ne laissoit pas de fournir au lac de Moeris pendant
1 intervalle de 1 équinoxe d’automne au solstice d’hiver; jusqu’à cette époque,-
il y avoit encore environ huit coudées d’élévation au-dessus des plus basses eaux.
C ’est au solstice d’hiver qu’on ouvroit les digues, et que le lac rendoit par deux
embouchures les eaux qu’il avoit reçues pendant l’inondation.
Je ne dois pas négliger de faire ici mention du fameux passage d’Hérodote par
lequel nous apprenons qu’il fàlloit, de son temps, une crue de quinze ou seize
coudées pour arroser le pays de Memphis, tandis que sous Moeris huit coudées
avoient suffi. 11 ne faut pas aller chercher bien loin l’explication de ce passage qui
a tourmenté tant d’écrivains. Hérodote parle de ce qui se passoit sous Moeris:
or ce roi avoit exécuté un ouvrage dont l’objet étoit précisément de suppléer
aux basses crues. Comme le réservoir du lac s’ouvroit ou se fermoit à volonté,
et quon y maintenoit les eaux au niveau des inondations moyennes, il étoit
facile, quand le fleuve ne selevoit qu’à huit coudées, c’est-à-dire, moitié trop bas,
darroser les environs de Memphis en ouvrant les digues.
D un autre cote, au temps d Hérodote, les Perses, qui venoient de dévaster
1 Egypte, avoient négligé l’entretien des digues et des canaux du lac de Moeris. Il
n’est donc pas étonnant qu’à cette époque il fallût, pour arroser le pays, la même
crue que celle qui étoit nécessaire avant l’ouvrage de ce roi, et qui toujours, depuis
ce temps jusqu’à nous, a été indispensable.
C ’est ainsi que s’explique ce qui est arrivé du temps de Pétrone, préfet d’Égypte
sous Ayguste, qui fit curer les canaux avec tant de soin, que, dans une crue de
huit coudées seulement, l’on ne ressentit pas de famine (3) : mais ce fait ne peut
s entendre que du pays inférieur au nome Arsinoïte.
^ La pêche abondante qu’on faisoit dans le lac, à l’époque des basses eaux,
n’étoit pas un de ses moindres avantages: elle rendoit, chaque jour, au trésor
du prince, un talent d’argent ; pendant l’autre moitié de l’année, vingt mines (4) ;
ce qui produisoit, pour le revenu annuel de la pêche du lac de Moeris, deux
cent quarante talens (3), ou 1,800,000 francs de notre monnoie (6). Ce revenu
(J 1,.L ’i ' in, ! raire. d’A -“ ' ° " in mar<î“ e “ ne vi,,e de ls iu (S) V oyez suprà, p . p c , et infrh, p. pa. V o y e z aussi
au-deia de Memphis; Etienne de Byzance dit que Iseum le Mémoire 'sur le système métrique des aucuns Égyp-
est une ville d Egyp te, ainsi nommée d ’/ s is , et que ses tiens, où l'on donne l'évaluation des coudées dont parle
habitans sont tous adonnés au commerce. ZSouy, port sur Hérodote, et celle de la quantité de la crue du N il ob-
le N il, a plusieurs fabriques et rassemble beaucoup de servée à différentes époques sur les divers nilomètres
barques; ce peut être un reste d’Iseum ou l s iu , dont il (4) Hérod. I. (Vo y e z infrh, p . ,,o .)
retrace assez bien le nom. V o y e z la Cane ancienne de (5) Hérodote parle encore de ce revenu, à l'occasion
Ih g y p te , et les Mémoires sur la géographie comparée. du tribut imposé par les rois de P e r s e ,/. 1 1 1 , c. ai.
(2) Herod. I. u . (V o y e z infrh, p . ,,a .) (6) P ju c ton , Métrologie, p . j , 8.
étoit destiné, suivant Diodore, à payer la parure de la reine et les parfums dont
elle faisoit usage. On ajoute, pour rendre probable un rapport si grand, que le
lac renfermoit vingt-deux espèces de poissons-, et en si grande quantité , qu’à
pe.ne pouvoit-on trouver le nombre d’hommes nécessaire pour les saler. Strabon
est le seul qui ne parle pas de la pêche du lac de Moeris. Celle du lac du Fayoum
etoit encore considérable au temps où voyageoient Paul Lucas, Vansleb, Gran-
ger, Pococke, et fkisoit un revenu important de la province. Aujourd’hui’ , selon
e récit des habitans, il n’y a plus de poissons dans le lac : aussi n’y avons-nous
pas vu une seule barque de pêcheur (i). Les habitans attribuent la disparition des
poissons a une cause ridicule; mais ne seroit-elle pas due à la salure des eaux qui
a toujours été en augmentant depuis que celles du Nil ont cessé d’arriver dans
le lac avec affluence! Les poissons du fleuve ne pourroient y vivre aujourd’hui-
ils restent dans le Bahr-Yousef, et ne passent pas les digues.
V. États successifs du L ac depuis l ’antiquité ju sq u ’à nos jours.
Nous avons jusqu’ici discuté les passages d’Hérodote et de Strabon sur les divers
usages auxquels étoit appliqué le lac de Moeris : Diodore de Sicile en parle à peu-
pres de la même manière. « Les débordemens du N il, dit Diodore, n'étant avan-
» tageux qu autant qu’ils gardent une certaine mesure , le lac de Moeris donnoit
» un écoulement aux eaux, lorsque leur abondance les faisoit séjourner dans les
” “ “ Pagnes. Ce lac, ajoute-t-il, subsiste encore aujourd’hui, et rend aux Évyp-
» tiens les mêmes services qu’autrefois (2). »
Mais il est remarquable que Pline, qui vivoit dans le premier siècle, ne dit
rien de ses avantages ni de son objet; il fkut croire qu’il avoit éprouvé de son
temps beaucoup d altération, puisque cet auteur en parle comme s’il n’existoit
déjà plus. Voici comme il s’exprime :
« Entre le nome d’Arsinoé et celui de Memphis, il y a eu un lac de deux cent
» cinquante mille pas de circuit, ou, suivant Mutien, de quatre cent cinquante
» nulle, et de cinquante pas de profondeur. Il est creusé de main d’homme, et
» appelé du nom du roi Moeris, qui i’avoit fait faire (3). » Et ailleurs : « Il y a une
» pyramide dans le nome Arsinoïte, deux dans celui de Memphis, non loin du
» labyrinthe. Il y en a autant dans le lieu où fu t le lac de Moeris (4 ). »
Pline étoit probablement mal instruit; et s’il eût voyagé en Egypte, il auroit
certainement vu ce lac : mais ce qu’il dit donne lieu de penser que les canaux de
communication s’étoient comblés par la négligence des gouverneurs de l’Egypte
et quil avoit perdu tous ses avantages ainsi qu’une grande partie de son étendue!
Pomponius Mêla, qui a écrit peu avant Pline, en parle d’une manière différente.
« L e lac de Moeris, dit-il, jadis une campagne, aujourd’hui un lac, de
n ™ dedépôK «>