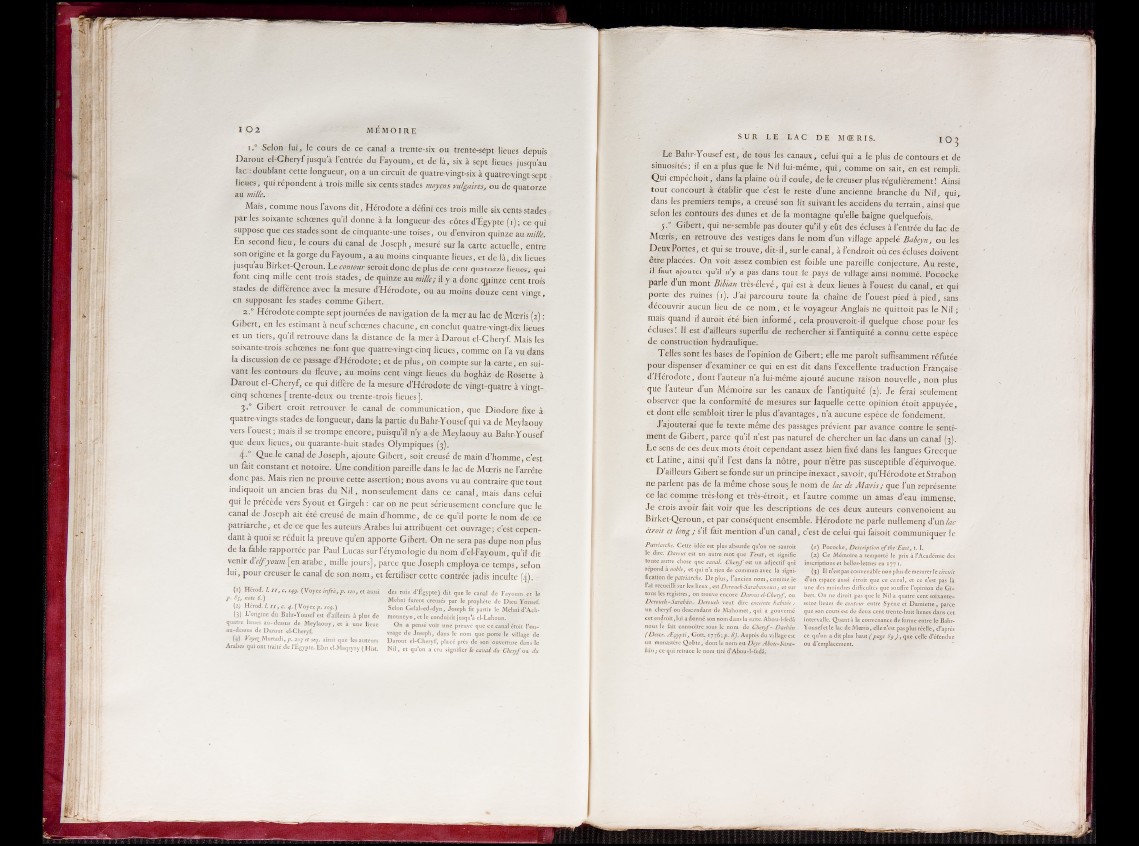
i.° Selon lui, le cours de ce canal a trente-six ou trente-sept lieues depuis
Darout el-Cheryf jusqua l’entrée du Fayoum, et de là, six à sept lieues jusqu’au
lac . doublant cette longueur, on a un circuit de quatre-vingt-six à quatre-vingt-sept
lieues, qui répondent a trois mille six cents stades moyens vulgaires, ou de quatorze
au mille.
Mais, comme nous 1 avons dit, Hérodote a défini ces trois mille six cents stades
par les soixante schoenes qu’il donne à la longueur des côtes d’Égypte (i); ce qui
suppose que ces stades sont de cinquante-une toises, ou d’environ quinze au mille.
En second lieu, le cours du canal de Joseph, mesuré sur la carte actuelle, entre
son origine et la gorge du Fayoum, a au moins cinquante lieues, et de là, dix lieues
jusqu’au Birket-Qeroun. L e contour seroit donc déplus de cent quatorze lieues, qui
font cinq mille cent trois stades, de quinze au mille; il y a donc qpinze cent trois
stades de différence avec la mesure d’Hérodote, ou au moins douze cent vingt,
en supposant les stades comme Gibert.
a.° Hérodote compte sept journées de navigation de la mer au lac de Moeris~(z) :
Gibert, en les estimant à neuf schoenes chacune, en conclut quatre-vingt-dix lieues
et un tiers, qu’il retrouve dans la distance de la mer à Darout el-Cheryf Mais les
soixante-trois schoenes ne font que quatre-vingt-cinq lieues, comme on l’a vu dans
la discussion de ce passage d’Hérodote; et de plus, on compte sur la carte, en suivant
les contours du fleuve, au moins cent vingt lieues du boghâz de Rosette à
Darout el-Cheryf, ce qui diffère de la mesure d’Hérodote de vingt-quatre à vingt-
cinq schoenes [trente-deux ou trente-trois lieuesl.
3.0 Gibert croit retrouver le canal de communication, que Diodore fixe à
quatre-vingts stades de longueur, dans la partie duBahr-Yousefqui va de Meylaouy
vers l’ouest ; mais il se trompe encore, puisqu’il n’y a de Meylaouy au Bahr-Yousef
que deux lieues, ou quarante-huit stades Olympiques (3).
4~° Que le canal de Joseph, ajoute Gibert, soit creusé de main d’homme, c’est
un fait constant et notoire. Une condition pareille dans le lac de Moeris ne l’arrête
donc pas. Mais rien ne prouve cette assertion; nous avons vu au contraire que tout
indiquoit un ancien bras du N i l , non-seulement dans ce canal, mais dans celui
qui le précède vers Syout et Girgeh : car on ne peut sérieusement conclure que le
canal de Joseph ait été creusé de main d’homme, de ce qu’il porte le nom de ce
patriarche, et de ce que les auteurs Arabes lui attribuent cet ouvrage; c’est cependant
à quoi se réduit la preuve qu’en apporte Gibert. On ne sera pas dupe non plus
de la fable rapportée par Paul Lucas sur l’étymologie du nom d’el-Fayoum, qu’il dit
venir iïelfyoum [en arabe, mille jours], parce que Joseph employa ce temps, selon
lui, pour creuser le canal de son nom, et fertiliser cette contrée jadis inculte (4). -
(1) Hérod. /. 1 1 , c. ,q9 . (V o y e z in fià .p . n e , et aussi des rois d’É gypte) dit que le canal de Fayou
S r n n t e /f A
' ‘ ' - OJt----J «p« variai ut iciyuiim. et It
P ' S> " ° ‘ r j ' Mehni furent creusés par le prophète de Dieu Yousef
, , V , 1 1 ’ c' f ‘ ( V o y e z p. /op.) Selon G ela l-ed -dyn, Joseph fit partir le Mehni d’Ach-
(3) L origine du Bahr-Yousef est d’ailleurs à plus de mouneyn, et le conduisit jusqu’à cl-Lahoun.
quatre lieues au-dessus de M e ylaou y, et à une lieue On a pensé voir une preuve que ce canal étoit l’ou-
au-dessus de Darout el-Cheryf. vrage de Joseph, dans le nom que porte le village de
(4) Voyei Murtadi, p . 20} e t seq. ainsi que les auteurs Darout el-C h ery f, placé près de son ouvetture dans le
Arabes qui ont traité de l’Egypte. Ebn el-Maqryzy { Hist. N i l , et qu’on a cru signifier le canal du Cheryf ou du
Le Bahr-Yousef est, de tous les canaux, celui qui a le plus de contours et de
sinuosités; il en a plus que le Nil lui-même, qui, comme on sait, en est rempli.
Qui empechoit, dans la plaine ou il coule, de le creuser plus régulièrement i Ainsi
tout concourt à établir que c’est le reste d’une ancienne branche du Nil, qui,,
dans les premiers temps, a creusé son lit suivant les accidens du terrain, ainsi que
selon les contours des dunes et de la montagne qu’elle baigne quelquefois.
5.0 Gibert, qui ne-semble pas douter qu’il y eût des écluses à l’entrée du lac de
Moeris, en retrouve des vestiges dans le.nom d’un village appelé Baleyn, ou les
Deux Portes, et qui se trouve, dit-il, sur le canal, à l’endroit où ces écluses doivent
etre placées. On voit assez combien est foible une pareille conjecture. Au reste,
il faut ajouter quil n y a pas dans tout le pays de village ainsi nommé. Pococke
parle dun mont Bibian très-élevé, qui est à deux lieues à l’ouest du canal, et qui
porte des ruines (1). J ai parcouru toute la chaîne de l’ouest pied à pied, sans
découvrir aucun lieu de ce nom, et le voyageur Anglais ne quittoit pas le Nil ;
mais quand il auroit été bien informé, celaprouveroit-il quelque chose pour les
eciuses Ml est d ailleurs superflu de rechercher si l’antiquité a connu cette espèce
de construction hydraulique.
Telles sont les bases de 1 opinion de Gibert ; elle me paroît suffisamment réfutée
pour dispenser d’examiner ce qui en est dit dans l’excellente traduction Française -
d Hérodote, dont 1 auteur n’a lui-même ajouté aucune raison nouvelle, non plus
que l’auteur d’un Mémoire sur les canaux de l’antiquité (2). Je ferai seulement
observer que la conformité de mesures sur laquelle cette opinion étoit appuyée,
et dont elle sembloit tirer le plus d’avantages, n’a aucune espèce de fondement.
J’ajouterai que le texte même des passages prévient par avance contre le sentiment
de Gibert, parce qu il nest pas naturel de chercher un lac dans un canal (3).
Le sens de ces deux mots étoit cependant assez bien fixé dans les langues Grecque
et Latine, ainsi qu’il l’est dans la nôtre, pour n’être pas susceptible d’équivoque.
D ’ailleurs Gibert se fonde sur un principe inexact, savoir, qu’Hérodote etStrabon
ne parlent pas de la meme chose sous.le nom de lac de A i cens ; que l’un représente
ce lac comme tres-long et très-étroit, et l’autre comme un amas d’eau immense.
Je crois avoir fait voir que les descriptions de ces deux auteurs convenoient au
Birket-Qeroun, et par conséquent ensemble. Hérodote ne parle nullement d’un lac
étroit et long; s’il fait mention d’un canal, c’est de celui qui faisoit communiquer le
(1) Pococke, Description o f the'Easi, t. I.
(2) C e Mémoire a remporté le prix à l’A cadémie des
inscriptions et belles'-lettres en 1771.
(3) Il n est pas convenable non plus de mesurer le circuit
dun espace aussi étroit que ce canal, et ce n’est pas là
une des moindres difficultés que souffre l’opinion de G ibert.
On ne diroit pas que le N il a quatre cent soixante-
seize lieues de contour entre Syène et D amiette, parce
que son cours est de deux cent trente-huit lieues dans cet
intervalle. Qu anta la convenance de forme entre le Bahr-
Y ousef et le lac de Moeris, elle n’est pas plus réelle, d’après
ce qu’on a dit plus haut ( page 8$ ) , que celle d’éfendue
ou d’emplacement.
Patriarche. Cette idée est plus absurde qu’on ne sauroit
le dire. Darout est un autre mot que Ter a t, et signifie
toute autre chose que canal. Cheryf est un adjectif qui
répond a noble} et qui n’a rien de commun avec la signification
de patriarche. D é p lu s , l’ancien nom, comme je
1 ai recueilli sur les lieu x, est Deroueh-Sarabamoun; et sur
tous les registres, on trouve encore Darout el-Cheryf, ou
Deroueh - Sarabân. ■ Deroueh veut dire enceinte habitée :
un cheryf ou descendant de Mahomet, qui a gouverné
cet endroit, lui adonné son nom dans la suite. Abou-l-fedâ
nous le fait connoître sous le nom de Cheryf - Darbân
( Descr. Ægypti, Gott. 1776 ; 77. 8) . Auprès du village est
un monastère Qob te, dont le nom est L)eyr Abou-Sara-
bân; ce qui retrace le nom tiré d’Abou-I-fedâ.