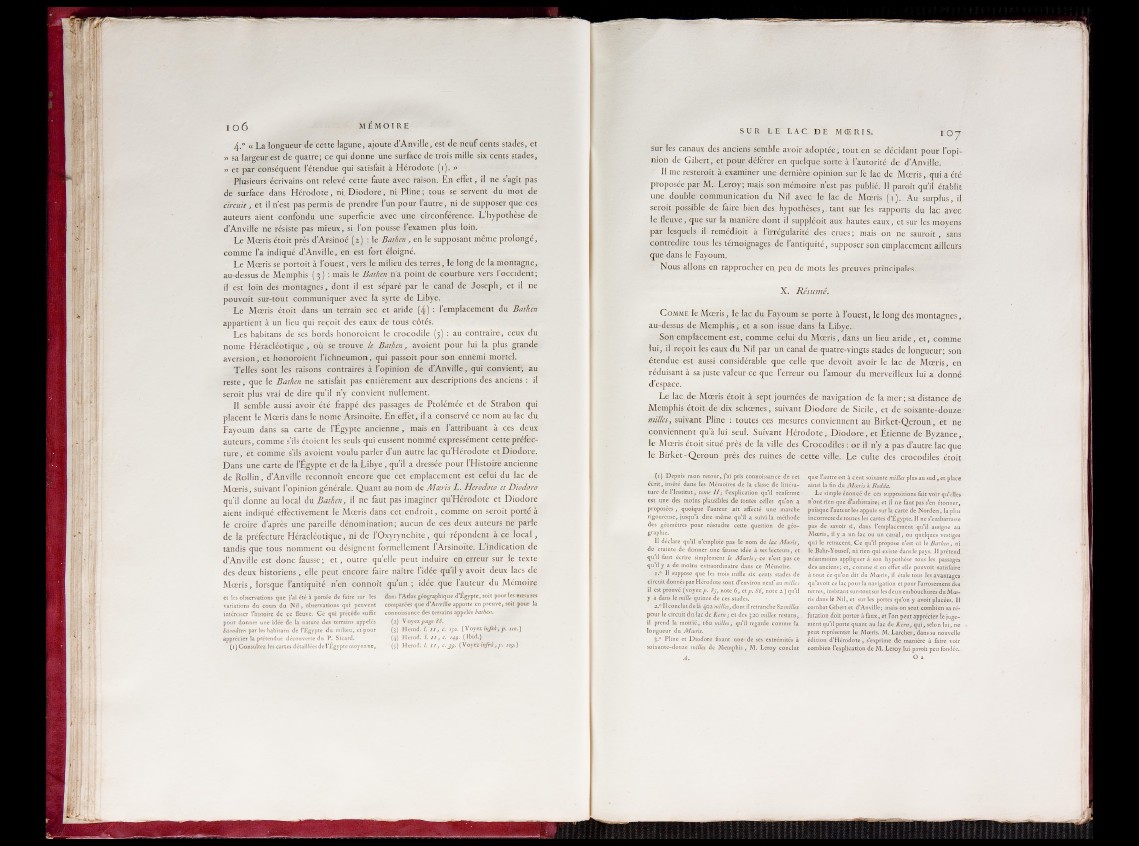
4 .° « La longueur de cette lagune, ajoute d’Anville, est de neuf cents stades, et
» sa largeur est de quatre; ce qui donne une surface de trois mille six cents stades,
» et par conséquent l’étendue qui satisfait à Hérodote (1). »
Plusieurs écrivains ont relevé cette faute avec raison. En effet, il ne s’agit pas
de surface dans Hérodote, ni. Diodore, ni Pline; tous se servent du mot de
circuit, et il n’est pas permis de prendre l’un pour l’autre, ni de supposer que ces
auteurs aient confondu une superficie avec une circonférence. L ’hypothèse de
d’Anville ne résiste pas mieux, si l’on pousse l’examen plus loin.
Le Moeris étoit près d’Arsinoé (2) : le Batien, en le supposant même prolongé,
comme l’a indiqué d’Anville, en est fort éloigné.
Le Moeris se portoit à l’ouest, vers le milieu des terres, le long de la montagne,
au-dessus de Memphis (3) : mais le Bathen n’a point de courbure vers l’occident;
il est loin des montagnes, dont il est séparé par le canal de Joseph, et il ne
pouvoit sur-tout communiquer avec la syrte de Libye.
Le Moeris étoit dans un terrain sec et aride (4 ) '• l’emplacement du Bathen
appartient à un lieu qui reçoit des eaux de tous côtés.
Les habitans de ses bords honoroient le crocodile (y) : au contraire, ceux du
nome Héracléotique , où se trouve le Bathen, avoient pour lui la plus grande
aversion, et honoroient l’ichneumon, qui passoit pour son ennemi mortel.
Telles sont les raisons contraires à l’opinion de d’Anville, qui convient-, au
reste, que le Bathen ne satisfait pas entièrement aux descriptions des anciens : il
seroit plus vrai de dire qu’il n’y convient nullement.
Il semble aussi avoir été frappé des passages de Ptolémée et de Strabon qui
placent le Moeris dans le nome Arsinoïte. En effet, il a conservé ce nom au lac du
Fayoum dans sa carte de l’Égypte ancienne , mais en l’attribuant à ces deux
auteurs, comme s’ils étoient les seuls qui eussent nommé expressément cette préfecture,
et comme s’ils avoient voulu parler d’un autre lac qu’Hérodote et Diodore.
Dans une carte de l’Égypte et de la L ibye , qu’il a dressée pour l’Histoire ancienne
de Rollin, d’Anville reconnoît encore que cet emplacement est celui du lac de
Moeris, suivant l’opinion générale. Quant au nom de Moeris L . Herodoto et Diodoro
qu’il donne au local du Bathen, il ne faut pas imaginer qu’Héro'dote et Diodore
aient indiqué effectivement le Moeris dans cet endroit, comme on seroit porté à
le croire d’après une pareille dénomination; aucun de ces deux auteurs ne parle
de la préfecture Héracléotique, ni de l’Oxyrynchite, qui répondent à ce local ,
tandis que tous nomment ou désignent formellement 1 Arsinoïte. L indication de
d’Anville est donc fausse; e t , outre qu’elle peut induire en erreur sur le texte
des deux historiens, elle peut encore faire naître l’idée qu’il y avoit deux lacs de
Moeris, lorsque l’antiquité n’en connoît qu’un; idee que 1 auteur du Mémoire
et les observations que j’ai été à portée de faire sur les dans l’Atlas géographique d’E gypte, soit pour les mesures
variations du cours du N i l , observations qui peuvent
intéresser l’histoire de ce fleuve. C e qui précède suffit
pour donner une idée de la nature des terrains appelés
baouâten par les habitans de l’Egypte du milieu, et pour
apprécier la prétendue découverte du P. Sicard.
(1) Consultez les cartes détaillées de l’Egypte moyenne,
comparées que d’Anville apporte en preuve, soit pour la
connoissance des terrains appelés bathen.
(2) V o y e z page 88.
(3) Herod. /. i l , c. 150. (V o y e z infrà, p. i/o.)
(4) Herod. /. i l , c. /+g. (Ibid.)
(5) Herod. I. 1 1 , c. jp . (V o y e z infrà, p . /op.)
S U R L E L A C D E MOER I S . \ O j
sur les canaux des anciens semble avoir adoptée ; tout en se décidant pour l’opinion
de Gibert, et pour déférer en quelque sorte à l’autorité de d’Anville.
Il me resteroit à examiner une dernière opinion sur le lac de Moeris, qui a été
proposée par M. Leroy; mais son mémoire n’est pas publié. Il paroît qu'il établit
une double communication du Nil avec le lac de Moeris ( i) . Au surplus, il
seroit possible de faire bien des hypothèses,. tant sur les rapports du lac avec
le fleuve, que sur la manière dont il suppléoit aux hautes eaux, et sur les moyens
par lesquels il remédioit à l’irrégularité des. crues ; mais on ne sauroit, sans
contredire tous les témoignages de l’antiquité, supposer son emplacement ailleurs
que dans le Fayoum.
Nous allons en rapprocher en peu de mots les preuves principales.
X. Résumé.
C o m m e le Moeris, le lac du Fayoum se porte à l’ouest, le long des montagnes,.
au-dessus de Memphis, et a son issue dans la Libye.
Son emplacement est, comme celui du Moeris, dans un lieu aride, et, comme
lui, il reçoit les eaux du Nil par un canal de quatre-vingts stades de longueur; son
étendue-est aussi considérable que ceîle que devoit avoir le lac de Moeris, en
réduisant à sa juste valeur ce que l’erreur ou l’amour du merveilleux lui a donné
d’espace.
Le lac de Moeris étoit à sept journées de navigation de la mer ; sa distance de
Memphis étoit de dix schoenes, suivant Diodore de Sicile, et de soixante-douze
milles, suivant Pline : toutes ces mesures conviennent au Birket-Qeroun, et ne
conviennent qua lui seul. Suivant Hérodote, Diodore, et Étienne de Byzance,,
le Moeris étoit situé près de la ville des Crocodiles : or il n’y a pas d’autre lac que
le Birkèt-Qeroun près des ruines de cette ville. Le culte des crocodiles étoit
que l’autre est à cent soixante milles plus au sud , et place
ainsi la fin du Moeris à Rodda.
L e simple énoncé de ces suppositions fait voir qu’elles •
n’ont rien que d’arbitraire; et il ne faut pas s’en étonner,
puisque l’auteur les appuie sur la carte de Norden, la plus
incorrecte de toutes les cartes d’Egypte. Il ne s’embarrasse
pas de savoir si, dans l’emplacement qu’il assigne au
Moeris, il y a un lac ou un canal, ou quelques vestiges
qui le retracent. C e qu’il propose n’est ni le Bathen, ni
le Bahr-Yousef, ni rien qui existe dans le pays. II prétend . j]
néanmoins appliquer à son hypothèse tous les passages
des anciens ; et, comme si en effet elle pouvoit satisfaire
à tout ce qu’on dit du Moeris, il étale tous les avantages
qu’avoit ce lac pour la navigation et pour I’arrosement des
terres, insistant sur-toutsur les deux embouchures du M oeris
dans le N i l , et sur les portes qu’on y avoit placées. II
combat Gibert et d’A nville ; .mais on sent combien sa réfutation
doit porter à faux, et l’on peut apprécier le juge- •
ment qu’il porte quant au lac de Kern, q u i, selon lui, ne *
peut représenter le Moeris. M. Larcher, dans sa nouvelle
édition d’H é rodote, s’exprime de manière à faire v o ir .
combien l’explication de M. Leroy lui paroît peu fon dée..
O a
(1) Depuis mon retour, j’ai pris connoissance de cet
éc rit, inséré dans les Mémoires de la classe de littérature
de l’Institut, tome I I ; l’explication qu’il renferme
est une des moins plausibles de toutes celles qu’on a
proposées , quoique l’auteur ait affecté une marche
rigoureuse, jusqu’à dire même qu’il a suivi la méthode
des géomètres pour résoudre cette question de géographie.
II déclare qu’il n’emploie pas le nom de lac Moeris,
de crainte de donner une fausse idée à ses lecteurs, et
qu’il faut écrire simplement le Moeris ; ce n’est pas ce
qu’il y a de moins extraordinaire dans ce Mémoire.
i.° II suppose que les trois mille six cents stades de
circuit donnés par Hérodote sont d’environ neuf au mille:
il est prouvé (voyez p. 8 j, note 6 , et/?. 86, note 2 ) qu’il
y a dans le mille quinze de ces stades.
2.0 II conclut de là 402 milles, dont il retranche 82 milles
pour le circuit du lac de Kern ; et des 320 milles restans,
il prend la moitié, 160 milles, qu’il regarde comme la
longueur du Moeris.
3.0 Pline et Diodore fixant une- de ses extrémités à
soixante-douze milles de Memphis, M. Leroy conclut