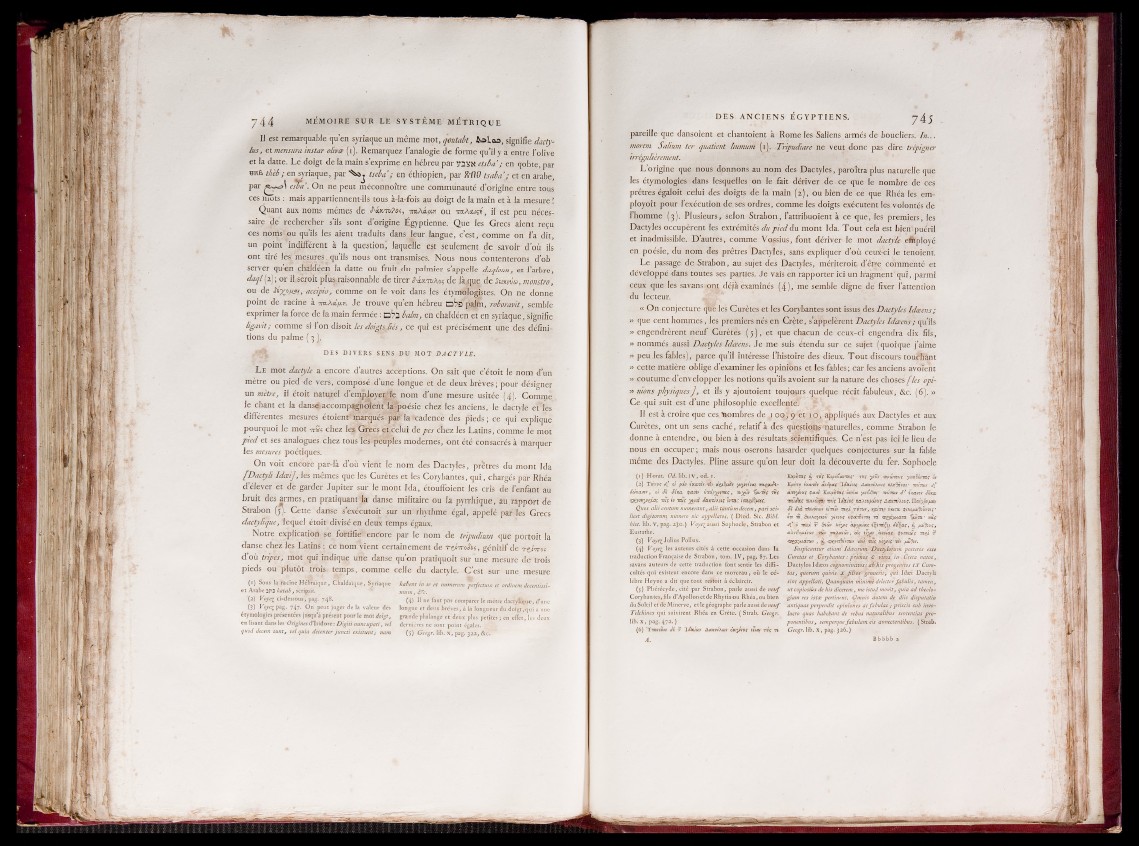
II est remarquable qu’en syriaque un même mot, qoutabt, £oloo, signifie dacty-
lus, et mensura instar ohvoe (i). Remarquez l’analogie de forme qu’il y a entre l’olive
et la datte. Le doigt de la main s’exprime en hébreu par y a s x etsba ; en qobte, par
otE thèb ; en syriaque, par tseba ; en éthiopien, par RilO tsaba’; et en arabe,
par jS p ||j esta'. On ne peut méconnoître une communauté d’origine entre tous
ces mots : mais appartiennent-ils tous à-la-fois au doigt de la main et à la mesure !
Quant aux noms mêmes de . .Eecx.TvA9è, TaAi/xr ou 7niAcciçii, il est peu nécessaire
de rechercher s’ils sont d’origine Égyptienne. Que les Grecs aient reçu
ces noms'ou qu’ils les aient traduits dans leur langue, c’est, comme on l’a dit,
un point indifférent à la question] laquelle est seulement de savoir d’où ils
ont tiré les mesures, qu’ils nous ont transmises. Nous nous contenterons d’ob
server qu’en chaÎdéeh la datte ou fruit du palmier s'appelle daqloun, et l’arbre,
daql (2), or il seroit p!us,raisonnable de tirer S^<L'x.rw\oq de laïque de Stixsuu, monst.ro,
ou de accipio, comme on le voit dans les étymologistes. On ne donne
point de racine à •/mAa/zii. Je trouve qu’en hébreu qGs palm, roboravit, semble
exprimer la force de la main fermée : balm, en chaldéen et en syriaque/signifie
ligavit; comme si 1 on disoit les doigte.liés, ce qui est précisément une des définitions
du palme ( 3 ).
DES DI V E R S SENS D U M O T D A C T Y L E .
L e mot dactyle a encore d’autres acceptions. On sait que c’étoit le nom d’un
mètre ou pied de vers, composé d’une longue et de deux brèves ; pour désigner
un metre, il étoit naturel cfempipyerMe nom d’une mesure usitée (4). Comme
le chant et la danse-accompagnoient lafpoésie chez les anciens, le dactyle efles
différentes mesures étoient’marqués par la cadence des pieds; ce qui explique
pourquoi le mot ■nSî chez les Grecs et.celui de pes chez les Latins, comme le mot
pied et ses analogues chez tous les peuples modernes, ont été consacrés à marquer
les mesures poétiques.
On voit encore par-là d’où vient le nom des Dactyles, prêtres du mont Ida
[Dactyli Idoei] , les mêmes que les Curètes et les Corybantes, qui, chargés par Rhéa
d’élever et de garder Jupiter sur le mont Ida, étouffoient les cris de l’enfant au
bruit des armes, en pratiquant la danse militaire ou la pyrrhique, au rapport de
Strabon (y). Cette danse s’exécutoit sur un rhythme égal, appelé par les Grecs
dactylique, lequel étoit divisé en deux temps égaux.
Notre explication se fortifie- encore par le nom de tnpudiuni que portoit la
danse chez les Latins : ce nom Vient certainement de relm-ohi, génitif de reim-ot
d’où tripes, mot qui indique une danse qu’on pratiquoit sur une mesure de trois
pieds ou plutôt trois temps, comme celle du dactyle. C ’est sur une mesure
(1) Sous la racine Hébraïque, Chaldaïque, Syriaque habent in se et numerum peifectuin et ordinem decmlusi-
et Arabe a ro katab, scripsit. muni t fc .
(2) Voyez ci-dessous, pag. 748. (4) I l ne faut pas comparer le mètre dacjÿjique, d’ iinc
(3) Eoprç pag. 747. On peut juger de la valeur des longue et deux brèves, à la longueur du doigt,qui a une
étymologies présentées jusqu’à présent pour le mot doigt, grande phalange et deux plus petites ; en effet, les deux
en lisant dansles Origines d'Isidore : Digiti nuncupati, vel dernières ne sont point égales.
qubd deeem sunt, vel quia decenter juncti existunt; nam (5) Geogr. lib. x , pag. 322, & c . '
pareille que dansoient et chantoient à Rome les Saliens armés de boucliers. In...
morern Solium ter quotient lumum (i). Tripudiare ne veut donc pas dire trépigner
irrégulièrement.
L ’origine que nous donnons au nom des Dactyles, paroîtra plus naturelle que
les étymologies dans lesquelles on le fait dériver de ce que le nombre de ces
prêtres égaloit celui des doigts de la main (2), ou bien de ce que Rhéa les em-
ployoit pour l’exécution de. ses ordres, comme les doigts exécutent les volontés de
l’homme (3). Plusieurs, selon Strabon, l’attribuoient à ce que, les premiers, les
Dactyles occupèrent les extrémités du pied du mont Ida. Tout cela est bien puéril
et inadmissible. D ’autres, comme Vossius, font dériver le mot dactyle efhployé
en poésie, du nom des prêtres Dactyles, sans expliquer d’où ceux-ci le tenoient.
Le passage de Strabon, au sujet des Dactyles, mériteroit d’être commenté et
développé dans toutes ses parties. Je vais en rapporter ici un fragment qui, parmi
ceux que les savans ont déjà examinés (4), me semble digne de fixer l’attention
du lecteur.
« On conjecture <pe les Curètes et les Corybantes sont issus des Dactyles Idoeens;
» que cent hommes, les premiers nés en Crète, s’appelèrent Dactyles Idoeens ; qu’ils
» engendrèrent neuf Curètes (y ) , et que chacun de ceux-ci engendra dix fils,
» nommés aussi Dactyles Idoeens. Je me suis étendu sur ce sujet (quoique j’aime
» peu les fables), parce qu’il intéresse l’histoire des dieux. Tout discours touchant
» cette matière oblige d’examiner les opinions et les fables; car les anciens avofent
» coutume d’envelopper les notions qu’ils avoient sur la nature des choses [les opi-
» nions physiques], et ils y ajoutoient toujours quelque récit fabuleux, &c. (6). »
Ce qui suit est d’une philosophie excellente.
Il est à croire que ces Nombres de ^ o q j 9 et 10, appliqués aux Dactyles et aux
Curètes, ont un sens caché, relatif à des qùestiojjs ¡naturelles, comme Strabon le
donne à entendre, ou bien à des résultats scientifiques. Ce n’est pas ici le lieu de
nous en occuper; mais nous oserons hasarder quelques conjectures sur la fable
même des Dactyles. Pline assure qu’on leur doit la découverte du fer. Sophocle
(1 ) Horat. Od. Iib, IV , od. l, v Kxpntuç ^ tîç KcpûCcarntç' tvç y>Zy <apâmvç yivnQiy’iitç ¿y
(2) TSfTHf efl 01 fAM ÎKCLTOY t t ï itg/G/W m.Çgt.Si- îqOHT» iKCLIty eUftyctÇ ’i j k / c t ç AcüCTV\0VÇ Xhlljtïvetl ■ 701)710Y J l
Ju>y.a<nv, oi S i SÎxa. tpanr ¿m p y o r ia ç , tv%7y fa r n iç n ç àm-)pvvç (paoi Kovpümç évita. ytvtSai •; tîvtuv </'* tKasov SÎyxl
fQÇ$my>Ztaç toiç îv t o iç y*pm SitKiv\oiç ovto; im.çji§p.vç. m7Sbtç 71 tbvç ï Sk iv ç üa.\ov[Urnç Acunv\ovç. Ilon ^»M V
Quos a l i i centum n u m e r c in t , alii tantiim decem, pari sci- Si Sia nMiovoy timlr mei 7Vtuy, Hsprnp «jus» ç/ao/*o9düm f
licet digitorum numéro sic a p p e l / u t o s . ( Diod. Sic. Bibl. otî Si Sto\oytKov yiïouç to co^iyu.am tguTo. • iniç
h i s t . Iib. V , pag. 230.) Voye^aussi Sophocle, Strabon et ¿1* ô r Sîû>k àojoç ap^kiaç i‘% t7uÇu Sifëctç, jÈ /¿ujovç,
Eustathe. - a.iYiHojutyaY ^tor mj^cueSy, aç tiyov èvvolaç çnmuaç srtgÀ t
(3) K çyej Ju liu s PoIIux. ‘Qçy.yueÎTTiiy , £ •©ejçj&VnüK ctti toiç \ôynç tov pZ%v.
(4) Ies auteurs cités à cette occasion dans la Suspicantur etiam Idæorum JDactylorum posteros esse
traduction Française de Strabon, tom. IV , pag. 87. Les Curetas et Corybantes : priihof C viros in Creta natos,
savans auteurs de cette traduction font sentir les diffi- Dactylos Idæos cognominatos; ab his progenitos IX Curecultés
qui existent encore dans ce morceau, où le ce- tas, quorum quivis x JHios: gehuerit, qui Idæi Dac tyli
Ièbre Heyne a dit que tout restoic à éclaircir. sint appellati. Quanquain minime delector fabulis, tamen,
(5) Phérécyde, cité par Strabon, parie aussi de neuf utcopiosiùs de his dicerem, me istud rnovit, quia ad t/ieolo-
Corybantes, fils d’Apollon et de Rhytia ou Rhéa, ou bien giam res istce pertinent. Cmnis autan de diis dispu ratio
du Soleil et de Minerve, et le géographe parle aussi de neuf antiquas perpendit opiniones ac fabulas ; priscis sub invo-
Telchines qui suivirent Rhéa en Crète. ( Strab. Geogr. lucro quas habebant de rebus naturalibus sententias prolib.
X, pag. 47-- ) ponentibus, semperque fabulam eis annectentibus. ( Strab.
(6) 'Xmyovn Si r iSkieor Acuov\ uy ¿k^pyvç tirai 7Vç 7* Geogr. lib. X, pag. 326.) '
^4' B b b b b |