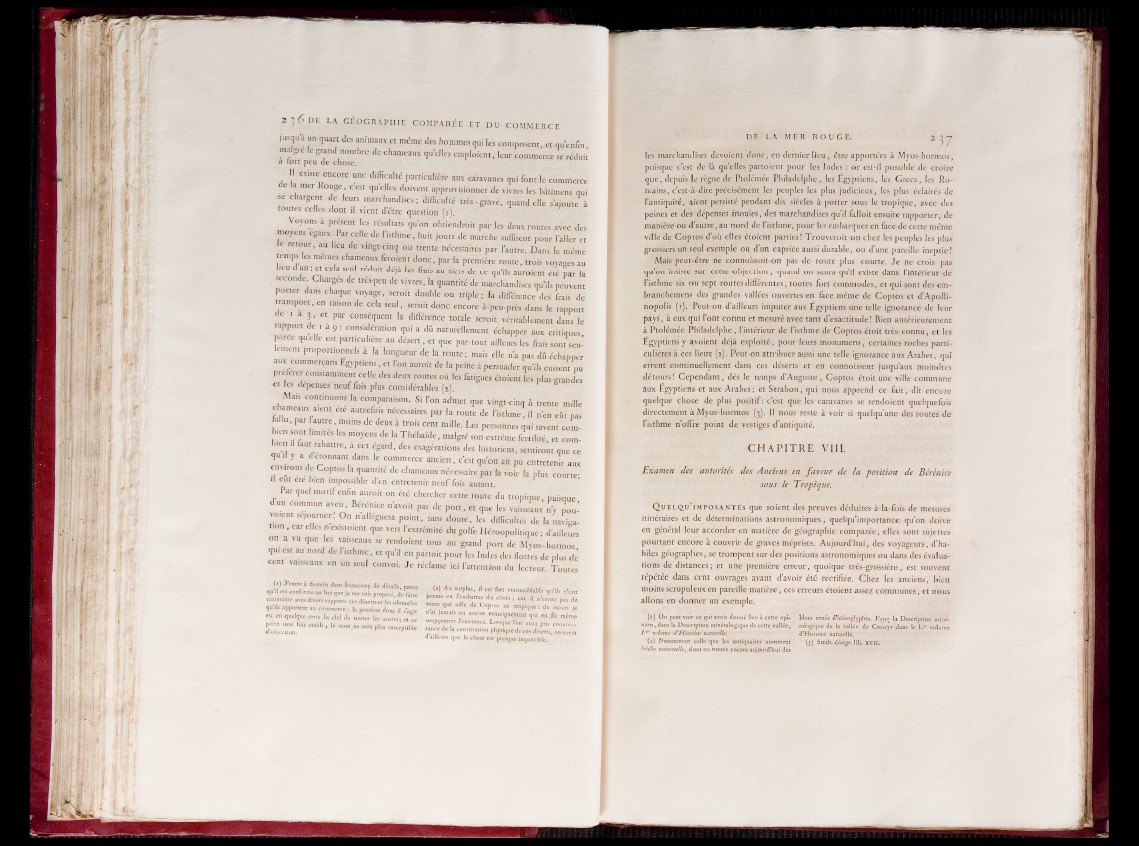
jusqu’à un quart des animaux et même dés hommes qui les composent, et qu'enfin
malgré le grand nombre de chameaux quelles emploient, leur commerce se réduit
a fort peu de chose.
Il existe encore une difficulté particulière aux caravanes qui font le commerce
e la mer Rouge cest quelles doivent approvisionner de vivres les bâtimens qui
,se chargent de leurs marchandises; difficulté très-grave, quand elle s’ajoute à
toutes celles dont il vient cl être question (i).
Voyons à présent les résultats qu’on obtiendroit par les deux routes avec des
moyens égaux Par celle de l’isthme, huit jours dé marche suffisent pour l’aller et
e retour, au heu de vingt-cinq ou trente nécessaires par l’autre. Dans le même
temps les memes chameaux feroient donc, par-la première route, trois voyages au
ieu dun, et cela seul redmt déjà les frais au tiers de ce qu’ils aüroient été par la
seconde Charges de très-peu de vivres, la quantité de marchandises qu’ils péuvent
porter dans chaque voyage, seroit double ou triple; la différence des frais de
transport, en raison de cela seul, seroit donc encore à-peu-près.dans le rapport
de . a 3 et par conséquent la différence totale seroit véritablement dans le
rapport de , a 9 : considération qui a dû naturellement échapper aux critiques
parce quelle est particulière au désert, et que par-tout ailleurs les frais sont seu-
ement proportionnels à la longueur de la route; mais elle n’a pas dû échapper
aux commerçai Egyptiens, et l’on auroit de la peine à persuader qu’ils eussent pu
pie erer constamment celle des deux routes où les fatigues étoient les plus grandes
et les dépenses neuf fois plus considérables (2).
Mais continuons la comparaison. Si l’on admet que vingt-cinq à trente mille
1 meaux aient ete autrefois nécessaires par la route de l’isthme, il n’en eût pas
fallu, par autre , moins de deux à trois cent mille. Les personnes qui savent combien
sont limites les moyens de la Thébaïde, malgré son extrême fertilité, et combien
,1 faut rabattre, a cet égard, des exagérations des historiens, sentiront que ce
fluil y a détonnant dans le commerce ancien, c’est qu’on ait pu entretenir aux
environs de Coptos la quantité de chameaux nécessaire par la voie la plus courte-
U eut ete bien impossible d’en entretenir neuf fois autant.
Par quel motif enfin auroit-on été chercher cette route du tropique puisque
dun commun aveu, Bérénice n’avoir pas de port, et que les vaisseaux n’y pou-
voient séjourner.' On n’alléguera point, sans doute, les difficultés de la navigation,
car elles nexistoient que vers l’extrémité du golfe Héroopolitique ; d’ailleurs
on a vu que es vaisseaux se rendoient tous au grand port de Myos-hormos
qu, est au nord de I isthme, et qu’il en partoit pour les Indes des flottes de plus dé
cent vaisseaux en un-seul convoi. Je réclame ici l’attention du lecteur. Toutes
j S Ê S Ê Ë Ê È Ê Ë Ê Ë Ê Ê p r o p o s ï ' d 1 1 ! ■ ( î - A “ 5,“ ' P,US’ " “ f0rt vraisemI>Iabïe qu’ils n’ont
connoître sons divers \ Z " | S *
point une fois é tab li, le reste ne se « 1 s , u I b I I’cx,s,ente. Lorsque l’on aura pris connnis-
d ’objection. 3 Pl“ ! SUSCepUble ^ n.ce constitution physique de ces déserts, on verra
d ailleurs que la chose est presque impossible.
les marchandises dévoient donc, en dernier lieu, être apportées à Myos-hormos,
puisque c’est de là qu’elles partoient pour les Indes : or est-il possible de croire
que, depuis le règne de Ptolémée Philadelphe, les Egyptiens, les Grecs, les Romains,
c’est-à-dire précisément les peuples les plus judicieux, les plus éclairés de
l’antiquité, aient persisté pendant dix siècles à porter sous le tropique, avec des
peines et des dépenses inouies, des marchandises qu’il falloit ensuite rapporter, de
manière ou d’autre, au nord de l’isthme, pour les embarquer en face de cette même
ville de Coptos d’où elles étoient parties! Trouveroit-on chez les peuples les plus
grossiers un seul exemple ou d’un caprice aussi durable, ou d’une pareille ineptie!
Mais peut-être ne connoissoit-on pas de route plus courte. Je ne crois pas
qu’on insiste sur cette objection, quand on saura qu’il existe dans l’intérieur de
l’isthme six ou sept routes différentes, toutes fort commodes, et qui sont des ern-
branchemens des grandes vallées ouvertes en face même de Coptos et d’Apolli-
nopolis (i). Peut-on d’ailleurs imputer aux Égyptiens une telle ignorance de leur
pays, à eux qui l’ont connu et mesuré avec tant d’exactitude! Bien antérieurement
à Ptolémée Philadelphe, l’intérieur de l’isthme de Coptos étoit très-connu, et les
Égyptiens y avoient déjà exploité, pour leurs monumens, certaines roches particulières
à ces lieux (2). Peut-on attribuer aussi une telle ignorance aux Arabes, qui
errent continuellement dans ces déserts et en connoissent jusqu’aux moindres
détours! Cependant, dès le temps d’Auguste , Coptos étoit une ville commune
aux Égyptiens et aux Arabes; et Strabon, qui nous apprend ce fait, dit encore
quelque chose de plus positif: c’est que les caravanes se rendoient quelquefois
directement à Myos-hormos (3}. Il nous reste à voir si quelqu’une des routes de
l’isthme n’offre point de vestiges d’antiquité.
C H A P I T R E VIII.
Examen des autorités des Anciens en faveur de la ■position de Bérénice
sous le Tropique.
Q u e l q u ’im po san t e s que soient des preuves déduites à-la-fois de mesures
itinéraires et de déterminations astronomiques, quelqu’importance qu’on doive
en général leur accorder en matière de géographie comparée, elles sont sujettes
pourtant encore à couvrir de graves méprises. Aujourd’hui, des voyageurs, d’habiles
géographes, se trompent sur des positions astronomiques ou dans des évaluations
de distances; et une première erreur, quoique très-grossière, est souvent
répétée dans cent ouvrages avant d’avoir été rectifiée. Chez les anciens, bien
moins scrupuleux en pareille matière, ces erreurs étoient assez communes, et nous
allons en donner un exemple.
(1) On peut voir ce qui avoit donné lien à cetre opi- blocs ornés d’hiéroglyphes. Ÿoye^ la Description miné-
nion, dans la Description minéralogique de cette vallée, «logique de la vallée de Cosseyr dans le volume
volume d ’Histoire naturelle. d’Hîstoire naturelle.
(2) Notamment celle que tes antiquaires nomment (3) Strab. Geogr. Iib. XVII.
triche universelle, dont on trouve encore aujourd’hui des