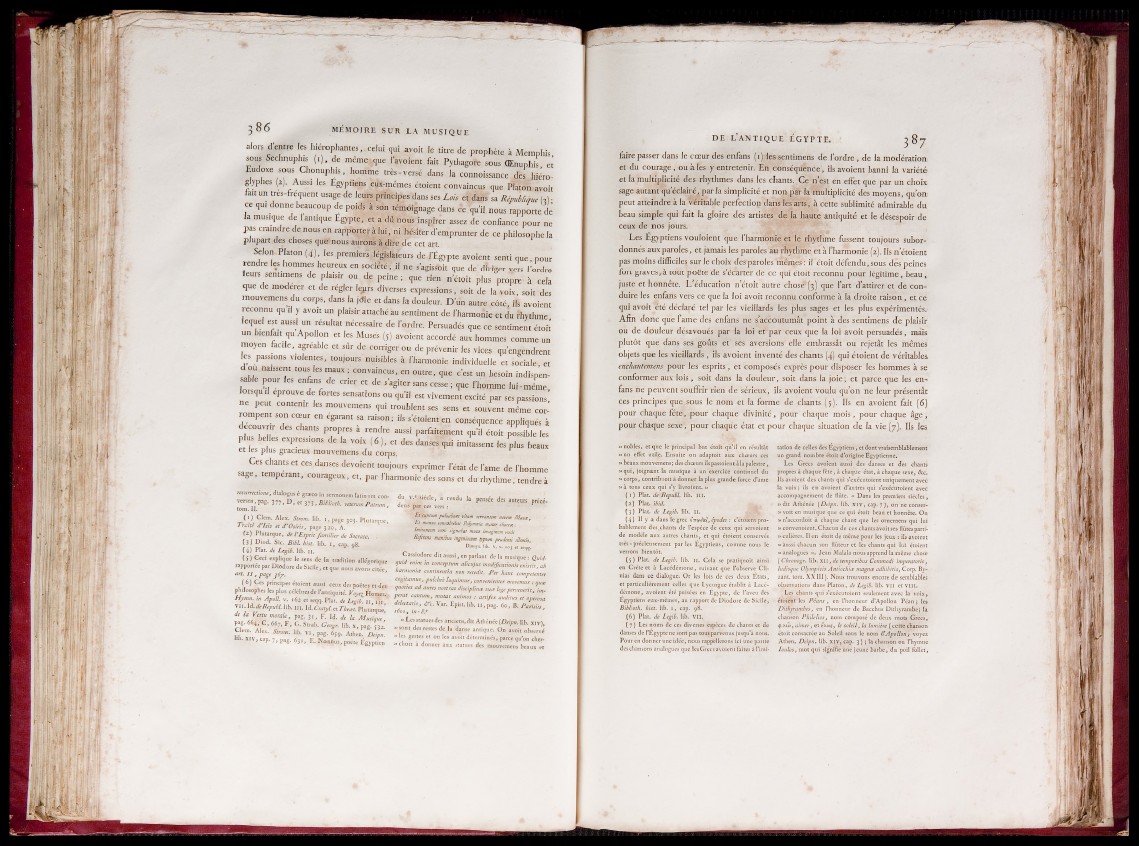
M É M O I R E S U R L A M U S I Q U E
alors d entre les hiérophantes, celui qui avoit le titre de prophète à Memphis
sous Sechnuphis (i), de même .que l’avoient fait Pythagore sous GEnuphis et
Eudoxe sous Chonuphis, homme très-versé dans la connoissance des hiéroglyphes
(2) Aussi les Egyptiens eux-mêmes étoient convaincus que Platon avoit
fart un tres-fréquent usage de leurs principes dans ses Lois et dans sa République (A •
ce qui donne beaucoup de poids à son témoignage dans ce qu’il, nous rapporte dé
la musique de 1 antique Egypte, et a dû nous inspirer assez de confiance pour ne
pas craindre de nous en rapportera lui, ni hésiter d'emprunter de ce philosophe la
plupart des choses que nous aurons à dire de cet art.
Selon Platon (4), les premiers^¿isJaèurs de l’Egypte avoient senti que, pour
rendre les hommes heureux en société? il ne s’agisSbit que de diriger vers l’ordre
leurs senumens de plaisir ou de peine ; que rien n’étoit plus propre à cela
que de modérer et de régler leprs diverses expressions, soit de la voix soit des
mouvemens du corps, dans la jâie et dans la douleur. D ’un autre côté, ils avoient
reconnu qui! y avoit un plaisir attaché au sentiment de l’harmonie et du rhythme
lequel est aussi un résultat nécessaire de l’ordre. Persuadés que ce sentiment étoit
un bienfait qu Apollon et les Musés (5) avoient accordé aux hommes comme un
moyen fiicile, agreable et sûr de comger ou de prévenir les vices qu’engendrent
les passions violentes, toujours nuisibles à l'harmonie individuelle et sociale et
dou naissent tous les maux ; convaincus, en outre, que c’est un besoin indispen-
able pour les enfans de crier et de s’agiter sans cesse; que l’homme lui-même
lorsqud éprouvé de fortes sensations ou qu’il est vivement excité par ses passions
ne peut contenir, les mouvemens qui troublent ses sens et souvent même cor,’
rompent son coeur en égarant sa raison; iis s’étoient en conséquence appliqués à
découvrir des chants propres à rendre aussi parfaitement qu’il étoit possible les
plus be les expressions de la voix (6 ) , et des danses qui imitassent les plus beaux
et les plus gracieux mouvemens du corps.
Ces chants et ces danses devoient toujours exprimer l’état de l’ame de l’homme
sage, tempérant, courageux, et, par (’harmonie des sons et du rhythme, tendre à
resurrectione, dialogus è græco in sermonem latinum conv
en u s, pag. 377» et 373 > Biblioth. veterum Patrum .
tom. II.
(0 Clem. A lex . Strom. Iib. i , page 303. Plutarque,
Traite d ’Isis et dfOsiris, page 320, A.
(2) Plutarque, de l'Esprit familier de Socrate. .
( 3) D iod . Sic. Bibl. hist. Iib. 1 , cap. 98.
( 4) Plat, de Legib. Iib. II.
( i ) Ce c i explique le sens de la tradition allégorique
rapportée par D iodore de S ic ile, et que nous avons citée
art. I I , page 367.
(6 ) Ces principes étoient aussi ceux des poëtes'et des
philosophes les plus célèbres de l’antiquité. Voyr, Homer,
Hymn, in Apoll. v. 162 et seqq. Plat, de Legib. I l , j f i ,
V l l . ld . de fiepubl. Iib. III. Id. Cralyl. et Tlieoet. Plutarque!
de la Venu morale, pag. 3 1 , F. Id. de la Musique
pag. 664, C , 667, F , G. Strabi Ceogr. Iib. x , pag. 53a.
Clem. Aie s . Strom. Iib. V I , pag. 659. Athen. Deipn.
X IV , cap. 7 , pag. 631, F.. Nonnus, poète Égypiien
t*u V.c siècle, a rendu la pensée des auteurs précé-
dens .par ces vers : \ vT--
E t çantum pulsabant vitam servantem novem A I usa,
Et manus convolvehat Polymnia maur chorece :
Jmitantem vero signalai muta imaginem vocis
Referais manibus ingeniosum typum prudenti sllentio.
Dionys. Iib. v, v. 103 et seqq.
Cassiodorc dit aussi, en parlant de la musique: QÜid-
quid enim in conceptum alicujus modificationis enistit, a i
hannonioe comment,a non recedit. Per hanc competenter
cogitamus, pulchrè loquimur, convenienter movetnur : qu/e
quoties ad aures nostras disciplina, su/e lege pervenerit, itaperai
cantum, mutât animos : artifex auditus et operosa
delectatio, ¿te. Var. Epist. Iib. I I , pag. 60, B. Parisiis
1600, in-8.°
« Les statues des anciens, dit Athénée [Deipn, Iib. x iv ) ,
»sont des restes de la danse antique. On avoit observé
» les gestes et on les avoit déterminés , parce qu’on cher-
» choit à donner aux statues des mouvemens beaux et
faire passer dans le coeur des enfans (i)lessentimens de l’ordre, de la modération
et du courage , ou à les y entretenir. En conséquence', iis avoient banni la variété
et la multiplicité des rhythmes dans les chants. Ce n’est en effet que par un choix
sage autant qu’éclairé^ par la simplicité et non par la multiplicité des moyens, qu’om
peut atteindre à la véritable perfection dans les arts, à cette sublimité admirable du
beau simple qui fait la gloire des artistes de la haute antiquité et le désespoir de
ceux de nos jours.
Les Égyptiens vouloient que l’harmonie et le rhythme fussent toujours subordonnés
aux paroles, et jamais les paroles au rhythme et à l’harmonie (2). Iis n’étoient
pas moins difficiles sur le choix des'paroles niêmes : il étoit défendu, sous dés peines
fort graves,.à tout poëte de s’écarter de ce qui étoit reconnu pour légitime, beau,,
juste et honnête. L ’éducation n’était autre chosè1^) que l’art d’attirer et de conduire
les enfans vers ce que la loi avoit reconnu conforme à la droite raison, et ce
qui avoit été déclaré tel par les vieillards les plus sages et les plus expérimentés..
Afin donc que 1 ame des enfans ne s’accoutumât point à des sentimens de plaisir
ou de douleur désavoués par la loi et’ par ceux que la loi avoit persuadés, mais
plutôt que dans ses goûts et ses aversions elle embrassât ou rejetât les mêmes
objets que les vieillards, ils avoient inventé des chants (4) qui étoient de véritables
ençhantemens pour les esprits, et composés exprès pour disposer les hommes à se
conformer aux lois, soit dans la douleur, soit dans la joie; et parce que les enfans
ne peuvent souffrir rien de sérieux, ils avoient voulu qu’on ne leur présentât
ces principes que^sous le nom et la forme de chants (y). Iis en avoient fait (6)
pour chaque fête*, pour chaque divinité, pour chaque mois, pour chaque âge ,
pour chaque sexe, pour chaque état et pour chaque situation de la vie (7). Ils les
»nobles, et que le principal but étoit qu’il en résultât
» u n effet utile. Ensuite on adaptoit aux choeurs ces
» beaux mouvemens; des choeurs ils passoient à la palestre,
» qui, joignant la musique à un exercice continuel du
» corps, contribuoit à donner la plus grande force d’ame
» à tous ceux qui s’y livroiènt. »
( 1 ) Plat. de Republ, Iib. III.
(2 ) Plat. ibid.
( 3 ) Plat, de Legib. Iib. i l .
( 4) II y a dans le grec iiruxhtf, êpodes : c’étôient probablement
des,chants de l’espèce de ceux qui servoient
de modèle aux autres chants, et qui étoient conservés
très - précieusement par les Egyptiens, comme nous le
verrons bientôt.
(5 ) Plat, de Legib. Iib. 11. Ce la se pratiquoit ainsi
en Crète et à Lacédémone, suivant que l’observe Cli-
nias dans ce dialogue. O r les lois de ces deux États,
et particulièrement celles que Lycurgue établit à Lacédémone,
avoient été puisées en Egypte, de l’aveu des
Egyptiens eux-mêmes, au rapport de Diodore de Sic ile,
Biblioth, hist, lib. i , cap. 98.
(6 ) Plat, de Legib. Iib. v i l .
( 7 ) Les noms de ces diverses espèces de chants et de
danses de l’E gypte ne sont pas tous parvenus jusqu’à nous.
Pour en donner une idée, nous rappellerons ici une partie
des chansons analogues que les Grecs avaient faites à l’ imitation
de celles des Égyptiens, et dont vraisemblablement
un grand nombre étoit d’origine Égyptienne.
Les Grecs avoient aussi des danses et des chants
propres à chaque fete , à chaque état, à chaque sexe, &c:
Ils avoient des chants qui s’exécutoient uniquement avec
la vo ix ; ils en avoient d’autres qui s’exécütoîent avec
accompagnement de flûte. « Dans les premiers siècles,
» d it Athénée [Deipn. lib. X IV , cap. 7 ) , on ne conser-
» voit en musique que ce qui étoit beau et honnête. On
» n'accordoit à chaque chant que les ornemens qui lui
» cônvenoient, Chacun de ces chants avoit ses flûtes parti-
» culières. Il en étoit de même pour les jeux : ils avoient
»aussi chacun son flûteur et les chants qui lui étoient
» analogues ». Jean Malala nous apprend la même chose
( Chronogr. Iib. X I I , de temporibus Commodi imperatoris,
ludisque Olympicis Antiochioe magnee ad h ü> iris, Corp. By-
zant. tom. X X I I I ) . Nous trouvons encore de semblables
observations dans Platon, de Legib. lib. V II et V I I I .
Les chants qui s’exécutoient seulement avec la v o ix ,
étoient les Péans , en l’honneur d ’Apollon Péan ; les
Dithyrambes, en l’honneur de Bacchiis Dithyrambe; là
chanson Philelios, nom composé de deux mots Grecs,
aimer, et ha/oc, le soleil, la lumière (cette chanson
étoit consacrée au Soleil sous le nom d’Apollon; voyez
Athen. Deipn. lib. XIV, cap. 3 ) ; la chanson ou l’hymne
Ioiilos,'mot qui signifie une jeune barbé, du poil follet,