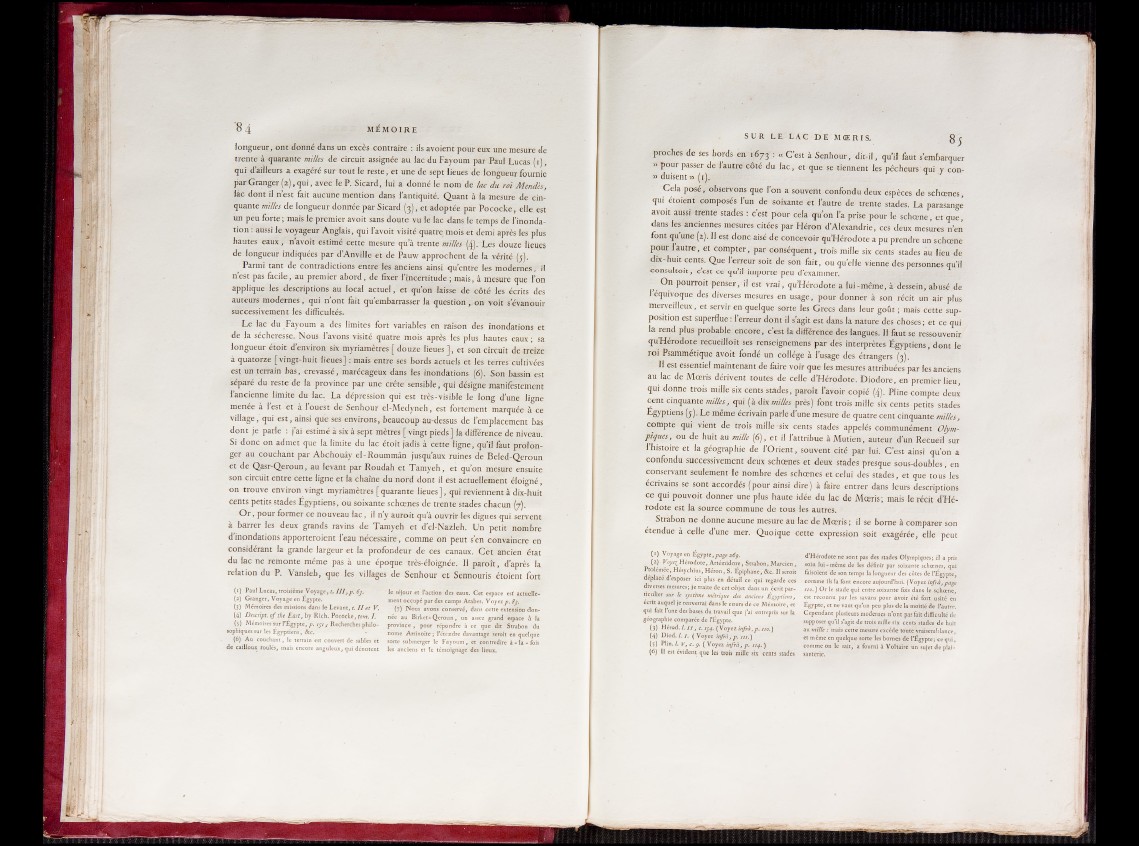
longueur, ont donné dans un excès contraire : ils avoient pour eux une mesure de
trente à quarante milles de circuit assignée au lac du Fayoum par Paul Lucas ( i ) ,
qui d’ailleurs a exagéré sur tout le reste, et une de sept lieues de longueur fournie
par Granger (a), qui, avec le P. Sicard, lui a donné le nom de lac du roi Mendès,
lac dont il n’est fait aucune mention dans l’antiquité. Quant à la mesure de cinquante
milles de longueur donnée par Sicard (3), et adoptée par Pococke, elle est
un peu forte ; mais le premier avoit sans doute vu le lac dans le temps de l’inondation
. aussi le voyageur Anglais, qui 1 avoit visite quatre mois et demi après les plus
hautes eaux, n’avoit estimé cette mesure qua trente milles (4 ). Les douze lieues
de longueur indiquées par d’Anville et de Pauw approchent de la vérité M ,
Parmi tant de contradictions entre les anciens ainsi qu’entre les modernes, il
n’est pas facile, au premier abord, de fixer l’incertitude ; mais, à mesure que l’on
applique les descriptions au local actuel, et qu’on laisse de côté les écrits des
auteurs modernes, qui n’ont fait qu’embarrasser la question, on voit s’évanouir
successivement les difficultés.
Le lac du Fayoum a des limites fort variables en raison des inondations et
de la sécheresse. Nous l’avons visité quatre mois après les plus hautes eaux; sa
longueur étoit d’environ six myriamètres [ douze lieues ], et son circuit de treize
à quatorze [vingt-huit lieues] : mais entre ses bords actuels et les terres cultivées
est un terrain bas, crevassé, marécageux dans les inondations (6). Son bassin est
sépare du reste de la province par une crête sensible, qui désigne manifestement
l’ancienne limite du lac. La dépression qui est très-visible le long d’une ligne
menée à l’est et à l’ouest de Senhour el-Medyneh, est fortement marquée à ce
village, qui est, ainsi que ses environs, beaucoup au-dessus de l’emplacement bas
dont je parle : j’ai estimé à six à sept mètres [vingt pieds] la différence de niveau.
Si donc on admet que la limite du lac étoit jadis à cette ligne, qu’il faut prolonger
au couchant par Abchouây el-Roummân jusqu’aux ruines de Beled-Qeroun
et de Qasr-Qeroun, au levant par Roudah et Taniyeh, et qu’on mesure ensuite
son circuit entre cette ligne et la chaîne du nord dont il est actuellement éloigné,
on trouve environ vingt myriamètres [quarante lieues], qui reviennent à dix-huit
cents petits stades Egyptiens, ou soixante schoenes de trente stades chacun (7).
O r , pour former ce nouveau lac, il n y auroit qu’à ouvrir les digues qui servent
à barrer les deux grands ravins de Tamyeh et d’el-Nazieh. Un petit nombre
d inondations apporteroient l’eau nécessaire, comme on peut s’en convaincre en
considérant la grande largeur et la profondeur de ces canaux. Cet ancien état
du lac ne remonte même pas à une époque très-éloigpée. Il paroît, d’après la
relation du P. Vansleb, que les villages de Senhour et Sennouris étoient fort
le séjour et l'action des eaux. Cet espace est' actuellement
occupé par des camps Arabes. V o y e z p. 83.
(7) Nous avons conservé, dans cette extension donnée
au B irk e t-Q e ro u n , un assez grand espace à la
province , pour répondre à ce que dit Strabon du
nome Arsinoîte ; l’étendre davantage serait en quelque
sorte submerger le F a y oum, et contredire à - l a - f o i s
les anciens et le témoignage des lieux.
(1) Paul Lucas, troisième V o y ag e, t. I I I , p . 63.
(2) Granger, Voyage en Egypte.
(3) Mémoires des missions dans le Levant, t. I I et V.
(4) Descript, o f the Ea st, b y Rich. Pococke, tom. I.
(5) Mémoires sur l'Egypte,/?. 131; Recherches philosophiques
sur les Egyptiens, & c .
(6) A u couchant, le terrain est couvert de sables et
de cailloux roulés, mais encore anguleux, qui dénotent
proches de ses bords en 1673 ; « C ’est à Senhour, dit-il, qu’il faut s’embarquer
» pour passer de l’autre côté du lac, et que se tiennent les pêcheurs qui y con-
» duisent» (1).
Cela posé, observons que l’on a souvent confondu deux espèces de schoenes,
qui étoient composés l’un de soixante et l’autre, de trente stades. La parasange
avoit aussi trente stades : c’est pour cela qu’on l’a prise pour le schoene, et que,
dans les anciennes mesures citées par Héron d’Alexandrie, ces deux mesures n’en
font qu une (2). II est donc aisé de concevoir qu’Hérodote a pu prendre un schoene
pour 1 autre, et compter, par conséquent, trois mille six cents stades au lieu de
dix-huit cents. Que l’erreur soit de son fait, ou qu’elle vienne des personnes qu’il
consultoit, c est ce quil importe peu d’examiner.
® Pourro*t penser, il est vrai, qu’Hérodote a lui-même, à dessein, abusé de
I équivoque des diverses mesures en usage, pour donner à son récit un air plus
merveilleux, et servir en quelque sorte les Grecs dans leur goût ; mais cette supposition
est superflue : l’erreur dont il s’agit est dans la nature des choses; et ce qui
la rend plus probable encore, c’est la différence des langues. II faut se ressouvenir
qu’Hérodote recueilloit ses renseignemens par des interprètes Égyptiens, dont le
roi Psammétique avoit fondé un collège à l’usage des étrangers (3).
Il est essentiel maintenant de faire voir que les mesures attribuées par les anciens
au lac de Moeris dérivent toutes de celle d’Hérodote. Diodore, en premier lieu,
qui donne trois mille six cents stades, paroît l’avoir copié (4). Pline compte deux
cent cinquante milles, qui (à dix milles près) font trois mille six cents petits stades
Égyptiens (5). L e meme écrivain parle d’une mesure de quatre cent cinquante milles,
compte qui vient de trois mille six cents stades appelés communément Olympiques,
ou de huit au mille (6), et il l’attribue à Mutien, auteur d’un Recueil sur
l’histoire et la géographie de l’O rient, souvent cité par lui. C ’est ainsi qu’on a
confondu successivement deux schoenes et deux stades presque sous-doubles, en
conservant seulement le nombre des schoenes et celui des stades, et que tous les
écrivains se sont accordés (pour ainsi dire) à faire entrer dans leurs descriptions
ce qui pouvoit donner une plus haute idée du lac de Moeris; mais le récit d’Hérodote
est la source commune de tous les autres.
Strabon ne donne aucune mesure au lac de Moeris ; il se borne à comparer son
etendue à celle dune mer. Quoique cette expression soit exagérée, elle peut
( ! ) Voyage en Egypte, pagentfp. d’Hérodote ne sont pas des stades Olympiques; il a pris
p y , érodote, Artemidore, Strabon, Marcien , soin lui-même de les définir par soixante schoenes, qui
to emee, ésychius, Héron, S . Épiphane, & c . II serait fàisoient de son temps la longueur des côtes de I’É gypte,
déplacé d exposer ici plus en détail ce qui regarde ces comme ils la font encore aujourd'hui. (Vo y e z infrà , page
iverses mesures, je traite de cet objet dans un écrit par- n o .) O r le stade qui entre soixante fois dans le schoene,
ticulier sur le système métrique des anciens Égyptiens, est reconnu par les savans pour avoir été fort usité en
ecnt auquel je renverrai dans le cours de ce Mémoire, et Egypte, et ne vaut qu’un peu plus de la moitié de l'autre,
qui fait l’une des bases du travail que j’ai entrepris sur la Cependant plusieurs modernes n’ont pas fait difficulté de
géographie comparée de l’Egypte. _ supposer qu’il s'agit de trois mille six cents stades de huit
(3) Hérod. 1. 1 1 , c. 134. ( V oyez in fr a ,p . i/o.) au m ille : mais cette mesure excède toute vraisemblance,
(4) Diod. /. 1 . ( Voyez in frà , p . ///.) et même en quelque sorte les bornes de l’É gypte; ce qüi,
(5) Phn. I. v , c. 3. ( V oyez infrà, p. 114. ) comme on le sait, a fourni à Voltaire un sujet de plai-
(o) II est évident que les trois mille six cents stades santerie.