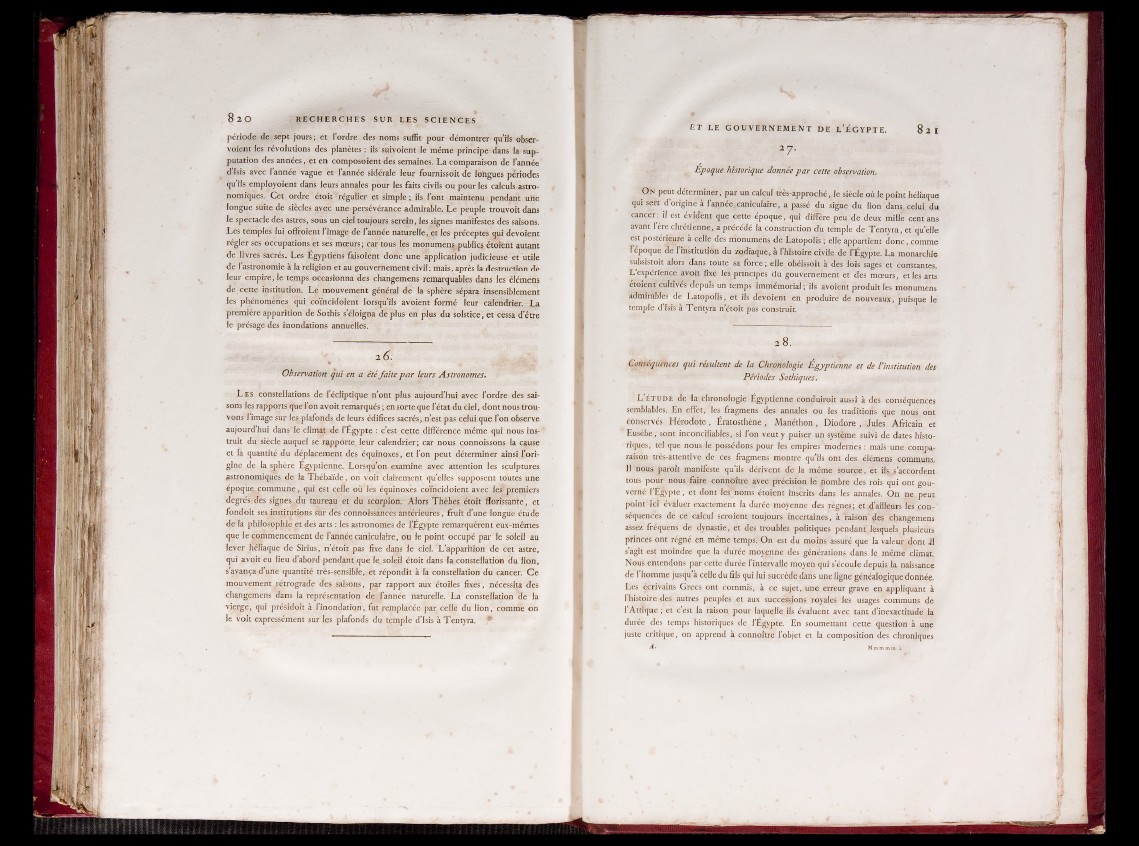
période de .sep t jours; et i’ordre des noms suffit pour démontrer qu’ils obser-
voient les révolutions des planètes ; ils suivoient le même principe dans la supputation
des années, et en composoient des semaines. L a comparaison de l’année
d Isis avec 1 année vague et l’année sidérale leur fournissoit de longues périodes
qu’ils employoient dans leurs annales pour les faits civils ou pour les calculs astronomiques.
C e t ordre étoit? régulier et simple; ils .l’ont maintenu pendant une
longue suite de siècles avec une persévérance admirable. L e peuple trouvoit dans
le spectacle des astres, sous un ciel toujours serein, les signes manifestes des saisons.
Le s temples lui offraient I image de 1 année naturelfe, et les préceptes qui de voient
régler ses occupations et ses moeurs; car tous les monumens.publics étoient autant
de livres sacrés. Les Egyptiens faisoient donc une application judicieuse et utile
dé l’astronomie à la religion et au gouvernement civil ; mais, après la destruction de
leur empire, le temps occasionna des changemens remarquables dans les élémens
de cette institution. L e mouvement général de la sphère sépara insensiblement
les phénomènes qui coïncidoient lorsqu’ils avoient formé leur calendrier. L a
première apparition de Sothis s’éloigna de plus en plus du solstice, et cessa d’être
le présage des inondations annuelles.
z6.
Observation q u i en a été fa ite p a r leurs Astronomes.
L e s constellations de l’écliptique n’ont plus aujourd’hui avec l’ordre des saisons
les rapports que l’on avoit remarqués ; en sorte que l’état du ciel, dont nous trouvons
1 image sur les plafonds de leurs édifices sacrés, n’est pas celui que l’on observe
aujourdhui dans le climat de l’Egypte : c’est cette différence même qui nous instruit
du siècle auquel se rapporte leur calendrier; car nous connoissons la cause
et la quantité du déplacement des équinoxes, et l’on peut déterminer ainsi l’origine
de la sphère Égyptienne. Lorsqu’on examine avec attention les sculptures
astronomiques de la Thébaïde , on voit clairement qu’elles supposent toutes une
époque commune, qui est celle où les équinoxes coïncidoient avec les premiers
degrés.des signes du taureau et du scorpion. Alors Thèbes étoit florissante, et
fondoit ses institutions sür des connoissances antérieures, fruit d’une longue étude
de la philosophie et des arts : les astronomes de l’Egypte remarquèrent eux-mêmes
que le commencement de l’année caniculaire, ou le point occupé par le soleil au
lever héliaque de Sirius, n’étoit pas fixe dans le ciel. L ’apparition de cet astre,
qui avoit eu lieu d’abord pendant que le soleil étoit dans la constellation du lion,
s avança d une quantité très-sensible, et répondit à la constellation du cancer. C e
mouvement rétrograde des saisons, par rapport aux étoiles fixes, nécessita des
changemens dans la représentation de l’année naturelle. La constellation de la
vierge, qui présidoit à l’inondation, fut remplacée par celle du lion, comme on
le voit expressément sur les plafonds du temple d’Isis à Tentyra. *
2 7 -
Epoque historique donnée p a r cette observation.
O n peut déterminer, par un calcul très-approché, le siècle où le point héliaque
qui sert d’origine à l’année caniculaire, a passé du signe du lion dans celui du
cancer, il est évident que cette epoque, qui diffère peu de deux mille cent ans
avant 1 ere chrétienne, a précédé la construction du temple de Tentyra, et.qu’elle
est postérieure a celle des monumens de Latopolis ; elle appartient donc, comme
l’époque de l’institution du zodiaque, à l’histoire civile de i’Égypte. La monarchie
subsistoit alors dans toute sa force ; elle obéissoit à des lois sages et constantes.
L expérience avoit fixé les principes du gouvernement et des moeurs, et les arts
étoient cultives depuis un temps immémorial ; ils avoient produit les monumens
admirables de Latopolis, et ils devoient en produire de nouveaux, puisque le
temple d Isis a Tentyra n’étoit pas construit.
2 8 .
Conséquences qui résultent de la Chronologie E gyptienne et de l ’institution des
Périodes Sothiques.
L ’ é t u d e de la chronologie Égyptienne conduiroit aussi à des conséquences
semblables. En effet, les fragmens des annales ou les traditions que nous ont
conservés Hérodote , Ëratosthène , Manéthon, D io d o r e , Jules Africain et
Eusèbe, sont inconciliables, si l’on veut y puiser un système suivi de dates historiques,
tel que nous le possédons pour les empires modernes : mais une comparaison
très-attentive de ces fragmens montre qu’ils ont des élémens communs.
Il nous paraît manifeste qu’ils dérivent de la même source, et ils.,s’accordent
tous pour nous faire connoître avec précision le nombre des rois qui ont gouverné
l’É g yp te , et dont les noms étoient inscrits dans les annales. On ne peut
point ici évaluer exactement la durée moyenne des règnes; et d’ailleurs les .conséquences
de ce calcul seraient toujours incertaines, à raison des changemens
assez fréquens de dynastie, et des troubles politiques pendant lesquels plusieurs
princes ont régné en même temps; On est du moins assuré que la valeur dont i l
s agit est moindre que la durée moyenne des générations dans le même climat.
Nous entendons par cette durée l’intervalle moyen qui s’écoule depuis la naissance
de I homme jusqu à celle du fils qui lui succède dans une ligne généalogique donnée.
Les écrivains Grecs ont commis, à ce sujet, une erreur grave en appliquant à
I histoire des autres peuples ,et aux successions royales les usages communs de
1 Attique ; et c est la raison pour laquelle ils évaluent avec tant d’inexactitude la
durée des temps historiques de l’Égypte. En soumettant cette question à une
juste critique, on apprend à connoître l’objet et la composition des chroniques