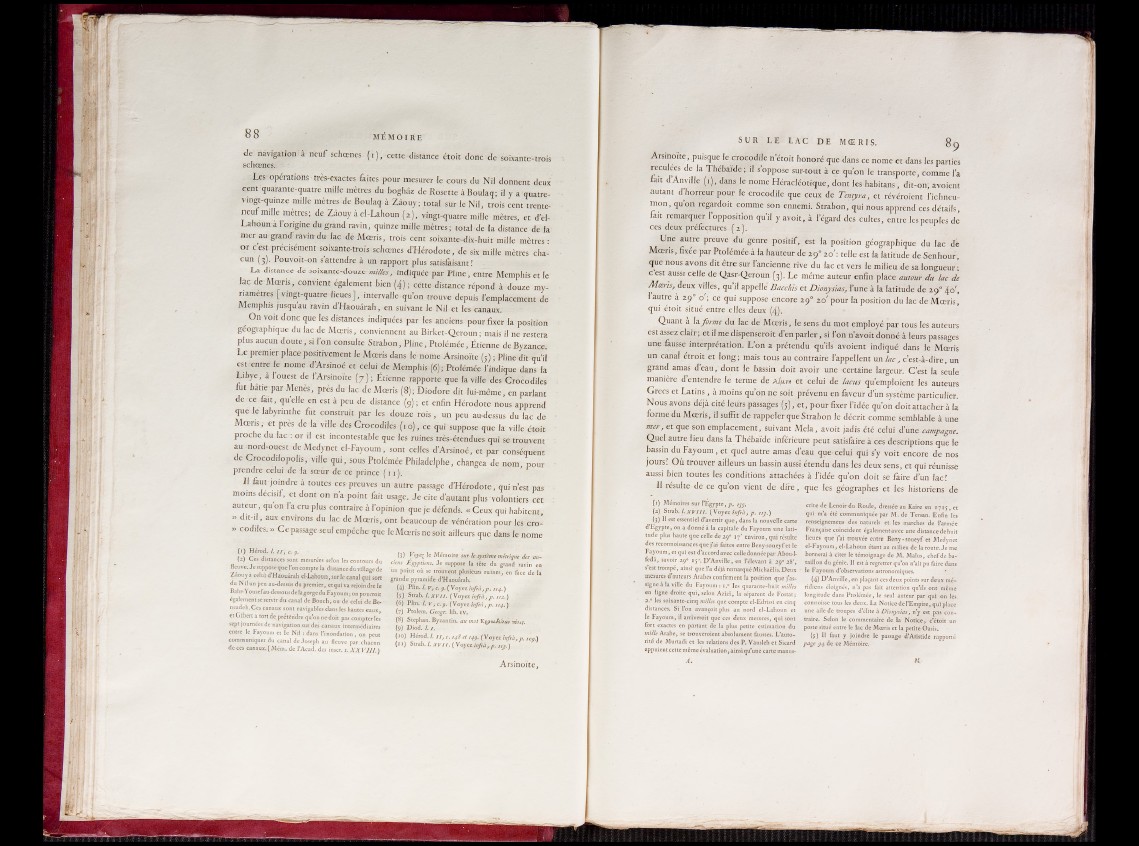
«le navigation à neuf schoenes ( i ) , -cette distance étoit donc de soixante-trois
schoenes.
Les opérations très-exactes faites pour mesurer Je cours du Nil donnent deux
cent quarante-quatre mille mètres du boghâz de Rosette àBoulaq; il y a quatre-
vingt-quinze mille mètres de Boulaq à Zâouy; total sur le Nil, trois cent trente-
neuf mille mètres; de Zâouy à el-Lahoun (2), vingt-quatre mille mètres, et d'èl-
Lahoun à l’origine du grand ravin, quinze mille mètres; total de la distance de la
mer au grand ravin du lac de Moeris, trois cent soixante-dix-huit mille mètres I
or c’est-précisément soixante-trois schoenes d’Hérodote, de six mille mètres chacun
(3). Pouvoit-on s’attendre à un rapport plus satisfaisant!
La distance dé soixante-douze milles, indiquée par Pline, entre Memphis et le
lac de Moeris, convient également bien (4 ); cette distance répond à douze my-
namètres [vingt-quatre lieues], intervalle qu’on trouve depuis l’emplacement de
Memphis jusquau ravin d’Haouârah, en suivant le Nil et les canaux.
On voit donc que les distances indiquées par les anciens pour fixer la position
géographique du lac de Moeris, conviennent au Birket-Qeroun; mais il ne restera
plus aucun doute, si l’on consulte Strabon, Pline, Ptolémée, Étienne de Byzance.
Le premier place positivement le Moeris dans le nome Arsinoïte (y) ; Pline dit qu’il
est- entre le nome dArsinoé et celui de Memphis (6);'Ptolémée l’indique dans la
Libye, a I ouest de 1 Arsinoïte ( 7 ) ; Étienne rapporte que la ville des Crocodiles
fut bâtie par Menés, près du lac de Moeris (8); Diodore dit lui-méme, en parlant
de ce fait, qu’elle en est à peu de distance (9); et enfin Hérodote nous apprend
que le labyrinthe fut construit par les douze rois, un peu au-dessus du lac de
Moeris, et près de la ville des Crocodiles (10), ce qui suppose que la ville étoit
proche du lac : or il est incontestable que les ruines très-étendues qui se trouvent
aumord-ouest deMedynet el-Fayoum, sont celles d’Arsinoé, et par conséquent
de Crocodilopolis, ville qui, sous Ptolémée Philadelphe, changea de nom, pour
prendre celui de la soeur de ce prince (1 1).
II fiiut joindre à toutes ces-preuves un autre passage d’Hérodote, qui n’est pas
moins décisif, et dont on n’a point fait usage. Je cite d’autant plus volontiers cet
auteur qu on 1 a cru plus contraire à l'opinion que je défends. « Ceux qui habitent,
dit-d , aux environs du lac de Moeris, ont beaucoup de vénération pour les cro-
» coddes. » -Ce passage seul empêche que le Moeris ne soit ailleurs que dans le nome
(1) Hérod. /. u , c. p.' *
(2) Ces distances sont mesurées selon les contours du
fleuve. Je suppose que l’on compte la distance du village de
Zâouy à celui d’Haouârah el-Lahoun, sur le canal qui sort
du N il un peu au-dessus du premier, et qui va rejoindre le
Bahr-Yousefau-dessous de la gorge du Fayoum; on pourroit
également se servir du canal de Bouch, ou de celui de Be-
neadeh.Ces canaux sont navigables dans les hautes eaux,
et Gibert a tort de prétendre qu’on ne doit pas compter lès
sept journées de navigation sur des canaux intermédiaires
entre le Fayoum et le N il : dans l’inondation, on peut
communiquer du canal de Joseph au fleuve par chacun
de ces canaux. ( Ména, de I’Acad. des inscr. t. XXVIII.)
(3) W & , le Mémoire sur le-système métrique des anciens
Égyptiens. Je suppose la tête du grand ravin en
ûn point où se trouvent'plusieurs ruines, en face de la
grande pyramide d’Haouârah.
(4) Plin. /. v , c. y . (V o y e z infrà, p . 1/4.)
(5) Strab. /. X V I I . (V o y e z infrà, p . 112.) ’
(6) Plin. /. 'Va c .y. (Voye z infrà , p . 1/4. )
(7) Ptolem. Geogr. lib. iy .
(8) Stephan. Byzantin, au mot KgÿiuA/\dr Waiç.
(9) Diod. 1. 1.
(10) Hérod. /. i i , c. 148 et 14$. (Vo y e z infrà, p . IOp.)
(11 ) Strab. I. x v i i . ( Vayez.infrà,p, n j . )
Arsinoïte,
Arsinoïte,.puisque le crocodile netoit honoré que dans ce nome et dans les parties
reculees de la Thébaide; il s’oppose sur-tout à C e qu’on le transporte, comme l’a
fait d’Anvilie (i), dans le nome Héracléotique, dont les habitans, dit-on; avoient
autant d’horreur pour le crocodile que ceux de Temyra, et révéroient l’ichneu-
mon, qu’on regardoit comme son ennemi. Strabon, qui nous apprend ces détails,
fait remarquer 1 opposition qu’il y avoit, à l’égard des cultes, entre les peuples de
ces deux préfectures (2).
Une autre preuve du genre positif, est la position géographique du lac de
Moeris, fixée par Ptolémée-à la hauteur de 290 20': telle est la latitude de Senhour,
que nous avons dit être sur l’ancienne rive du lac et vers le milieu de sa longueur ;
cest aussi celle de Qasr-Qeroun (3). Le même auteur enfin place autour du lac de
Moeris, deux villes, qu’il appelle Bacchis et Dionysias, l’une à la latitude de 290 4 û',
1 autre à 29 o ; ce qui suppose encore 29° 20' pour la position du lac de Moeris,
qui étoit situé entre elles deux (4).
Quant a la forme du lac de Moeris, le sens du mot employé par tous les auteurs
est assez clair; et il me dispenseroit d’en parler, si l’on n’avoit donné à leurs passages
une fausse interprétation. L’on a prétendu qu’ils avoient indiqué dans le Moeris
un canal étroit et long; mais tous au contraire l’appellent un lac, c’est-à-dire, un
grand amas deau, dont le bassin doit avoir une certaine largeur. C ’est la seule
manière d entendre le terme de a i/zn et celui de lacus qu’emploient les auteurs
Grecs et Latins , à moins qu’on ne soit prévenu en faveur d’iin système particulier.
Nous avons déjà cité leurs passages (y), et, pour fixer l’idée qu’on doit attacher à la
forme du Moeris, il suffit de rappeler que Strabon le décrit comme semblable à une
mer, et que son emplacement, suivant Mêla, avoit jadis été celui d’une campagne.
Quel autre lieu dans la Thébaïde inférieure peut satisfaire à ces descriptions que le
bassin du Fayoum, et quel autre amas d’eau que-celui qui s’y voit encore de nos
jours. Ou trouver ailleurs un bassin aussi étendu dans les deux sens, et qui réunisse
aussi bien toutes les conditions attachées à l’idée qu’on doit se faire d’un lac!
Il résulte de ce quon vient de dire, que les géographes et les historiens de
(1) Mémoires sur l’É g yp te, p. i j j .
(2) Strab. /. X V I I I . ( Voyez infrà, p . n j . )
(3) II est essentiel d’avertir que, dans la nouvelle carte
^ Egypte, on a donne a la capitale du Fayoum une latitude
plus haute que celle de 290 17 ' environ, qui résulte
des reconnoissances que j’ai faites entre Beny-soueyf et le
Fayoum, et qui est d’accord avec celle donnée par Abou-I-
feda, savoir 29° 15 '. D ’A nvilIe, en l’élevant à 290 28',
• s est trompé, ainsi que l’a déjà remarqué Michaëlis. Deux
mesures d auteurs Arabes confirment la position que j’assigne
a la ville du Fayoum: i.° les quarante-huit mil/ès
en ligne droite qui, selon A z i z i, la séparent de Fostat;
2.0 les soixante-cinq milles que compte el-Edrissi en cinq
distances. Si l’on avançoit plus au nord el-Lahoun et
le Fayoum, il arriveroit que ces deux mesures, qui sont
fort exactes en partant de la plus petite estimation du
mille Arabe, se trouveroient absolument fausses. L ’auto-
rite de Murtadi et les relations des P. Vànsieb et Sicard
appuient cette même évaluation, ainsi qu’une carte manus-
A .
crite de Lenoir du Roule, dressçe au Kaire en 1 7 1 5 , et
qui m’a été communiquée par M. de Tersan. Enfin les
renseignemens des naturels et les marches de l’armée
Française coïncident également avec une distance de huit
lieues que j’ai trouvée entre B en y -sou e y f et Medynet
el-Fayoum, el-Lahoun étant au milieu de la route. Je me
bornerai à citer le témoignage de M. Malus, ch ef de bataillon
du génie. II est à regretter qu’on n’ait pu faire dans
le Fayoum d’observations astronomiques. A ’j
(4) D ’A n v ille , en plaçant ces deux points sur deux méridiens
éloignés, n’a pas fait attention qu’ils ont même
longitude dans Ptolémée, le seul auteur par qui on les
connoisse tous les deux. L a Notice de l’Empire, qui place
une aile de troupes d’élite à Dionysias, n’y est pas contraire.
Selon le commentaire de la N o tic e , c’étoit un
poste situé entre le lac de Moeris et la petite Oasis.
(5) II faut y joindre le passage d’Aristide rapporté
page $4 de ce Mémoire.