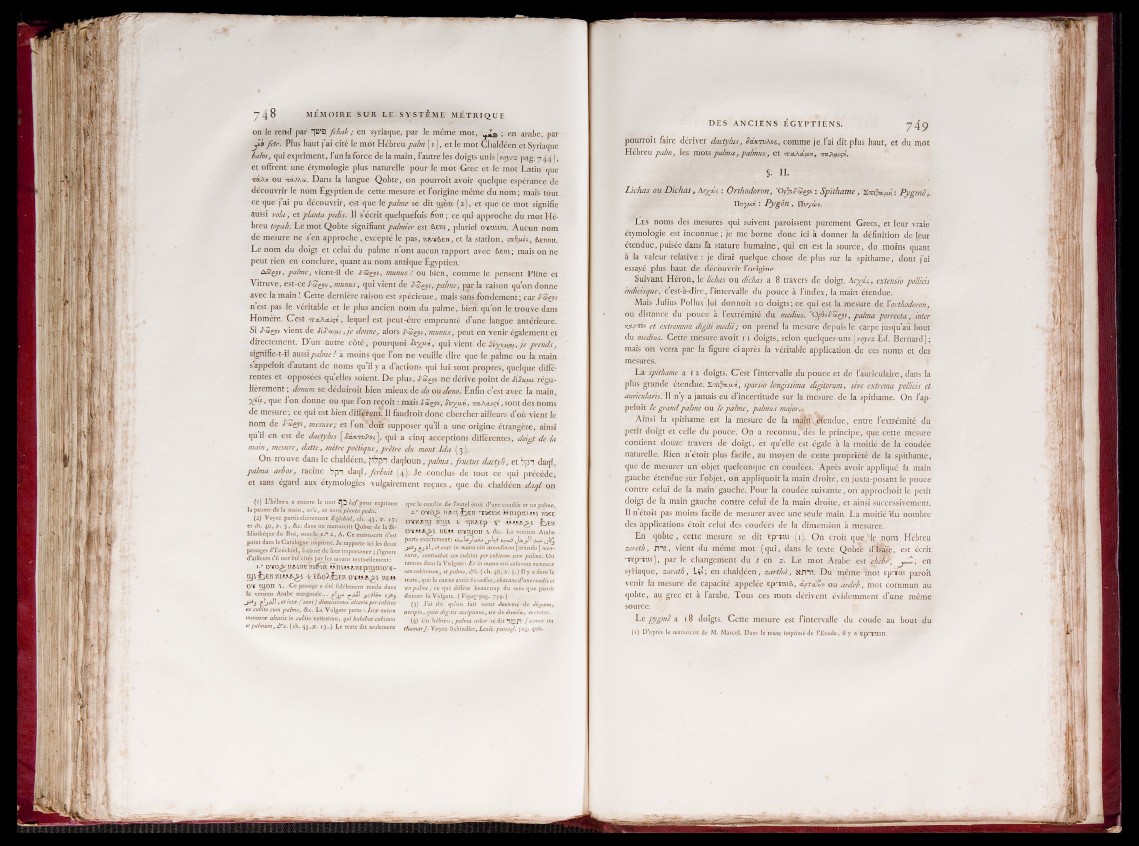
on Je rend par * [ t filiale ; en syriaque, par le même mot, .^lo, ; en arabe, par
ÿ i fetr. Plus haut j’ai cité le mot Hébreu palm ( i ), et le mot Chaldéen et Syriaque
balm, qui expriment, l’unlaforce de la main, l’autre les doigts unis [voyez pag .y 4 4 ),
et offrent une étymologie plus naturelle pour le mot Grec et le mot Latin que
mÂn ou mMa. Dans la langue Qobte, on pourroit avoir quelque espérance de
découvrir le nom Egyptien de cette mesure et l’origine même du nom ; mais tout
ce que jai pu découvrir, est que le palme se dit ujcm (a), et que ce mot signifie
aussi vola, et planta pedís. Il s’écrit quelquefois don ; ce qui approche du mot Hébreu
topait. Le mot Qobte signifiant palmier est R e h i , pluriel o-tumn. Aucun nom
de mesure ne s’en approche , excepté le pas, h s .-*ê e k , et la station, ça -ô ^ 's , t a r a i t .
Le nom du doigt et celui du palme n’ont aucun rapport avec t a u ; mais on ne
peut rien en conclure, quant au nom antique Égyptien.
Awgjii1, palme, vient-il de .hSejit, mumts ! ou bien, comme le pensent Pline et
Vitruve, est-ce , munus, qui vient de «hâgjv, palme, par la raison qu’on donne
avec la main ! Cette dernière raison est spécieuse, mais sans fondement; car
n’est pas le véritable et le plus ancien nom du palme, bien qu’on le trouve dans
Homère. C est vra X a fi, lequel est peut-être emprunté d’une langue antérieure.
Si vient de StS^cef/.i, je donne, alors J'açyv, munus, peut en venir'également et
directement. Dun autre côte, pourquoi iàyjj.?, qui vient de tiyy¡asy* je prends,
signifie-t-il aussi palme ! à moins que l’on ne veuille dire que le palme ou la main
s appeloit d autant de noms quil y a d’actions qui lui sont propres, quelque différentes
et opposées quelles soient. De plus, Lwgj» ne dérive point de Sihefu régulièrement
; donum se deduiroit bien mieux de do ou dono. Enfin c’est avec la main,
XÊÎP, que 1 on donne ou que 1 on reçoit : mais Saçyt, Ib yjd, 7ntXa.i<^, sont des noms
de mesure; ce qui est bien différent. Il faudroit donc chercher ailleurs d’où vient le
nom de JVaejv, mesure; et Ion doit supposer qu’il a une origine étrangère, ainsi
quil en est de dactylus [ íúsc-m?oé\, qui a cinq acceptions différentes, doigt de la
main, mesure, datte, mitre poétique, prêtre du mont Ida (3).
On trouve dans Je chaldeen, daqloun, palma, fructus dactyli, et bp l daql,
palma arbor, racine 'jpi daql, firbuit (4 ). Je conclus de tout ce qui précède,
et sans égard aux étymologies vulgairement reçues, que du chaldéen daql on
(1) L ’hébreu a encore le mot f p k a f pour exprimer
la paume de la main , vola, et aussi planta pedis.
(2) Voyez particulièrement Êjçchiel, ch. 43 , y . 13;
et ch. 4°> 71- 5 , & c . dans un manuscrit Qobte de la Bibliothèque
du R o i, sous4e n.° 2 , A . C e manuscrit n’ est
point dans le C atalogue imprimé. Je rapporte ici les deux
passages d’Ézéchiel, à cause de leur importance ; j’ ignore
d’ailleurs s’il ont été cités parjes sa vans textuellement:
l.° 0^0^ K&.XUE Hx6sk -W-TTSAJ-Z-HEpCEJtllCHf-
(JJS £ > E H H ! « - ¿ » ¿ S V È & 0 ? v b E ! t 0 1 * 1 5 ! H E «
O 'ï y OIT -V. C e passage a été fidèlement rendu dans
la version Arabe marginale... j-OÜL. #jj
j À $ p ljô J I , et istæ ( sunt ) dimensiones alraris per cubitos
ex cubito cum palmo, & c . La Vulgate porte : Istee autem
mensures ait a ri s in cubilo verissimo, qui habebat eu bit uni
et palmum, ¿7'c. (ch. 43 *3-) Le texte dit seulement
que la coudée de l’autel étoit d’une coudée et un palme.
2.° T 5SS2S >ÜTTSpa\JÜ-X «2SE
o * * k z .u j Hcys -v qnz^Ep T J ) e u
KE-W- O'ïCÿOTT -V & c . La version Arabe
po.rte exactement: *X*,UjIqJû Ja.jJI o-yj
9j >I, et erat in manu viri arundinem [arundo] men-
surce, continebat sex cubitos per cubitum cum palmo. ü n
trouve dans la Vulgate : E t in manu viri calamus inensuræ
sex cubitorurn, et palmo, i f c. ( ch. 40 , x . 5.) Il y a dans le
texte, que la canne av.oit 6 coudéesy chacune d’une coudée et
un palme / ce qui diffère beaucoup du sens que paroît
donner la Vulgate. ( Voye^'pag. 759. )
(3) J’ai dit qu’on fait venir Jicxnmç de Jiw/tai,
accipio, quia digitis accipimus, ou. de Jiixytta, monstro.
(4) En hébreu , palma arbor se dit j”| [ tamar ou
thamar]. Voyez Schindier, Lcxic. peniagl. pag. 406. .
pourroît faire dériver dactylus, JùW/Aoç, comme je, l’ai dit plus haut, et du mot
Hébreu palm, les mots palma, palmus, et v c a x l p L n , màgtifi.
§. II.
Lichas ou Dichas, Ai^a-'s : Orthodoron, ’OfJoJ'Sgjv : Spithame, Ewijo,,«.« : Pygmè,
T L n y t c n : Pygotl, ï i v y i i V.
L es noms des mesures qui suivent paroissent purement Grecs, et leur vraie
étymologie est inconnue ; je me borne donc ici à donner la définition de leur
étendue, puisée dans la stature humaine, qui en est la source, du moins quant
à la valeur relative : je dirai quelque chose de plus sur la spithame, dont j’ai
essayé plus haut de découvrir l’origine.
Suivant Héron, le lichas ou dichas a 8 travers de doigt. Ai^-aç, extensio pollicis
indicisque, c’est-à-dire, l’intervalle du pouce à l’index, la main étendue.
Mais Julius Pollux lui donnoit 10 doigts; ce qui est la mesure de l’orthodoron,
ou distance du pouce à l’extrémité du médius. ’Oj>0o<h«£jv, palma porrecta, inter
■es-fiât et extremum digiti medii; on prend la mesure depuis le carpe jusqu’au: bout
du médius. Cette mesure avoit 11 doigts, selon quelques-uns [voyez Éd. Bernard);
mais on verra par la figure ci-après la véritable application de ces noms et des
mesures.
La spithame a 12 doigts. C ’est l’intervalle du pouce et de l’auriculaire, dans la
plus grande étendue. sparsio longissima digitorum, sive extrema pollicis et
auricularis. Il n’y a jamais eu d’incertitude sur la mesure de la spithame. On l’ap-
peloit le grand palme ou le palme, palmus major.*
Ainsi la spithame est la mesure de la main étendue, entre l’extrémité du
petit doigt et celle du pouce. On a reconnu, dès le principe, que cette mesure
contient douze travers de doigt, et qu’elle est égale à la moitié de la coudée
naturelle. Rien nétoit plus facile, au moyen de cette propriété de la spithame,
que de mesurer un objet quelconque en coudées. Après avoir appliqué la main
gâtiche étendue sur l’objet, on appliquoit la main droite, en juxta-posant le pouce
contre celui de la main gauche. Pour la coudée suivante, on approchoit le petit
doigt de la main gauche contre celui de la main droite, et ainsi successivement.
Il n’étoit pas moins facile de mesurer avec une seule main. La moitié 'du nombre
des applications étoit celui des coudées de la dimension à mesurer.
En qobte, cette mesure se dit EpTUt (1). On croit que Me nom Hébreu
zereïh, D it, vient du même mot (qui, dans le texte Qoboe d’Isaïe, est écrit
'TEp'mt ), par le changement du t en z. Le mot Arabe est chebr, j l Z ; en
syriaque, zarath, Lii; en chaldéen, zarthâ, RÎYll. Du même mot EpTcu paroît
venir la mesure de capacité appelée Ep-rtnE, ¿p-rdC» ou àrdeb, mot commun au
qobte, au grec et a 1 arabe. Tous ces mots dérivent évidemment d’une même
source.
Le pygme a 18 doigts. Cette mesure est l’intervalle du coude au bout du
(1) D ’après le manuscrit de M. Marcel. Dans le texte imprimé de l’Ex od e, il y a E p 'T C U î î .