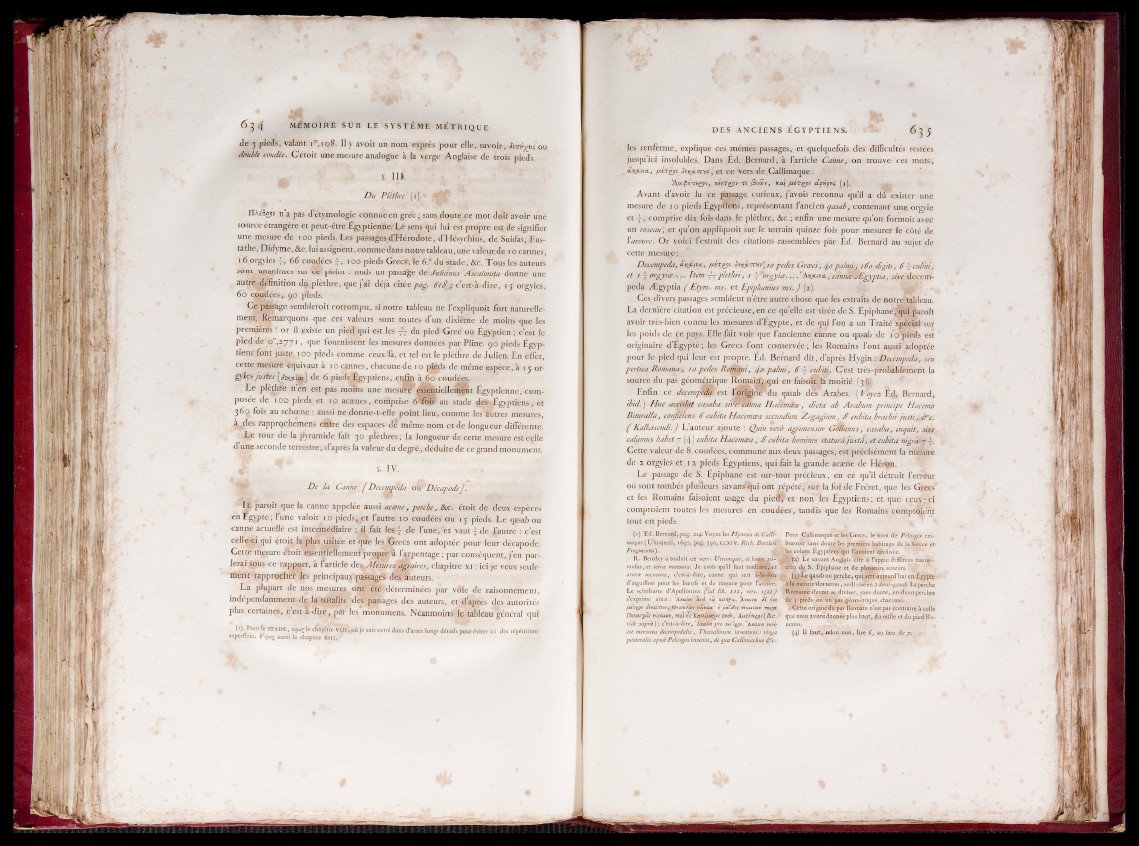
de 3 pieds, valant im,io8. Il y avoit un nom exprès pour elle, savoir, hwvyu« ou
double coudée. C ’étoit une mesure analogue à la verge Anglaise de trois pieds.
, §. II».
Du Plèthre ( I). *
ITÀe0e?ii n’a pas d’étymologie connue en grec ; sans doute ce mot doit avoir une
source étrangère et peut-être Égyptienne. Le sens qui lui est propre est de signifier
une mesure de 100 pieds. Les passages d’Hérodotè, d’Hésychius, de Suidas, Eus-
tathe, Didyme, &c. lui assignent, commédans notre tableau, une valeur de i o cannes,
16 orgyies j , 66 coudées / , io o pieds Grecs", le 6.' du stade, &c. Tous les auteurs
sont unanimes sur ce point : mais un passade de Julianus Ascalonita donne une
autre définition du plèthre, que j’ai déjà citée pag. 618 ; c’est-à-dire, 15 orgyies,
60 c o u d é e s90 pieds.
Ce passage semblerait corrompu, si notre tableau ne l’expliquoit fort naturellement.
Remarquons que ces valeurs sont toutes d’un dixième de moins que les
premières or il existe un pied qui est les 3; du pied Grec ou Égyptien ; c’est le
pied de o",2 7 7 1 , que fournissent les mesures données par Pline. 90 pieds Égyptiens
font juste 100 pieds comme ceux-là, et tel est le plèthre. de Julien. En effet,
cette mesure équivaut à 10 cannes, chacune de 10 pieds de même espèce, à 1 y 01-
g y ie s/u ste s [jjxstiàj] de 6 pieds Égyptiens, enfin à 60 coudées.
Le pied ire n ën est pas moins une mesuré essentiellement Égyptienne, composée
de 100 pieds et 10 acænes, comprise 6 /ois au stade clesnÉgyptiens, et
360 fois au schoene : aussi ne donne-t-elle point lieu, comme les autres mesures,
rapprqchemens entre des espaces de même nom et de longueur différente.
Le tour de la jîyramide fait 30 pîèthres; la longueur de cette mesure est celle
d une seconde terrestre, d après la valeur du degré, déduite de ce grand monument.
S. IV.
De la Canne [ Dccempêda ou’ Dccapode] .
I l paroît que la canne appelée aussi a cæ n e, p e rch e , & c. étoit de deux espèces
ën Egypte ; l’une val oit 10 pieds, et l’autre 10 coudées ou i j pieds. Le qasabou
canne actuelle est intermédiaire ; il/ait les— de l’une, ét vaut de /autre : c’est
celle-ci qui étoit la plus usitée et que les Grecs ont adoptée pour leur décapode.
Cetteunesure etoit ëssentiellemenfpropre^à l’arpentage ; par conséquent, j’en parlerai
sous ce rapport, à 1 article des,, M esu re s i agraires, chapitre xi : ici je veux seulement
rapprocher les principaux passages des auteurs.
La plupart de nos .mesures ont cteL lé terminées par voie de raisonnement,
indépendamment de la totalité dè's passages des auteurs, et d’après des autorités
plus certaines, c est-a-cïire, par les monumens. Néanmoins le'tableau général qui
(■y Pour le STADE, voyei le chapitre V I I I , où je suis entré dans d’assez longs détails pour éviter ici des répétitions
superflues. Voyç^ aussi le chapitre X in .
les renferme, explique ces mêmes passages, et quelquefois des difficultés restées
jusquici insolubles. Dans Éd. Bernard, à l’article Canne, on trouve ces mots,
a.*suxa., ÎEn^orvii, et ce -vers de Callimaque :
’AptlpOTtgJV, XiVrgp* TE (Sofflv, Kcbj /CiTçjV ttptjpnç M.
Avant d’avoir lu ce passage curieux, j’avois reconnu qu’il a dû exister une
mesure de 1 o pieds Égyptiens, représentant l’ancien qasab, contenant une orgyie
et j-, comprise dix fois dans le plèthre, &c. ; enfin une mesure qu’on formoit avec
un roseau ', et qu’on appliquoit sur le terrain quinze fois pour mesurer le côté de
l’aroure. Or voici l’extrait des citations rassemblées par Éd. Bernard au sujet de
cette mesure:
Decempeda, ¿nsiita/, Jtx/7rVx*I0 pedes Græci, ¿jo palmi, 180 digili, t> y cubai,
et 1 ÿ orgyioe.':.. Item — plethri, 1 ÿ Prgyioe.... Axsuvo., caimiï Ægyptia, sive decempeda
Ægyptia ( Etym. ms. et Epiphanius m s.) (2).
Ces divers passages semblent n’être autre chose que les extraits de notre.'tableau.
La dernière citation est précieuse, en ce qu’elle est tirée de S. Épiphane, qui paroît
avoir très-bien connu les mesures d’Égypte, et de qui l’on a un Traité spécial sur
les poids de ce pays. Elle fait voir que l’ancienne canne ou qasab de i"o pieds est
originaire d’Égypté; les Grecs l’ont conservée; les Romains l’ont aussi adoptée
pour le pied qui leur ést propre. Éd. Bernard dit, d’après Hygin : Decempeda, seu
pertica Romana , 10 pedes Romqni, 4 palmi, C y cubiti. C’est très-probablement la
source du pas géométrique Romain^qui en faisdit la moitié ( 3 jtt
Enfin ce decempedaïest lorigiriPdu qasab des Arabes. ( Voyez Éd. Bernard,
ibid. ) Mue accédât casaba sivé~cïinna Hacemæa, dicta ab Arabum principe Hacemo
Bimralla, conjtciens (j cubita Hacemoea secundiim Zegagium, 8 cubita brachii /usti
( Kalkasendi.) L auteur ajoute : Quin vero agrimensor Gcutaniis, casaba, inquit, sive
calamus habet y (4 ) cubita Hacemoea, 8 cubita lômiiiis staturâpista, et cubita nigra 7 4-
Cette valeur de 8 coudées, commune aux deux passages, est précisément la mesure
de 2 orgyies et 1 2 pieds Égyptiens, qui fait la grande acæne de Héron.
Le passage de S. Épiphane est sur-tout précieux, en ce qu’il détruit l’erreur
ou sont tombés plusieurs savans qui ont répété, sur la foi de Fréret, que les Grecs*
et les Romains faisoient usage du pied, et non les Égyptiens; et que ceux-,ci
comptoient toutes les mesures en coudées, tandis que les Romains comptoieuit
tout en pieds.
( i ) Ed. Bernaçjl^tfg-. 2/4. V oyez les Hymnes de Calli-
maque ( U ltrajecti, 1697, pag. 390, CCXIY. Rie h. Bentleii
Fragmenta ) .
R. Bentley a traduit ce vers: Utrumque, et boum sti-
mu lus, et terra: tnensura. Je crois qu’il faut traduire, féf
aruræ tnensura; c’est-à-dire, canne qui sert à-la-fois
d’aiguillon pour les boeufs et de mesure pour Yaroure.
L e scholiaste d’Apollonius ça d lib. n i , vers. 1322)
s exprime ainsi: ’Axami oj/tI . tu «i"7po>. Axa/m JV îçt
yUtTgpr dtxa.tnvy^QtosxtRuv tùonfxa. • n poiëdbç mijunrncn
n itxcuytç ivpniayn, me/ >if Katoiputyiç <p»ajy, A/u<poTi(>py(&c. ’
vide suprà) ; c’est-à-dire, 'im/m pro xtrlftpr. Axai va vero
est tnensura decempedalis, Thessalorum inventum : virga
pastoralis apud Pelasgos inventa, de qua Callimachus Ù ’c.
Pour Callimaquè et les G recs, le nom de Pélasges em*
brassôit sans doute les premiers habitans de la Grèce et
les colons Egyptiens1 qui l’avoient civilisée.
Le savant Anglais cite à l’appui différens manuscrits
de_ S . Epiphane et de plusieurs auteurs, ai
h (3) Le qasabou perche, quf-sert aujourd’hui en Egypte
à la mesure des terres, se divise en 2 demi-qasab. La perche
Romainë devoit se diviser, (sans doute, en demi-perches
de 5 pieds ou'un pas géométrique chacune.
. Cette origine'du pas Romain n’est pas contraire à celle
que nous avons donnée plus haut, du mille et du pied Romains.
(4) II faut, selon moi, lire 6 , au lieu de y .