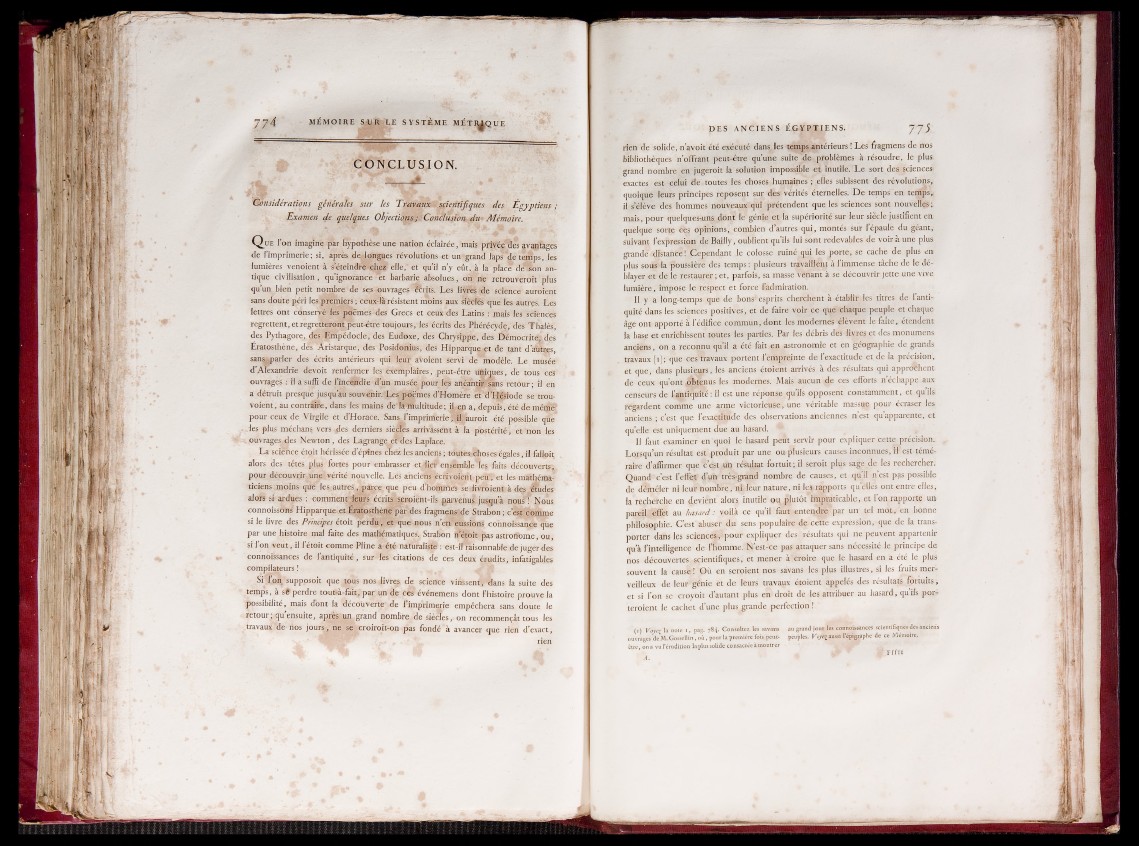
CONCLUSION.
Considérations générales sur les Travaux scientifiques des Égyptiens 1
Examen 4e quelques Objections ; Conclusion du* Mémoire.
Q u e l’on imagine par hypothèse une nation éclairée, mais privée dès avantages
de l’imprimerie; si, après de-longues révolutions et un grand laps de temps, les
lumières venoient à s’éteindre chez elle,' et qu’il n’y eût, à la place de son antique
civilisation, qu’ignorance et barbarie absolues, on ne retrouverait plus
qu’un bien petit nombre de ses ouvrages «rits. Les livres de science auroient
sans doute péri les premiers ; ceux-là résistent moins aux siècles que les autres. Les
lettres ont conservé lès poèmes des Grecs et ceux des Latins : mais les sciences
regrettent, et regretteront peut-être toujours/les écrits des Phérécyde, des Tbalès,
des Pythagore, des Empédocle, des Eudoxe, des Chrysïppe, des Démocrite, des
Eratosthène, des Âristarque, des Posidonius, des Hipparque et de tant d’a'ùtres,
sans^parler des écrits antérieurs qui leur avoient servi de modèle. L e musée
d’Alexandrie devoit renfermer les exemplaires, peut-être uniques, de tous ces
ouvrages : il a suffi de l’incendie d’un musée pour les anéantir sans retour ; il en
a détruit presque jusqu’au souvenir. Les, poëmes d’H omère et d’Hésiode se trou-
voient, au contraire, dans les mains de*la multitude; il en a, depuis, été de même?
pour ceux de Virgile et d’Horace. SansJ’imprimerieflil jauroit été possible que
.les plus méchans vers .des derniers siècles arrivassent à la postérité, et non les
ouvrages,4 es Newton, des Lagrange erSes Laplace.
La science étoit hérissée d’épines chez les anciens ; toutesr choses égales, il falloit,
alors des têtes plus fortes pour embrasser «¿lier ensïmbie les faits découverte,
pour découvrir une vérité nouvelle. Les anciens'-ecrivoient peu , et les mathématiciens
moins que les autres, parce que peu d’hommes se; livraient à des,études
alors si ardues : comment; leurs écrits seraient-ils parvenus, jusqu’à nous ! Nous
connoissôns Hipparque et Ératosthène'pàr des fragmens. de Strabon ; c’est comipe
si le livre des Principes étoit perdu, et que nous n’en eussions cohnoissance que
par une histoire mal faite des mathématiques, Strabon n’étoit pas astronome, ou,
si l’on veut, il fétoit comme Pline a été naturaliste : est-ifràisonnable de juger des
connoissances de l’antiquité, sur les citations de ces deux érudits, infatigables
compilateurs !
Si l’on supposoit que tous nos livres de science vinssent ,- dans la suite des
temps, a s f perdre tout?a-fait, par un de ces evenemens dont l’histoire prouve la
possibilité, mais dont la découverte de 1 imprimerie empêchera sans doute Je
retour ; qu ensuite, après un grand nombre de siècles, on recommençât tous les
travaux de nos jours,, ne se croiroit-on pas fondé à avancer que rien d’exact,
rien
rien de solide, n’avoit été exécuté dans, les temps antérieurs ! Les fragmens de nos
bibliothèques n’offrant peut-être qu’une suite de problèmes à résoudre, le plus
grand nombre en jugerait la solution impossible et mutile. L e sort des sciences»
exactes est celui de toutes les choses humaines ;• elles subissent des révolutions,
quoique leurs principes reposent sur des vérités éternelles. D e temps en temps,,
il s’élève des hommes nouveaux qui prétendent que les sciences sont nouvelles ;
mais, pour quelques-uns dont le" génie et la supériorité sur leur siècle justifient en
quelque sorte ces opinions, combien dautres qui, montes sur lepaule du géant,
suivant l’expression de Bailly, oublient qu ils lui sont redevables de voir a une plus
grande distance! Cependant le colosse ruiné qui les porte, se cache de plus en
plus sous la poussière des temps : plusieurs travaillènt à l’immense tâche de le déblayer
et de le restaurer; et, parfois, sa masse vénant à se découvrir jette une vive
lumière, impose le respect et force l’admiration.
Il y a long-temps que de bons*'esprits cherchent à établir les titres de 1 antiquité
dans les sciences positives, et de faire voir ce que chaque peuple et chaque
âge ont apporté à l’édifice commun, dont les modernes élèvent le faîte, étendent
la base et enrichissent toutes les parties. Par les débris des livres et des monumens
anciens, on a reconnu qu’il a été fait en astronomie et en géographie de grands
travaux (î); que ces travaux portent l’empreinte de l’exactitude et de la précision,
et que, dans plusieurs, les anciens étoient arrivés à des résultats qui approchent
de ceux qu’ont ,obtenus les modernes. Mais aucun de ces efforts n échappe aux
censeurs de l’antiquité : il est une réponse qu ils opposent constamment, et qu iis
regardent comme une arme victorieuse, une véritable massue pour écraser les
anciens ; c’est que l’exaqtitude des observations anciennes n’est qu’apparente, et
qu’elle est uniquement due au hasard. :
11 faut examiner en'quoi le hasard peut servir pour expliquer cette jjrécision.
Lorsqu’un résultat est produit par une ou plusieurs causes inconnues, ir est téméraire
d’affirmer que c’est un résultat fortuit; il serait plus sage de les rechercher.
Quand c’est l’effet d’un très-grand nombre de causes, et qu’il n’est pas possible
de démêler ni leur nombre, ni;leur nature, ni les rapports qu’elles ont entre elles,
la recherche en devient alors inutile ou plutôt impraticable, et l’on rapporte un
pareil effet au hasard : voila ce qu il faut entendre par un tel mo t, en bonne
philosophie. C ’est abuser du sens populaire de cette expression, que de la transporter
dans les sciences , pour expliquer des résultats qui ne peuvent appartenir
qu’à l’intelligence de l’homme. N’est-ce pas attaquer sans nécessité le principe de
nos découvertes, scientifiques, et mener à croire que le hasard en a été le plus
souvent la cause! Ou en seraient nos sàvans les plus illusties, si les fiuits merveilleux
de leur génie et de leurs travaux étoient appelés des résultats fortuits,
et si l’on se croyoit d’autant plus en droit de les attribuer au hasard, quils porteraient
le cachet d’une plus grande perfection !
(0 Voye^ la note i , pag. 784* Consultez les savans au grand jour les connoissances scientifiques des anciens
ouvrages de M . Gosseilin, o ù , pour la première fois peut- peuples. aussi l’épigraphe de ce Mémoire,
être, on a vu l’érudition la plus solide consacrée à montrer
. ▼ i f F f f f i