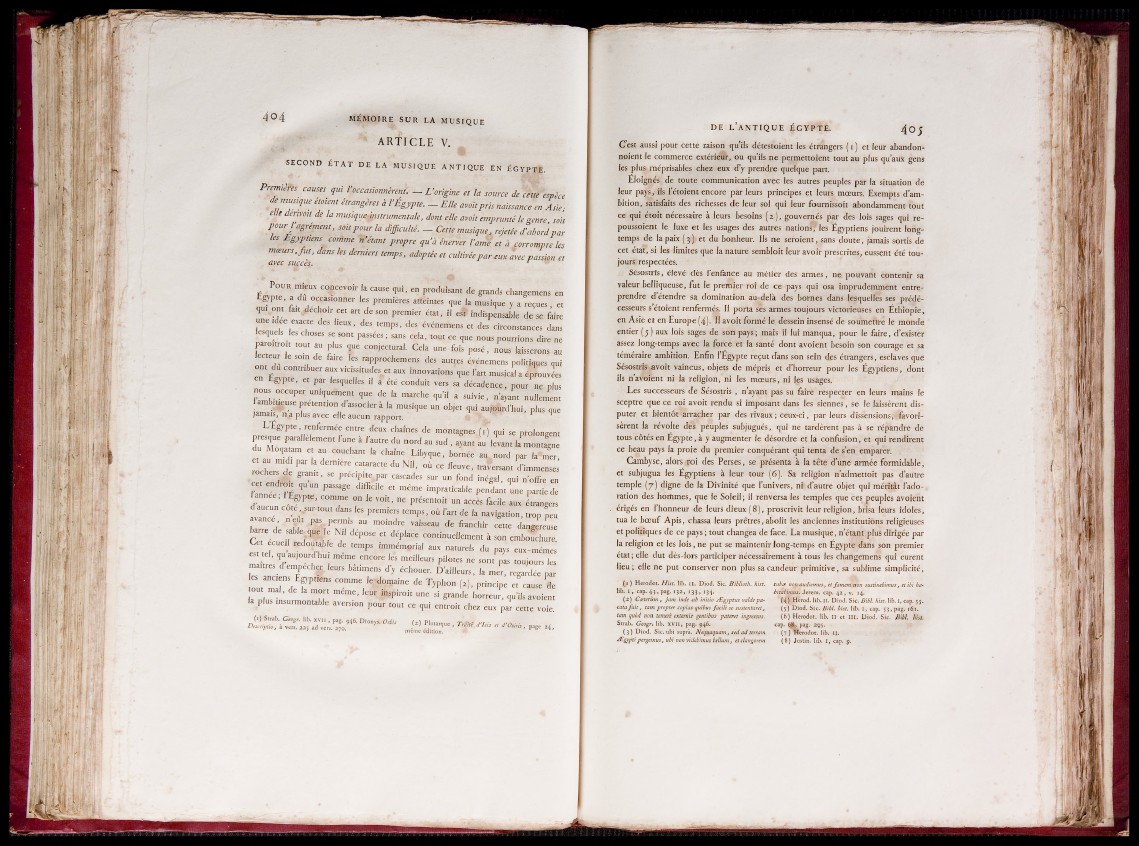
4 ° 4 MÉMOIRE SUR LA MUSIQUE
A R T I C L E V.
SECOND ÉTAT DE LA MUSIQUE ANTIQUE EN EGYPTE.
M l l'occasionnèrent. — L ’origine et la source de'cette espèce
de musique etoient étrangères h l ’Egypte. - E lle avait pris naissance en Asie;
■ elle dérivait de la musique-instrumentale, dont elle avoit emprunté le genre soit
pour Vagrément, soit pour la difficulté. - Cette musique, rejetée d’abord par
les Egyptiens cahime itétant propre qu’à énerver l ’amV et à xorrompre les
moeurs, fu t , tfans les derniers temps, adaptée et cultivée p a r eux avec passion et
avec succès^.
P o u r mieux co n c e vo ir la cause q u i, en produisant de grands changemens en
E g y p te , a du occasionner les premières atteintes que ia musique y a reçues et
q u ym t fait ^ é c h o i r cet art de son premier é ta t, il e s t indispensable de se ¿ i r e
une idee exacte des lie u x , des temps, des événemens et des circonstances dans
lesquels les choses se sont passées ; sans cela , tou t ce que nous pourrions dire ne
p a ïo itro it tout au plus que conjectural. C e la une fois posé , nous laisserons au
e c eur le soin d e faire les rapprochemens des autres é.vénemens politiques qui
ont du contribuer aux v ic is s itu d e s * aux innovations que fa r t musical a épîouvées
en E g yp te , et par lesquelles il a été conduit vers sa d é c ad en c e , pour ne plus
nous o c cu p e r uniquement que de 1a marche qu’il a su iv ie , n ’ayant nullement
ambp u s e prétention> d associer à la musique un objet qui aujourd’h ui, plus'que
jamais, n a plus a vec elle aucun rapport. $ '» ^ r i
nr« nÉSyPte’, r ? femléf, Cntre ,deUX chaînes de montagnes (, ) qui se prolongent
presque parallèlement 1 une a 1 autre du nord au sud, ayant au levant la montfgne
du Moqatam et au couchant la chaîne Libyque, bornée an nord par K
au midi par la demiere cataracte du Nil, où ce fleuve, traversant d’immenses
rochers de granit, se p r é c ip i t e ^ cascades sur un fond inégal, qui n’offre en
cet endroit quun passage difficile et même impraticable pendant une partie de
lannee; lEgypte, comme on le voit, ne présentoir un açcLfacile aux L îg e r s
aucun corn sur-tout dans les premiers temps, où l’art de la navigation, trop peu
avance " £tn pas permis au moindre vaisseau de franchir cette dangereuse
bar* de g g w j j £ dépose et dépJace | | E | | | | à SQn g ü H
e s t t e T Z r Ï i tCmpS ÍmmémprÍal aux naturels 1 Pays eux-mêmes
est tel, quaujourdhui meme encore les meilleurs pilotes ne sont pas toujours les
maîtres dempech« leurs hâtimens d’y échouer. D ’ailleurs, ia mer, regardée par
« ï " d e i f “ "5 E r% jÊ ÿ È L e ^ Typk0n 11 B P et cause * m a l, de la m o r t m em e , leur in sp iro it une si grande horreur, qu’ils avoient
plus insurmontable aversion p ou r tout ce qui entroit chez eux par cette voie.
1 E f | J | XOs lr ls , page
1 ' meme édition.
Ç est aussi pour cette raison qu’ils détestoient les étrangers ( i ) et leur ahandon-
noient le commerce extérieur, ou qu’ils ne permettoient tout au plus qu’aux gens
les plus méprisables chez eux d’y prendre quelque part.
Eloignés de toute communication avec les autres peuples par la situation de
leur pays, ils l’étoient encore par leurs principes et leurs moeurs. Exempts d’ambition,
satisfaits des richesses de leur sol qui leur fournissoit abondamment tout
ce qui étoit nécessaire à leurs besoins ( 2 ), gouvernés par des lois sages qui re-
poussoient le luxe et les usages des autres nationsfles Égyptiens jouirent longtemps
de la paix (3,);, et du bonheur. Ils ne seroient, sans doute, jamais sortis de
cet eut, si les limites que la nature sembloit leur avoir prescrites, eussent été toujours
respectées.
Sésostris, élevé dès l’enfance au métier des armes, ne pouvant contenir sa
valeur belliqueuse, fut le premier roi de ce pays qui osa imprudemment entreprendre
d étendre sa domination au-delà des bornes dans lesquelles ses prédécesseurs
s étoient renfermés. Il porta Ses armes toujours victorieuses en Éthiopie,
en Asie et en Europe (4 ). Il avoit formé le dessein insensé de soumettre le monde
entier (y) aux lois sages de son pays; mais il lui manqua, pour le faire, d’exister
assez long-temps avec la force et la santé dont avoient besoin son courage et sa
temeraire ambition. Enfin lÉgypte reçut dans son sein des étrangers, esclaves que
Sésostris avoit vaincus, objets de mépris et d’horreur pour les Égyptiens, dont
ils n’avoient ni la religion, ni les moeurs, ni les usages.
Les successeurs de Sésostris , n’ayant pas su faire respecter en leurs mains le
sceptre que ce roi avoit rendu si imposant dans les siennes, se le laissèrent disputer
et bientôt arracher par des rivaux; ceux-ci, par leurs dissensions ^favorisèrent
la révolte dés peuples subjugués, qui ne tardèrent pas à se répandre de
tous côtés en Égypte, à y augmenter le désordre et la confusion, et qui rendirent
ce beau pays la proie du premier conquérant qui tenta de s’en emparer.
Cambyse, alors,roi des Perses, se présenta à la tête d’une armée formidable,
et subjugua les Égyptiens à leur tour (6). Sa religion n’admettoit pas d’autre
temple (7) digne de la Divinité que l’univers, ni d’autre objet qui méritât l’adoration
des hommes, que le Soleil ; il renversa les temples que ces peuples avoient
érigés en l’honneur de leurs dieux (8), proscrivit leur religion, brisa leurs idoles,
tua le boeuf Apis, chassa leurs prêtres, abolit les anciennes institutions religieuses
et politiques de ce pays ; tout changea de face. La musique, n’étant plus dirigée par
la religion et les lois, ne put se maintenir long-temps en Égypte dans son premier
état; elle dut dès-lors participer nécessairement à tous les changemens qui eurent
lieu; elle ne put conserver non plus sa candeur'primitive, sa sublime simplicité,
(f? ) Herodot. Hist. Iib. II. Diod. Sic. Biblïoth. hist. tuba: non audiemus, et famein non sustinebimus, etibi lia-
tib. 1 , cap. 43> pag- 132 > *33 > *34* bitabimus. Jerem. cap. 4 2 , v. 14*
(2) Coetervm, jam inde ab initio Ægyptus valdepa- (4 ) Hérod. Iib. i l . Diod. Sic. Bibl. hist. Iib. I, cap. 55.
■catafuit, tant propter copias quibus facile se sustentaret, (5) Diod. Sic. Bibl. hist. Iib. 1 , cap. 53, pag. 161.
tam qubd non temeri ex ternis gentibus patent ingressus. (6 ) Herodot. Iib. i l et III. Diod. Sic. Bibl. hist.
Strab. Ceogr. Iib. XVII, pag. 946. cap. (&, pag. 2 ç j.
( 3 ) Diod. Sic . ubi suprà. JVeqyaquam., sed ad terrain (7 Jwe rod o t. Iib. 11.
Ægyptipergemus, ubi non videbimus bcllum, etclangorem (8 ) Justin. Iib. I , cap. p.