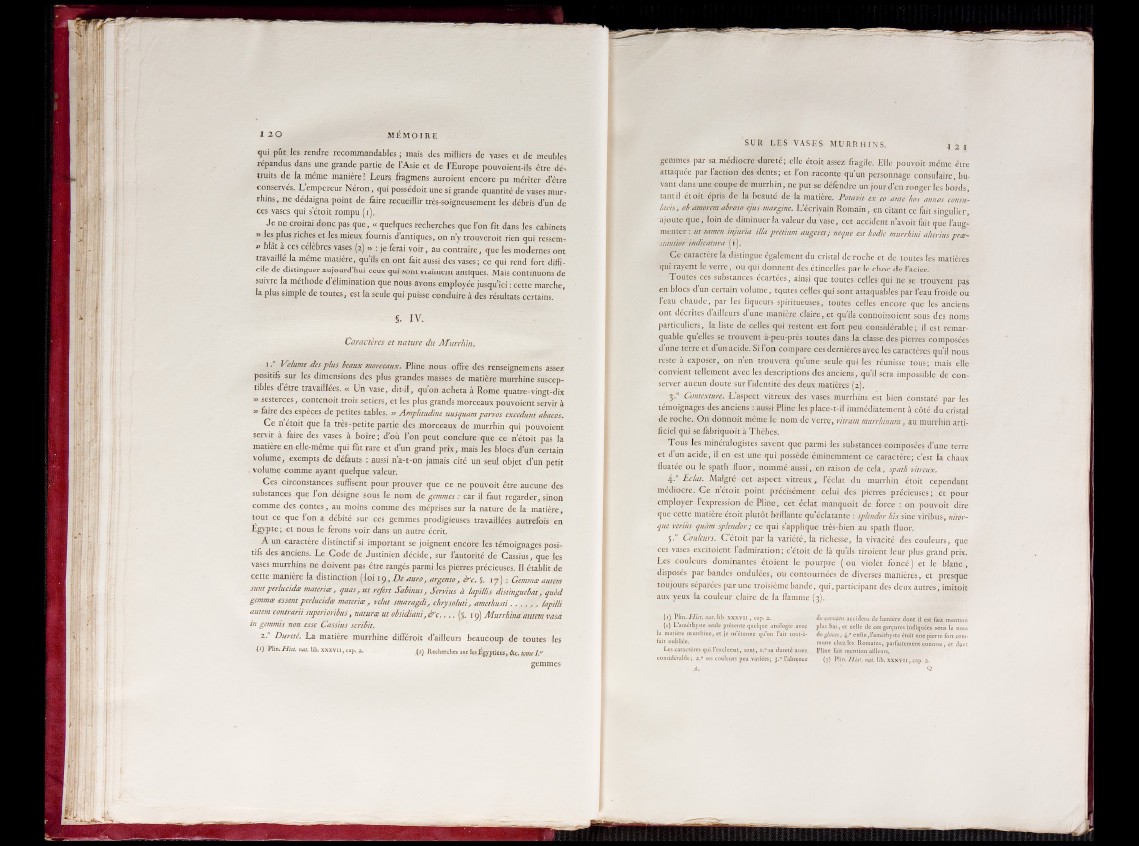
qui put les rendre recommandables ; mais des milliers de yases et de meubles
répandus dans une grande partie de l’Asie et de l’Europe pouvoient-ils être détruits
de la meme manière! Leurs fragmens auroient encore pu mériter d’être
conserves. L empereur Néron, qui possédoit une si grande quantité de vases mur-
rhins, ne dédaigna point de faire recueillir très-soigneusement les débris d’un de
ces vases qui s’étoit rompu (i).
Je ne croirai donc pas que, « quelques recherches que l ’on fît dans les cabinets
» les plus riches et les mieux fournis d’antiques, on n’y trouveroit rien qui ressem-
» blât à ces célèbres vases (2) » : je ferai vo ir, au contraire, que les modernes ont
travaille la meme matière, qu ils en ont fait aussi des vases; ce qui rend fort difficile
de distinguer aujourd hui ceux qui sont vraiment antiques. Mais continuons de
suivre la méthode d élimination que nous avons employée jusqu’ici ; cette marche,
la plus simple de toutes, est la seule qui puisse conduire à des résultats certains.
$. P I
Caractères et nature du Murrhin,
i.° Volume des plus beaux morceaux. Pline nous offre des renseignemens assez
positifs sur les dimensions des plus grandes masses de matière murrhine suscep-r
tibles dêtre travaillées. « Un vase, dit-il, qu’on acheta à Rome quatre-vingt-dix
» sesterces, contenoit trois setiers, et les plus grands morceaux pouvoient servir à
y> faire des espèces de petites tables. » Amplitudine msqttamparvos excedmit abacos.
C e netoit que la tres-petite partie des morceaux de murrhin qui pouvoient
servir à faire des vases à boire; d’où l’on peut conclure que ce n’étoit pas la
matière en elle-même qui fût rare et d’un grand prix, mais les blocs d’un certain
volume, exempts de défauts : aussi n a-t-on jamais cité un seul objet d’un petit
volume comme ayant quelque valeur.
Ces circonstances suffisent pour prouver que ce ne pouvoit être aucune des
substances que 1 on désigné sous le nom de gemmes : car il faut regarder, sinon
comme des contes, au moins comme des méprises sur la nature de la matière,
tout ce que l’on a débité sur ces gemmes prodigieuses travaillées autrefois en
Egypte; et nous le ferons voir dans un autre écrit.
A un caractère distinctif si important se joignent encore les témoignages positifs
des anciens. Le Code de Justinien décide, sur l’autorité de Cassius, que les
vases murrhins ne doivent pas être rangés parmi les pierres précieuses. Il établit de
cette manière la distinction (loi 19, De auro, argento, frc. S. 1 7 ) Gemmai autem
suntperlucidoe matertoe, quas, ut refert Sabinus, Servius à lapillis distinguebat, qu'od
gemmoe essent perlucidoe materioe , velut smaragdi, chrysoluti, amethusti . . . . . . . . lapilli
autem contrani superioribus, naturoe ut obsidiani, ir e (§. 19) Murrhina ataem vasà
H gemniis non esse Cassius scribit.
2. Dureté. La matière murrhine differoit d’ailleurs beaucoup de toutes les
( I ) Plin. H is t. nat. lib. x x x y n , cap. z . (z) Recherche, sur Ira É gyptiens, & c . tomt 1. "
gemmes
S U R L E S V A S E S M U R R H I N S . î f | j g
gemmes par sa médiocre dureté; elle étoit assez fragile. Elle pouvoit même être
attaquée par 1 action des dents; et Ion raconte qu’un personnage consulaire, buvant
dans une coupe de murrhin, ne put se défendre un jour d’en ronger les bords,
tant il étoit épris de la beauté de la matière, Patavit ex eo ante bas annos constt-
laris, obamorem abroso ejus margine. L’écrivain Romain, en citant ce fait singulier
ajoute que, loin de diminuer la valeur du vase, cet accident n’avoit fait que l’augmenter
: ut tamen injuria ilia pretium augeret; neque est hodie murrhini alterius proe-
staniior indicatura (i).
Ce caractère la distingue également du cristal de roche et de toutes les matières
qui rayent le verre, ou qui donnent des étincelles par le choc de l’acier.
Toutes ces substances ecartees, ainsi que toutes celles qui ne se trouvent pas
en blocs d un certain volume, toutes celles qui sont attaquables par l’eau froide ou
1 eau chaude, par les liqueurs spiritueuses, toutes celles encore que les anciens
ont décrites d ailleurs d une manière claire, et qu’ils connoissoient sous des noms
particuliers, la liste de celles qui restent est fort peu considérable; il est remarquable
qu’elles se trouvent à-peu-près toutes dans la classe des pierres composées
d’une terre et d’un acide. Si l’on compare ces dernières avec les caractères qu’il nous
reste à exposer, on n’en trouvera qu’une seule qui les réunisse tous; mais elle
convient tellement avec les descriptions des anciens, qu’il sera impossible de conserver
aucun doute sur l’identité des deux matières (2).
3.0 Contexture. L’aspect vitreux des vases murrhins est bien constaté par les
témoignages des anciens : aussi Pline les place-t-il immédiatement à côté du cristal
de roche. On donnoit meme le nom de verre, vitrum murrlinum, au murrhin artificiel
qui se fabriquoit à Thèbes.
Tous les minéralogistes savent que parmi les substances composées d’une terre
et d un acide, il en est une qui possède éminemment ce caractère; c’est la chaux
fluatée ou le spath fluor, nommé aussi, en raison de cela^ spath vitreux.
4 -° Éclat. Malgré cet-aspect vitreux, leclat du murrhin étoit cependant
médiocre. Ce n’étoit point précisément celui des pierres précieuses; et pour
employer l’expression de Pline, cet.éclat manquoit de force : on pouvoit dire
que cette matière etoit plutôt brillante qu éclatante : splendor bis sine viribus, nitor-
que veriits quàm splendor; ce qui s’applique très-bien au spath fluor.
5.° Couleurs. C ’étoit par la variété, la richesse, la vivacité des couleurs, que
ces vases excitoient 1 admiration ; c etoit de la qu ils tiroient leur plus grand prix.
Les couleurs dominantes étoient le pourpre ( ou violet foncé ) et le blanc ,
disposés par bandes ondulées, ou contournées de diverses manières, et presque
toujours séparées par une troisième bande, qui, participant des deux autres, imitoit
aux yeux la couleur claire de la flamme (3).
(*) Elin. Hist. nat. lib.XXXVII, cap. 2. de certains accidens de lumière donc il est fait mention
(s) L ’améthyste seule présente quelque analogie avec plus bas, et celle de ces gerçures indiquées sous le nom
la matière murrhine, et je m’étonne qu’on l’ait tout-à- de glacis; 4.“ enfin, l’améthyste étoit une pierre fort com-
fait oubliée. ' ‘ nmne chez les Romains, parfaitement connue, et dont
Les caractères qui l’excluent, sont, t.° sa duretc assez Pline fait mention ailleurs,
considérable; z.° ses couleurs peu .variées; g." l’absence (g) Plin. Hist. nat. lib. x x x y n , cap. 2.
A. ' Q