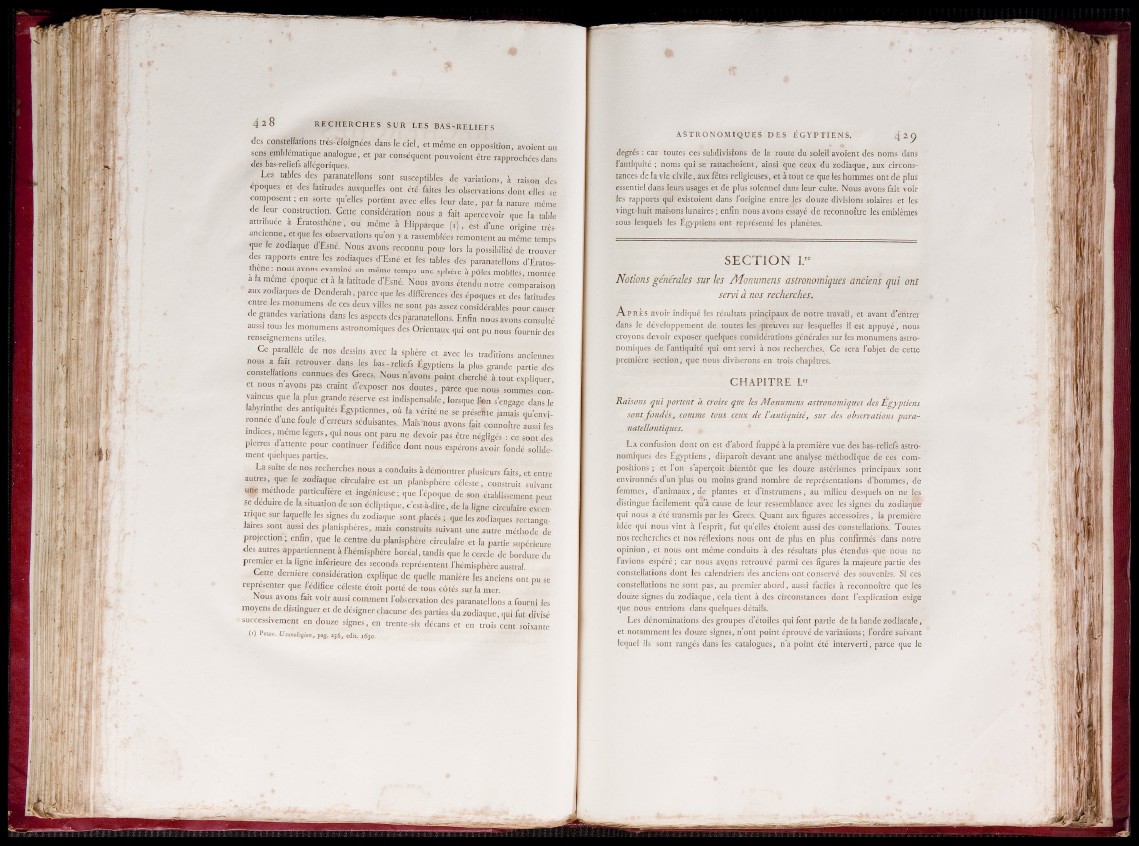
des constellations trèsYloignées dans le ciel, et même en opposition, avoient un
sens emblématique analogue, et par conséquent pouvoient être rapprochées dans
des bas-reJiefs allégoriques.
^ Les tables des paranatellons sont susceptibles de variations, à raison des
époques et des latitudes auxquelles ont été faites les observations dont elles se
composent ; en sorte quelles porftnt avec elles leur date, par la nature même
de leur construction. Cette considération nous a fait apercevoir que la table
attribuée à Eratosthène , ou même à Hipparque ( i ) , est d’une origine très-
ancienne, et que les observations qu’on y a rassemblées remontent au même temps
que le zodiaque dEsné. Nous avons reconnu pour lors la possibilité de trouver
des rapports entre les zodiaques d'Esné et les tables des paranatellons d'Ératos-
thene: nous avons examiné en même temps une sphère à pôles mobiles, montée
a la mente époque et à la latitude d’Esné. Nous avons étendu notre comparaison
aux zodiaques de Denderah, parce que les différences des époques et des latitudes
entre des monumens de ces deux villes ne sont pas assez considérables pour causer
ce grandes variations dans les aspects des paranatellons. Enfin nous avons consulté
aussi tous les monumens astronomiques des Orientaux qui ont pu nous fournir des
renseignemens utiles.
Ce parallèle de nos dessins avec la sphère et avec les traditions anciennes
nous a fait retrouver dans les bas-reliefs Égyptiens la plus grande partie des
constellations connues des Grecs. Nous n’avons point cherché à tout expliquer
et nous navons pas craint d’exposer nos doutes, parce que nous sommes convaincus
que la plus grande réserve est indispensable, lorsque l«m s’engage dans le
Jabyrmdie des antiquités Égyptiennes, où la vérité ne se présente jamais qu’envi-
ronnée d une foule d’eireurs séduisantes. Mais‘nous avons (ait connoître aussi les
indices, meme légers, qui nous ont paru ne devoir pas être négligés : ce sont des
pierres d attente pour continuer l’édifice dont nous espérons avoir fondé solidement
quelques parties.
La suite de nos recherches nous a conduits à démontrer plusieurs faits, et entre
autres, que le zodiaque circulaire est un planisphère céleste, construit suivant
une methode particulière et ingénieuse; que l’époque de son établissement peut
se déduire de la situation de son écfiptique, c’est-à-dire, de la ligne circulaire excentrique
sur laquelle les signes du zodiaque sont placés.; que les zodiaques rectangulaires
sont aussi des planisphères, mais construits suivant une autre méthode de
projection ; enfin, que le centre du planisphère circulaire et la partie supérieure
des autres appartiennent à l’hémisphère boréal, tandis que le cercle de bordure du
premier et la ligne inférieure des seconds représentent l’hémisphère austral.
Cette demiere considération explique de quelle manière les anciens ont pu se
représenter que 1 édifice céleste étoit porté de tous côtés sur la mer.
Nous avons fait voir aussi comment l’observation des paranatell.ons a fourni les
moyens de distinguer et de désigner chacune' des parties du zodiaque, qui fut divisé
successivement en douze signes, en trente-six décans et en trois cent soixante
(0 Petav. Uranologion, pag. 2j i , « fit. 1630.
degrés : car toutes ces subdivisions de la route du soleil avoient des noms dans
l’antiquité ; noms qui se rattachoient, ainsi que ceux du zodiaque, aux circonstances
de la vie civile, aux fêtes religieuses, et à tout ce que les hommes ont de plus
essentiel dans leurs usages et de plus solennel dans leur culte. Nous avons fait voir
les rapports qui existoient dans l’origine entre les douze divisions solaires et les
vingt-huit maisons lunaires ; enfin nous avons essayé de reconnoitre les emblèmes
sous lesquels les Égyptiens ont représenté les planètes.
SECTION I.rc
Notions générales sur les Aionumens astronomiques anciens qui ont
servi à nos recherches.
A pres avoir indiqué les résultats principaux de notre travail, et avant d’entrer
dans le développement de toutes les .-preuves sur lesquelles il est appuyé, nous
croyons devoir exposer quelques considérations générales sur les monumens astronomiques
de l’antiquité qui ont servi à nos recherches. Ce sera l’objet de cette
première section, que nous diviserons en trois chapitres.
C H A P I T R E I."
Raisons qui portent a croire que les Monumens astronomiques des Égyptiens
sont fon d és, comme tous ceux de l ’antiquité, sur des observations para-
natellontiques.
L a confusion dont on est d’abord frappé à la première vue des bas-reliefs astronomiques
des Égyptiens, disparoît devant une analyse méthodique de ces compositions
; et 1 on s aperçoit bientôt que les douze astérismes principaux sont
environnés d’un plus ou moins grand nombre de représentations d’hommes, de
femmes, d’animaux, de plantes et d’instrumens, au milieu desquels on ne les
distingue facilement qu’à cause de leur ressemblance avec les signes du zodiaque
qui nous a été transmis par les Grecs. Quant aux figures accessoires, la première
idée qui nous vint à l’esprit, fut qu’elles étoient aussi des constellations. Toutes
nos recherches et nos réflexions nous ont de plus en plus confirmés dans notre
opinion, et nous ont même conduits à des résultats plus étendus que nous ne
1 avions espéré ; car nous avons retrouvé parmi ces figures la majeure partie des
constellations dont les calendriers des anciens ont conservé des souvenirs. Si ces
constellations ne sont pas, au premier abord, aussi faciles à reconnoftre que les
douze signes du zodiaque, cela tient à des circonstances dont l’explication exige
que nous entrions dans quelques détails.
Les dénominations des groupes d’étoiles qui font partie de la bande zodiacale,
et notamment les douze signes, n’ont point éprouvé de variations; l’ordre suivant
lequel ils sont rangés dans les catalogues, n’a point été interverti, parce que le