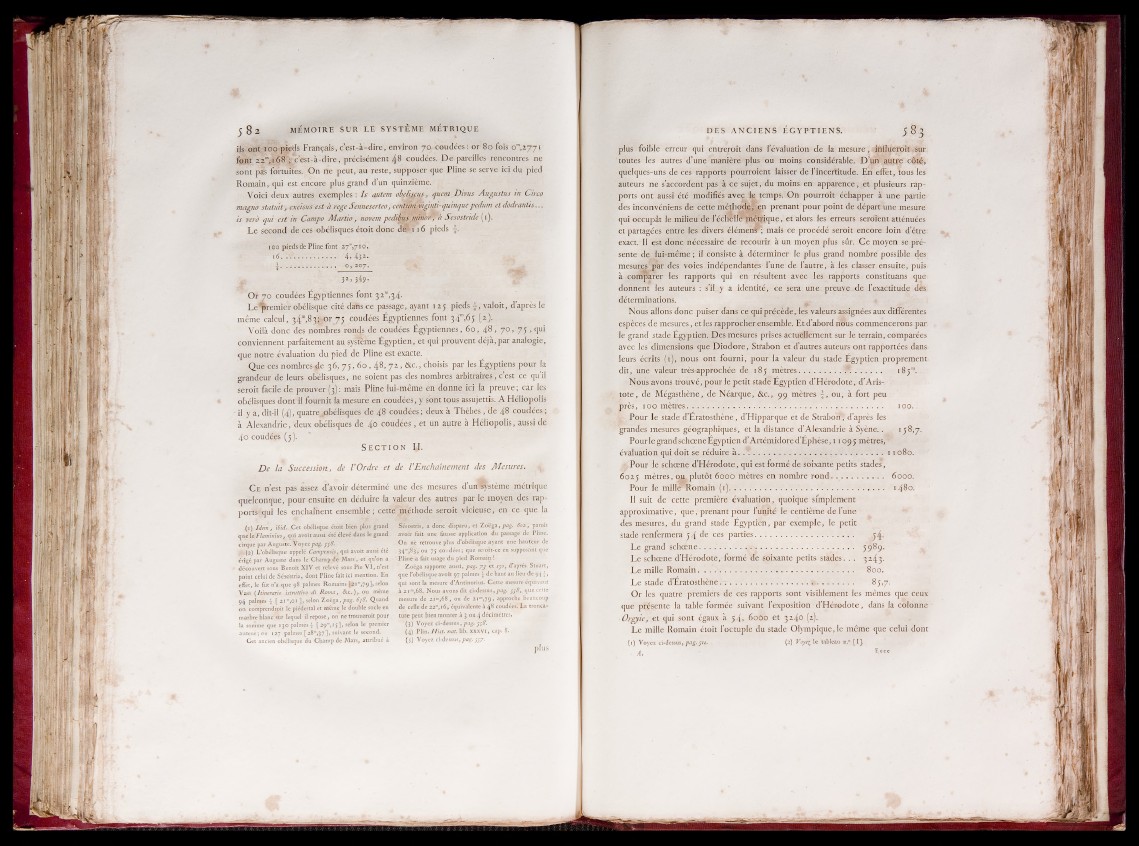
ils ont 100 pierfs Français, c’est-à-dire, environ 70 coudées; or 80 fois
fonjt 22'",-168 ï.c est-à-dire, précisément 4 8 coudées. Dé pareilles rencontres ne
sont pas fortuites. On ne peut, au reste, supposer que Pline se serve ici du pied
Romain, qui est encore plus grand d’un quinzième.
Voici deux autres exemples : Is autem obe/ispus, quem Divus Augustus irt Circo
magno stutuit, excisus est à rege Seuneserteo, ceutuîii vigi 1A1-qumquc pedum et dodriintiS..,
is vero qui est in Campo Martio, novetn pedibrqs minora Sesostride (1).
Le second de ces obélisques étoit donc de' i 16 pieds j .
100 pieds de Pline font 27",71 o.
i d . '.V-.................................... 4» 4-32 *
4. o , 207.
3 2 . 3 4 9 -
Or 70 coudées Égyptiennes font 3 2"’,34.
L é premier obélisque cité dans ce passage, ayant 1 25 pieds \ , valoit, d’après le
même calcul, 34m>83âor,75 coudées Égyptiennes font 34 ”/)5 (.2).
Voilà donc des nombres ronds de coudées Égyptiennes, 60, 4 8 , 70, 7 5 , qui
conviennent parfaitement au système Égyptien, et qui prouvent deja, par analogie,
que notre .évaluation du pied de Pline est exacte.
Que ces nombres de 36, 7J, 60, 4 8 > 7 2 > ôte., choisis par les Égyptiens pour la
grandeur de leurs obélisques, ne soient pas des nombres arbitraires, c est ce qu il
seroit facile de prouver (3): mais Pline lui-même en donne ici la preuve; car les
obélisques dont il fournit la mesure en coudées, y sont tous assujettis. A Héliopolis
- il y a, dit-il (4), quatre^obélisques de 48 coudées ; deux à Thèbes, de 48 coudées ;
à Alexandrie, deux obélisques de 4 ° coudées, et un autre à Héliopolis, aussi de
4o coudées (5).
S e c t i o n LI .
D e la Succession, de l ’Ordre et de l ’Enchaînement des Mesures. ^
C e n’est pas assez d’avoir déterminé une des mesures d’un"stème métrique
quelconque, pour ensuite en déduire la valeur des autres par le moyen des rapports
qui les enchaînent ensemble; cette méthode seroit vicieuse, en ce que la
Sésostris, a donc disparu, et Z o ë g a , pag. 602, paroît
avoir fait- une fausse application du passage de Pline.
On né retrouve plus d’obélisque ayant une hauteur de
34m;83, ou 75 coudées; que seroit-ce en supposant que
‘ Pline a fait usage du pied Romain !
Zoëga rapporte aussi, pag. 7 3 et /yo, d’après Stuart,
que l’obélisque avoit 97 palmes j- de haut au lieu de 94f >
qui sont la mesure d’Antinorius. Ce tte mesure équivaut
à i i m,68. Nous avons dit ci-dessus, pAg-, 558, que cette
mesure de 21 m,68, ou de 2 im,7 9 , approche beaucoup
de celle de 22“ , 16, équivalente à 48 coudées. La troncature
peut bien monter à 3 ou 4 décimètres.
(3) V oyez ci-dessus, pag. jf8 .
(4) Plin. Mist. nat. lib. x x x v i , cap. 8.
(5) V o y e z ci-dessus, pag. $37.
plus
(1) Idem, ibid. C e t obélisque étoit bien plus grand
que le Flaminïus, qui avoit aussi été élevé dans le grand
cirque par Auguste. V o y e z pag. 338.
.(2) L ’obélisque appelé Campensis, qui avoit aussi ete
érigé par Auguste dans le Champ- de M ars , et qu’on a
découvert sous Benoît X IV et releve sous Pie V I , n est
point celui de Séso'stris, dont Pline fait ici mention. En
effet, le fût n’a que 98 palmes Romains [î?i" ,79 ], selon
Vasi ( Itinerario istruttivo di Roma, & c . ) , ou meme
94 palmes 7 [ 21*,01 ] , selon Z o ë g a ,pag. 638. Quand
on comprendroit le piédestal et même le double socle en
marbre blanc sur lequel il repose, on ne trouverait pour
la somme que 130 palmes 7 [ 29“ , 15 ] , selon le premier
auteur; ou 127. palmes [28“ ,3 7 ] , suivant le second.
C e t ancien obélisque du Champ de Maïs , attribué à
plus foible erreur qui entrevoit dans l’évaluation de la mesure, inllueroit.sur
toutes les autres d’une manière plus ou moins considérable. D ’un autre côté,
quelques-uns de ces rapports pourroient laisser de l’incertitude. En effet, tous les
auteurs ne s’accordent pas à ce sujet, du moins en apparence, et plusieurs rapports
ont aussi été modifiés avec te temps. On pourroit échapper à une partie
des inconvéniens de cette méthode , .en prenant pour point de départune mesure
qui occupât le milieu de l’échélf ^métrique, et alors les erreurs seraient atténuées
et partagées entre les divers élémen*; mais ce procédé seroit encore loin d’être
exact. Il est donc nécessaire de recourir à un moyen plus sûr. Ce moyen se présente
de lui-même ; il consiste à déterminer le plus grand nombre possible des
mesures par des voies indépendantes l’une de l’autre, à les classer ensuite, puis
à comparer les rapports qui en résultent avec les rapports constituans que
donnent les auteurs : s’il .y a identité, ce sera une preuve de l’exactitude dés
déterminations.
Nous allons donc puiser dans ce qui précède, les valeurs assignées aux différentes
espèces de mesures, et les rapprocher ensemble. Et d’abord nous commencerons par.
le grand stade Égyptien. Des mesures prises actuellement sur le terrain, comparées
avec les dimensions que Diodore, Stfabon et d’autres auteurs ont rapportées dans
leurs écrits (1), nous ont fourni, pour la valeur du stade Égyptien proprement
dit, une valeur très-approchée de.. 1 8 5 mètres.....................* .............. 185”.
Nous avons trouvé, pour le petit stade Égyptien d’Hérodote, d’Aris-
tote, de Mégasthène, de Néarque, &c., 99 mètres :|'| ou, à fort peu
près, 100 mètres. . . ................................................................................... 100.
Pour le stade d’Ératosthène, d’Hipparque et de Strabon* d’après les
grandes mesures géographiques, et la distance d’Alexandrie àSyène.. 158,7.
Pour le grand schoene Égyptien d’Artémidored’Éphèse, 11095 mètres,
évaluation qui doit se réduire à. .T .............................................................11080.
Pour le schoene d’Hérodote, qui est formé de soixante petits stades,
6025 mètres, ou plutôt 6000 mètres en nombre rond.......................... 6000.
Pour le mill^llomain (1)............................................................ 1 4 8 0 .
11 suit de cette première évaluation, quoique simplement
approximative, que, prenant pour l’unité le centième de l’une
des mesures, du grand stade Égyptien, par exemple, le petit
stade renfermera 5 4 tle ces parties................................................... .5 4-
Le grand schoene. . . ........... , . ................................................ 5989.
Le schoene d’Hérodote, formé de soixante petits stades. . . 3243.
Le mille Romain............................................................................. 800.
Le stade d’Ératosthène.-;......................................... 85,7.
Or les quatre premiers de ces rapports sont visiblement les mêmes que ceux
que présente la table formée suivant- l’exposition d’H érodote, dans la colonne
Orgyie, et qui sont égaux à j 4 > 6000 et 3240 (2).
Le mille Romain étoit l’octuple du stade Olympique, le même que celui dont
(1) V oyez ci-dessus, p a g .jn . . (2) Voye^ le tableau n.° [ I] .