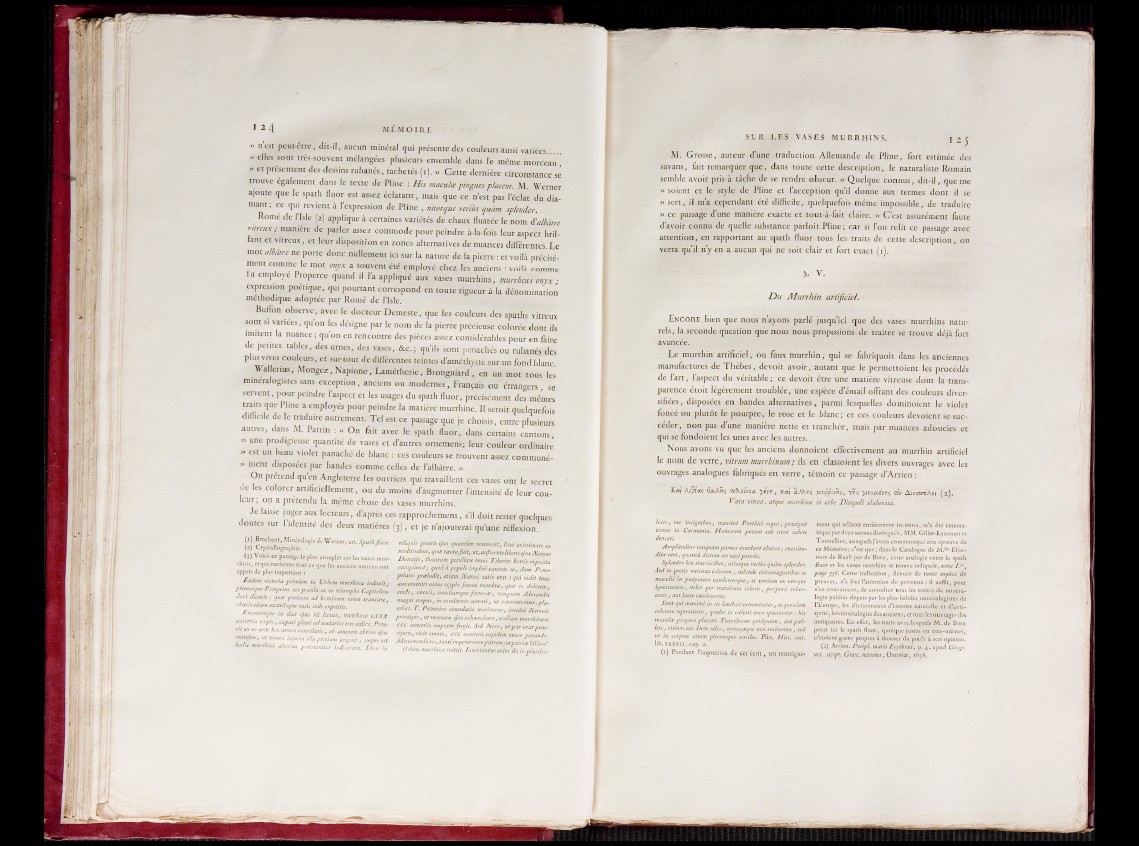
■» nest peut-etre, dit-il, aucun minéral qui présente des couleurs aussi variées.......
» elles sont très-souvent mélangées plusieurs ensemble dans le même morceau
» et présentent des dessins rubanés, tachetés (i). » Cette dernière circonstance sé
trouve également dans le texte de Pline : His maculai pingues placent. M. Wcrner
ajoute que le spath fluor est assez éclatant, mais que ce n’est pas l’éclat du diamant
; ce qui revient à l’expression de Pline , ni,orque verïus quàm splendor.
Rome de 1 Isle (2) applique à certaines variétés de chaux fluatée le nom albâtre
vitreux; manière de parler assez commode pour peindre à-la-fois leur aspect brillant
et vitreux, et leur disposition en zones alternatives de nuances différentes. Le
mot albâtre ne porte donc nullement ici sur la nature de la pierre : et voilà précisément
comme le mot onyx a souvent été employé chez les anciens : voilà comme
la employé Properce quand il l’a appliqué aux vases murrhins, murrheus onyx ■
expression poétique, qui pourtant correspond en toute rigueur à la dénomination
méthodique adoptée par Romé de l’Isle.
Buffon observe, avec le docteur Dcmeste, que les couleurs des spaths vitreux
sont | variées, qu’on les désigne par le nom de la pierre précieuse colorée dont ils
imitent la nuance ; qu’on en rencontre des pièces assez considérables pour en faire
de petites tables, des urnes, des vases, &c.; qu’ils sont panachés ou rubanés des
plus vives couleurs, et sur-tout de différentes teintes d’améthyste sur un fond blanc.
Wallerius, Mongez, Napione, Lamétherie, Brongniard, en un mot tous les
minéralogistes sans exception, anciens ou modernes, Français ou’ étrangers , se
servent, pour peindre l’aspect et les usages du spath fluor, précisément des mêmes
traits que Pline a employés pour peindre la matière murrhine. Il seroit quelquefois
difficile de le traduire autrement. Tel est ce passage que je choisis, entre plusieurs
autres, dans M. Patrin : | On fait avec le spath fluor, dans certains cantons,
» une prodigieuse quantité de vases et d’autres ornemens; leur couleur ordinaire
» est un beau violet panaché de blanc : ces couleurs se trouvent assez communé-
» ment disposées par bandes comme celles de l’albâtre. »
On prétend qu’en Angleterre les ouvriers qui travaillent ces vases ont le secret
de les colorer artificiellement, ou du moins d’augmenter l’intensité de leur couleur,
on a prétendu la meine chose des vases murrhins.
Je laisse juger aux lecteurs, d’après ces rapprochemens, s’il doit rester quelques
doutes sur 1 identité des deux matières (3), et je n’ajouterai qu’une réflexion.
(1) Brochant, Minéralogie de W erner, art. Spath fluor.
(2) Crystallographie.
(3) V o ic i ce passage le plus complet sur les vases mur-
rhins, et qui renferme tout ce que les anciens nousen ont
appris de plus important :.
Eadein Victoria primùm in Urbem murrhina induxit;
primusque Pompeius sex pocula ex eo triumpho Capitolino
Jovi dicavit : qua protinus ad hominurn i/sum transiere,
abacis etiam escariisque vasis inde expetitis.
Excrescitque in dies ejus rei lux us, murrhino LXXX
sesiertus empto, capaci plane ad sexiarios très calice. P o t a-
vit ex eo ante hos annos consularis, ob amorem abroso ej'us I
margine, ut tamen injuria ilia pretium augeret ; neque est
hodie murrhini alterius prastantior indicatura. Idem in
reliquis generis ejus quantùm voraverit, licei ex isti mare ex
multitudine, qua tanta fu it , ut, aufirente liberis ejus Nerone
Domitio, theatrum peculiare trans Tiberim hortis exposita
occuparent; quod à populo impleri canente se, dum Pompeiano
preeludit, etiam Neroni satis erat : qui vidit tunc
annumerati unius scyphi fracta membra, qua in do/orem
credo, sacuii, invidiamque fortuna, tanquam Alexandri
magni corpus, in conditorio servati, ut ostentarentur, pia-
cebut. T. Petronius consularis moriturus, invidia Neronis
principis, ut mensa in ejus exharedaret, indiani murrhinam
CCC scstcrliis empiimi fregit. Sed Nero, ut pa r erat prin-
cipem, vicit omnes, c c c sestertiis capidem unam parando.
M e inorando res, tanti imperatorem pa treni p i e patri a bibisse!
Oriens munhina mittit. Inveniuntur eniin ibi in pluribus
M. Grosse, auteur d’une traduction Allemande de Pline, fort estimée des
savans, fait remarquer que, dans toute cette description, le naturaliste Romain
semble avoir pris à tâche de se rendre obscur. « Quelque connus, dit-il, que me
» soient et le style de Pline et l’acception qu’il donne aux termes dont il se
» sert, il m’a cependant été difficile, quelquefois même impossible, de traduire
» ce passage d’une manière exacte et tout-à-fàit claire. » C ’est assurément faute
d’avoir connu de quelle substance parloit Pline ; car si l’on relit ce passage avec
attention, en rapportant au spath fluor tous les traits de cette description, on
verra qu’il n’y en a aucun qui ne soit clair et fort exact (i).
§■ V.
D u Murrhin artificiel.
E n c o r e bien que nous n’ayons parlé jusqu’ici que des vases murrhins n a tu re
ls , la seconde question que nous nous proposions de traiter se trouve déjà fo r t
avancée.
Le murrhin artificiel, ou faux murrhin, qui se fabriquoit dans les anciennes
manufactures de Thèbes, devoit avoir, autant que le permettoient les procédés
de l’art, l’aspect du véritable ; ce devoit être une matière vitreuse dont la transparence
étoit légèrement troublée, une espèce d’émail offrant des couleurs diversifiées
, disposées en bandes alternatives, parmi lesquelles dominoient le violet
foncé ou plutôt le pourpre, le rose et le blanc; et ces couleurs devoient se succéder,
non pas d’une manière nette et tranchée, mais par nuances adoucies et
qui se fondoient les unes avec les autres.
Nous avons vu que les anciens donnoient effectivement au murrhin artificiel
le nom de verre, vitrum murrhinum; ils en classoient les divers ouvrages avec les
ouvrages analogues fabriqués en verre, témoin ce passage d’Arrien:
K a f A ijic tç v c tA x ç wAefova. y l r n , x a j Ü M r ç //.vppivyîç, tjjç ytvo/iévvç cV AioazroAsi ( z ) .
r a s a vitrea, atque murrhina in u'rbe Diosp o li elaborata.
locis, nec insignibus, màximè Parthici regni; pracipuc ment qui m’étoit entièrement inconnu , m’a été commu-
tamen in Carmania. Humorem putant sub terra calore niqué par deux savans distingués, MM. Gillet-Laumont et
lsar1, ' Tonnellier, auxquels j’avois communiqué une. épreuve de
Amplitudine nusquamparvos excedunt abacos; crassitu- ce Mémoire; c’est que , dans le Catalogue de M.,le Éléodme
raro, quamâ dictum est vasipotorio. nore de Raab par de B om , cette analogie entre le spath
P' en<i° r his sine viribus, nitorque verius quam splendor. fluor et les vases murrhins se trouve indiquée, tome I . " ,
Sed tnpretio vanetas colorum, subinde circumagentibus se page j ; 6 . Cette indication , dénuée de toute espèce de
maculis in purpuram candoremque, et tertiuni ex utroque preuves, n’a fixé l’attention de personne : il suffit, pour
ignescentem, velut per transitum coloris, purpura rubes- s’en convaincre, de consulter tous les traités de minéracente,
aut lacté candescente. logie publiés depuis par les plus habiles minéralogistes de
Sunt qui maxime in iis laudent extremitates, etquosdam l’Europe , les dictionnaires d’histoire naturelle et d’anticolorum
repercussus, quales in coelesti areu spectantur : his quité, les minéralogies des anciens, et tous les ouvrages des
macula pingues placent. Translucere quidquam, aut p a l- antiquaires. En effet, les traits avec lesquels M. de Boni
lere, vitium est. Item sales, verrucaque non eminentes, sed peint ici le spath fluor, quoique justes en eux-mêmes,
ut in corpore etiam plerumque sessiles. Plin. His t. nat. n’étoient guère propres à donner du poids à son opinion,
ib. x x x v i 1, cap. 2. ^ (2) Arrian. Peripl. maris Erythrai, p. 4 , apud Ceogr.
(1) Pendant l’impression de cet é c r it , un renseigne- vet. script. Grac, minores, Oxoniæ, 1698.