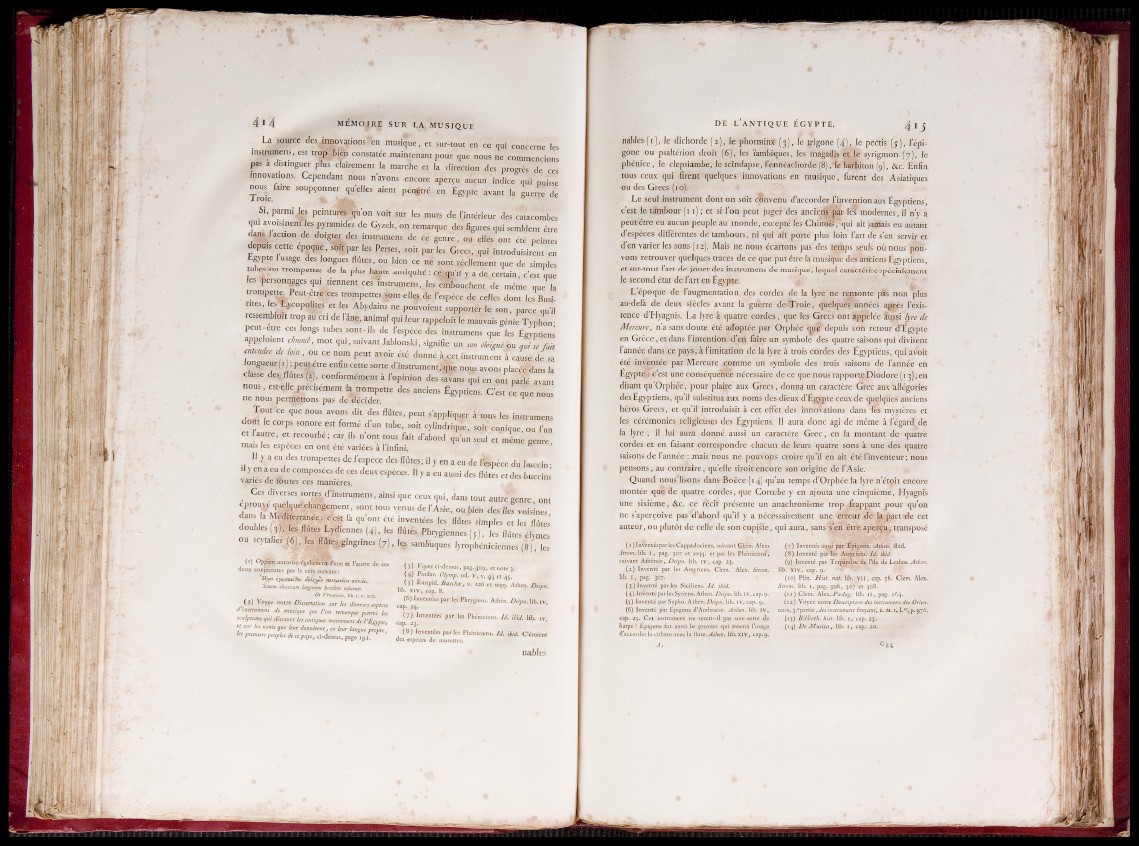
. La,.source ¿nnovationsÎfen musique, et sur-tout en ce qui concerne les
mstrumens, est trop tien constatée maintenant pour que nous ne commencions
pas a distinguer plus clairement la marche et la direction des progrès de ces
innovations. Cependant nous n’avons encore aperçu aucun indice qui pujsse
Troie 6 S°UpÇ° nn" .^ ’cUcs aient en % p t c avant la guerre de
Si, parmi tes pemtui^qü’on voit sur les murs de l’intérieur des catacombes
qm avoisment les pyramides de Gyzeh, on remarque des figures qui semblent être
dansaiacnon de doigter des instrumens de ce genre, ou elles ont été peintes
depuis cette époque, soit par les Perses, soit parles Grecs,'.,qui introduisirent en
gypte usage des longues flûtes, ou bien ce ne sont.réellement que de simples
tubesfou trompettes de la plus haute antiquité : ce.qu’il y a de certain, c’est que
ies f e r s o n i jp s qui tiennent ces instrumens, les einbouchent de même que la
trompettj^ Peut-êtrç/ces trompettes ¿sont-elles de.l’espèce de .celles dont les Busi-
ntes, les^ycopohjçs et les Abydains ne pouvoient supporter le son, parce qu’il
resseiiibioit trop aucri de l’âne, animal qui leur rappeloit'le mauvais génie Typhon-
peut-etre ces longs tubes sont-ils de l’espèce des instrumens que les Égyptiens’
appellent chnouê, mot qui, suivant Jablonski, signifie un son éloigné bu nuise fait
entendre delorn, ou .ce nom peut avoir été donné à ce t instrument t cause de sa
longueur ( ,j; pe^etre enfin cette sorte d’instrument, que nous avons placée'dans la
classe d é p u té s (2), conformément à l’opinion des savans qui en ont parlé avant
nous, est-elle précisément la trompette des anciens Égyptiens. C ’est ce que nous
ne nous permettons pas de'décider.
T o u t -« que nous avons dit des flûtes, peut s’appliquer à-tous les instrumens
dont le corps sonore est formé d’un tube, soit cylindrique, soit conique, ou l’un
et 1 autre, et recourbé; car ils n’ont tous fait d’abord qu’un seul et même genre
mais les especes en ont été variées à l’infini. i ’
Il y a eu des trompettes de l’espèce des flûtes ; il y en a eu de ifepèce du buccin ■
1 É ü af ütfC comPosées de ces deux “ Fèces. Il y a eu aussi des flûtes et des buccins’
varies de toutes ces manières, *
, ^ 6S dÎVerf S ^ ^ d ’instrumens, ainsi que ceux qui, dans tout autre genre ont
éprouve q u e ^ changement, sont tous venus de l’A sie, ou bien des îles voisines
dans la M|d^erranee,y c’esf là qu’ont été inventées les flûtes simples et les flûtes
doubles 3)* les flûtes Lydiennes (4 ), les flûtes Phrygiennes (y), les flûtes élymes
ou scytahes |6), les flutes^gmgrmes {y), sambdques iyrophéniciennes (8) les
(0 Oppién autorise egaierffen&Ihine et l ’autre de ces
deux conjectures par le vers suivant: iytpenftoSvr -/bxiyojr mMjuniïoy eti/\<Sy.
Sonum classkum longarum hostilem tubarum.
Dt Vtnationt, fib. 1, v, 207.
Vo y e z notre Dissertation sur Us diverses apices
i instrumens de musique que l'on remarque parmi Us
sculptura qui décorent Us antiques monument de l ’Egypte,
et sur Us noms que leur donnèrent, en leur tangue propre
Us premiers peupla de ce pays, ci-dessus, page 191.
(3 ) Voyez ci-dessus, pag. 409, et note 3.
(41 Pindar. Olymp, od. v ., v. 44 et 45.
(5 ) Euripid. Bacchat, v. 126 et seqq. Athen. Deipn.
iio . X IV , cap, 8.
(6) Inventées par les Phrygiens. Athen. Deipn, iib. IV
cap. 24,
( 7 ) Inventées par les Phéniciens. Id. ibid. Iib. t v
cap. 2 3 .! -
(8 ) Inventées par les Phéniciens. Id. ibid. C ’étoient
des espèces de musettes.
nables
nables (1), le dichorde (2), le phorminx (3), le nigone (4), le pectis (y), l’épi-
gone ou psaltérion droit (6), les ïambiques, les magadis et le syrigmon. (7), le
phénice, le clepsiambe, le scindapse, i-’ennéachorde (8)/le bàrbiton (9}, &c. Enfin
tous ceux qui firent quelques innovations en musique , furent des Asiatiques
ou des Grecs ( i o).
Le seul instrument dont on soit convenu d’accorder l’invention aux Égyptiens,
c’est le tambour (i 1) ; et si l’on peut juger des ancieijs par 1 * modernes-, il n’y a
peut-être eu aucun peuple au monde, excepté les Chinoif^qui ait jamais eu autant
d espèces différentes de tambours, ni qui ait porté plus loin l’art de s’en servir et
d en varier les sons (12). Mais ne nous écartons pas des temps seuls où nous pouvons
retrouver quelques traces de ce que put être la musique des anciens Égyptiens,
et sur-tout 1 art de jouer des instrumens de musique, lequel caractérise spécialement
le second état de l’art en Égypte.
L époque de l’augmentation des cordes de la lyre ne remonte pis non plus
au-delà de deux siècles avant la guerre de Troie, quelques/années après l’existence
dHyagnis. La lyre à quatre cordes, que les Grecs ont appelée aussi lyre de
Mercure, n’a sans doute été adoptée par Orphée que depuis son retour d’Égypte
en Grèce, et dans l’intention d’en faire un symbole des quatre saisons qui divisent
l’année dans ce pays, à l’imitation de la lyre à trois cordes des Égyptiens, qui avoit
été inventée par Mercure comme un symbole des trois saisons de l’année en
Égypte": c’est une conséquence nécessaire de ce que nous rapporteDiodore (13), en
disant qu’Orphée, pour plaire aux Grecs, donna un caractère Grec aux allégories
des Égyptiens, qu’il substitua aux noms des dieux d’Égypte ceux de quelques anciens
héros Grecs, et qu’il introduisit à cet effet des innovations dans les mystères et
les cérémonies religieuses des Égyptiens. Il aura donc agi de même à l’égard, de
la lyre ; il lui aura donné aussi un caractère Grec, en la montant de quatre
cordes et en faisant correspondre chacun de leurs quatre sons à une des quatre
saisons de l’année : mais nous ne pouvons croire qu’il en ait été l’inventeur ; nous
pensons, au contraire, qu’elle tiroit encore son origine de l’Asie.
Quand nous lisons dans Boëce ( 14 ) qu’au temps d’Orphée la lyre n’étoit encore
montée que de quatre cordes, que Corcebe y en ajouta une cinquième, Hyagnis
une sixième, &c. ce récit présente un anachronisme trop frappant pour qu’on
ne s aperçoive pas d’abord qu’il y a nécèssairement une erreur de la part de cet
auteur, ou plutôt de celle de son copiste, qui aura, sans s’en être aperçu, transposé
( i ) Inventés par les Cappadociens, suivant Glém. Alex»
Strom. Iib. l , pag. 307 et seqq. et par les Phéniciens,
suivant Athénée, Deipn. Iib. i v , cap. 23.
(2 ) Inventé par les Assyriens. Clem. Alex. Strom.
Iib. 1 , pag. 307.
(3 ) Inventé par les Siciliens. Id. ibid.
( 4) Inventé par les Syriens. Athen. Deipn. Iib. IV, cap.9.
(5) Inventé par Sapho. Athen. Deipn. Iib. IV , cap. 9.
(6) Inventé par Ëpigone d’Ambracie. Athen. Iib. IV ,
cap. 25. C e t instrument ne seroit-il pas une sorte de
harpe ! Ëpigone fut aussi le premier qui amena l’usage
d’accorder la cithare avec la flûte. Athen. Iib. x i y , cap.9.
A .
(7 ) Inventés aussi par Ëpigone. Athen. ibid.
(8 ) Inventé p a rles Assyriens. Id. ibid.
(9) Inventé par Teçpàndre de l’île de Lesbos. Athen.
Iib.’ X IV , cap. 9 .' 1
(10) Plin. His t. nai. Iib. vV i i , cap. 56. Clem. Alex.
Strom. Iib. l ,p a g . 306, 307 et 308.
( 1 1 ) Clem. Alex. Pcedag. Iib. 1 1 , pag. 164.
(12 ) Voyez notre Description des instrumens des Orien-
taux, 3:cpartie, des instrumens bruyans, É. M. t. I.cr,p. 976.
(13) Biblioth. hist; lib. I ,'c ap . 23.
( 14) De M u s ica , lib. 1 , cap. 20.