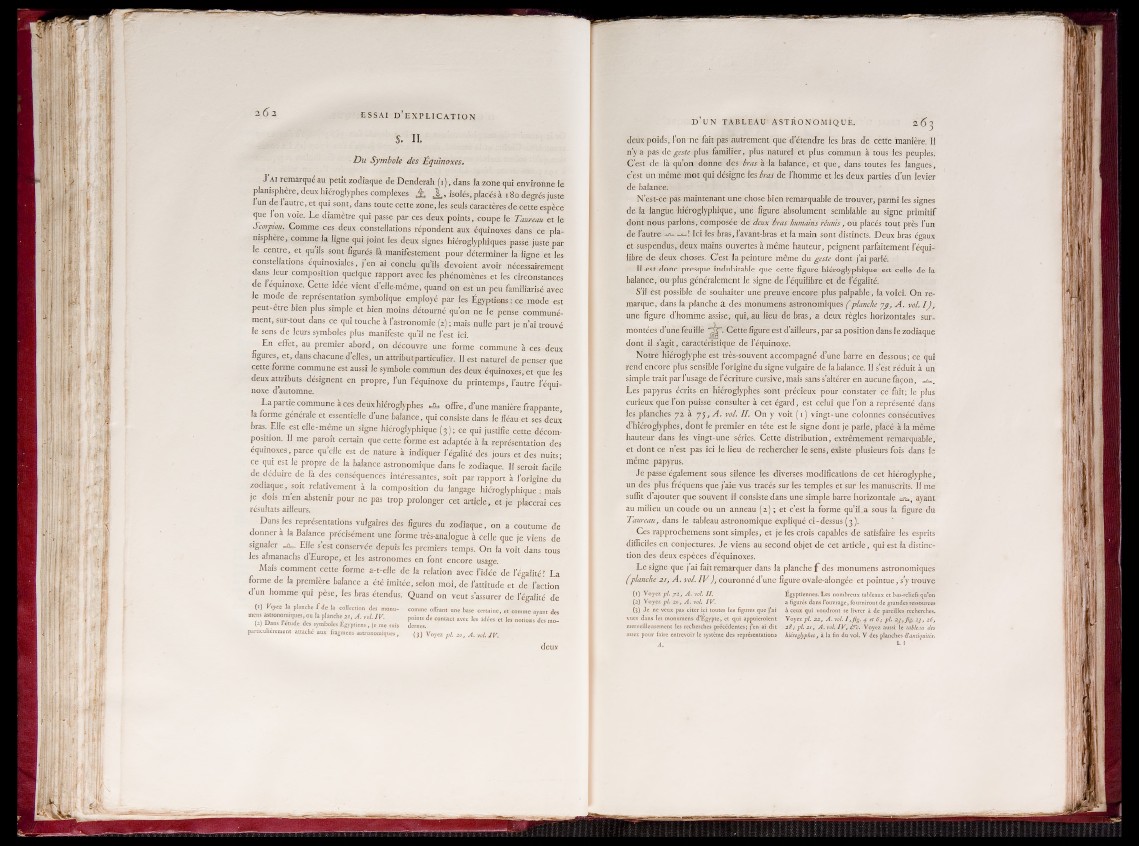
2 ^ 2 E S S A I D ’ E X P L I C A T I O N
S- IL
D u Symbole des Équinoxes.
J ai remai que au petit zodiaque de Denderah (i), dans la zone qui environne ie
planisphère, deux hiéroglyphes complexes isolés, placés à 180 degrés juste
1 un de 1 autre, et qui sont, dans toute cette zone, les seuls caractères de cette espèce
que l’on voie. Le diamètre qui passe par ces deux points, coupe le Taureau et ie
Scorpion. Comme ces deux constellations répondent aux équinoxes dans ce planisphère,
comme la ligne qui joint les deux signes hiéroglyphiques passe juste par
le centre, et quils sont figurés là manifestement pour déterminer la ligne et les
constellations équinoxiales, j’en ai conclu qu’ils devoient avoir nécessairement
dans leur composition quelque rapport avec les phénomènes et les circonstances
de 1 équinoxe. Cette idée vient d’elle-même, quand on est un peu familiarisé avec
le mode de représentation symbolique employé par les Égyptiens : ce mode est
peut-être bien plus simple et bien moins détourné qu’on ne le pense communément,
sur-tout dans ce qui touche à l’astronomie (2) ; mais nulle part je n’ai trouvé
le sens de leurs symboles plus manifeste qu’il ne l’est ici.
En effet, au premier abord, on découvre une forme commune à ces deux
figures, et, dans chacune d elles, un attributparticulier. Il est naturel de penser que
cette forme commune est aussi le symbole commun des deux équinoxes, et que les
deux attributs désignent en propre, l’un l’équinoxe du printemps, l’autre l’équi-
noxe d’automne.
La partie commune a ces deüxhiéroglyphes offre, d’une manière frappante,
la forme générale et essentielle d’une balance, qui consiste dans le fléau et ses deux
bras. Elle est elle-même un signe hiéroglyphique (3) ; ce qui justifie cette décomposition.
Il me paroît certain que cette forme est adaptée à la représentation des
equinoxes, parce qu’elle est de nature à indiquer l’égalité des jours et des nuits;
ce qui est le propre de la balance astronomique dans le zodiaque. Il seroit facile
de déduire de la des conséquences intéressantes, soit par rapport à l’origine du
zodiaque, soit relativement à la composition du langage hiéroglyphique : mais
je dois men abstenir pour ne pas trop prolonger cet article, et je placerai ces
résultats ailleurs.
Dans les représentations vulgaires des figures du zodiaque, on a coutume de
donner à la Balance précisément une forme très-analogue à celle que je viens de
signaler =«,. Elle s’est conservée depuis les premiers temps. On la voit dans tous
les almanachs d’Europe, et les astronomes en font encore usage
Mais comment cette forme a-t-elle de la relation avec l’idée de l’égalité.' La
forme de la première balance a été imitée, selon moi, de l’attitude et de l’action
d un homme qui pèse, les bras étendus. Quand on veut s’assurer de l’égalité de
(I) Voyez la planche f de ^ collection des momi- comme offrant une base certaine, et comme ayant des
M Ï T l Z T r A ' V°L I V - P° imS de C0" ‘aCt ^ \ / ■*-'ans * etude des symboles Egyptiens, je me suis dernes. « 1« "Otions des moparticulièrement
attaché aux fragmens astronomiques, (3 ) V o y e z p i 20, A . vol. I V
deux
deüx poids, l’on ne fait pas autrement que d’étendre les bras de cette manière. Il
n’y a pas de geste plus familier, plus naturel et plus commun à tous les peuples.
C’est de là qu’on donne des bras à la balancé, et que, dans toutes les langues,
c’est un même mot qui désigne les bras de l’homme et les deux parties d’un levier
de balance.
N’est-ce pas maintenant une chose bien remarquable de trouver, parmi les signés
de la Jangùe hiéroglyphique, une figure absolument semblable au signe primitif
dont nous parlons, composée de deux bras humains réunis, ou placés tout près l’un
de l’autre Ici les bras, l’avant-bras èt la main sont distincts. Deux bras égaux
et suspendus, deux mains ouvertes à même hauteur, peignent parfaitement l’équL
libre de deux choses. C ’est la peinture même du geste dont j'ai parlé.
Il est donc presque indubitable que cette figure hiéroglyphique est celle de la
balance, ou plus généralement le signe de l’équilibre et de l’égalité.
S’il est possible de souhaiter une preuve encore plus palpable, la voici. On remarque,
dans la planche a des monumens astronomiques ( planche jp , A . vol. I ) ,
une figure d’homme assise, qui, au lieu de bras, a deux règles horizontales surmontées
d’une feuille Cette figure est d’ailleurs, par sa position dans le zodiaque
dont il s’agit, caractéristique de l’équinoxe.
Notre hiéroglyphe est très-souvent accompagné d’une barre en dessous; ce qui
rend encore plus sensible l’origine du signe vulgaire de la balance. II s’est réduit à un
simple trait par l’usage de l’écriture cursive, mais sans s’altérer en aucune façon, -a».
Les papyrus écrits en hiéroglyphes sont précieux pour constater ce fait; le plus
curieux que l’on puisse consulter à cet égard, est celui que l’on a représenté dans
les planches 72 à 7 5 , A . vol. II. On y voit ( 1 ) vingt-une colonnes consécutives
d’hiéroglyphes, dont le premier en tête est le signe dont je parle, placé à la même
hauteur dans les vingt-une séries. Cette distribution, extrêmement remarquable,
et dont ce n’est pas ici le lieu de rechercher le sens, existe plusieurs fois dans le
même papyrus.
Je passe également sous silence les diverses modifications de cet hiéroglyphe,
un des plus fréquens que j’aie vus tracés sur les temples et sur les manuscrits. Il me
suffit d’ajouter que souvent il consiste dans une simple barre horizontale ayant
au milieu un coude ou un anneau (2) ; et c’est la forme qu’il.a sous la figure du
Taureau, dans le tableau astronomique expliqué ci-dessus (3).
Ces rapprochemens sont simples, et je les crois capables de satisfaire les esprits
difficiles en conjectures. Je viens au second objet de cet article, qui est la distinction
des deux espèces d’équinoxes.
Le signe que j’ai fait remarquer dans la planche f des monumens astronomiques
( planche 21, A . vol. I V ), couronné d’une figure ovale-alongée et pointue, s’y trouve
(1) V o y e z p l. y z , A . vol. I I . Égyptiennes. Les nombreux tableaux et bas-reliefs qu’on
(2) V oyez pl. z o , A . vol. I V . a figurés dans l’ouvrage, fourniront de grandes ressources
(3) Je ne veux pas citer ici toutes les figures que j’ai à ceux qui voudront se livrer à de pareilles recherches,
vues dans les monumens d’E gypte, et qui appuieraient V oyez pl. 22, A . vol. I ,f ig , 4 et 6 ; pl. 2 j,J îg . 2 j , 26,
merveilleusement les recherches précédentes; jen ai dit 28; pl. 2 1 , A . vol. I V , i f c . Voyez aussi le tableau des
assez pour faire entrevoir le système des représentations hiéroglyphes, à la fin du vol. V des planches d’antiquités.
A . L 1