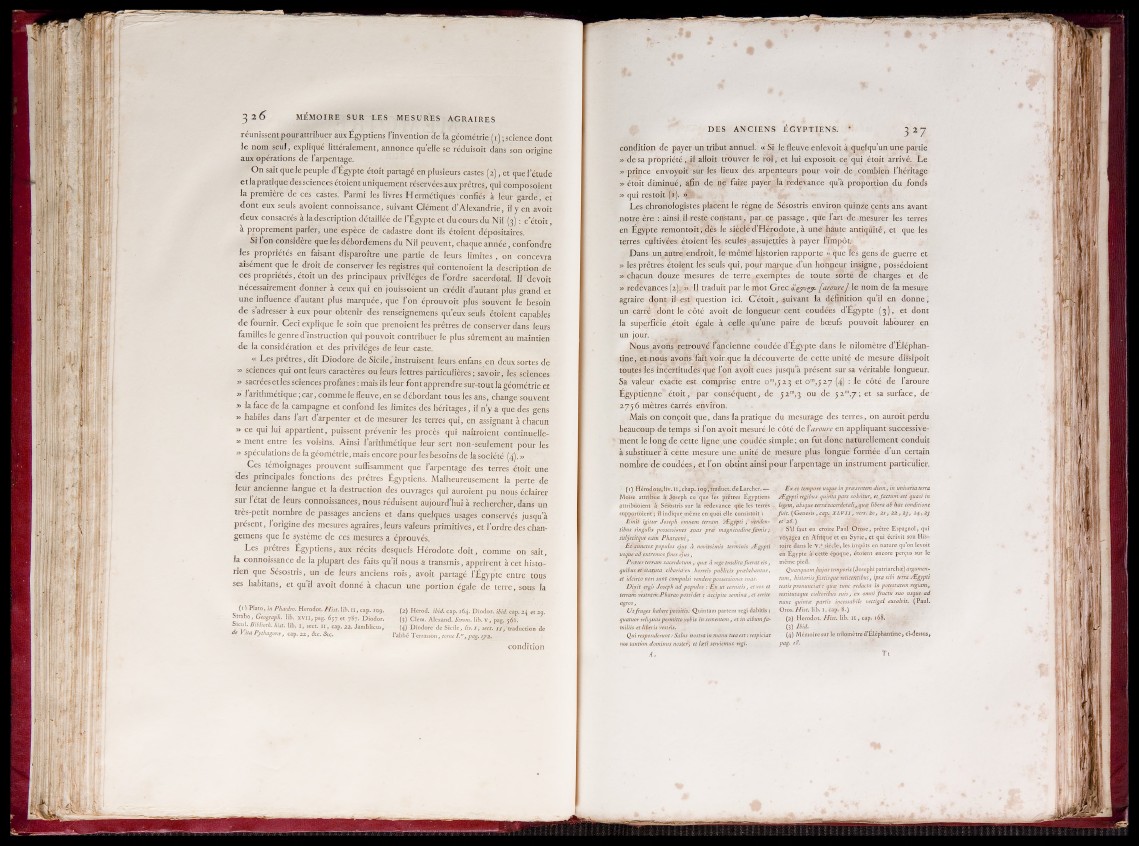
réunissent pour attribuer aux Égyptiens l’invention de ‘la géométrie (1) ¡science dont
le nom seul, expliqué littéralement, annonce qu’elle se réduisoit dans son origine
aux opérations de l’arpentage.
On sait que le peuple d’Égypte étoit partagé en plusieurs castes (2), et que l’étude
et la pratique des sciences etoient uniquement réservées aux prêtres, qui composoient
la première de ces castes. Parmi les livres Hermétiques'confiés à leur gardé, et
dont eux seuls avoient connoissance, suivant Clément d’Alexandrie, il y en avoit
deux consacrés à la description détaillée de l’Égypte et du cours du Nil (3) : c e to it ,
à proprement parler, une espèce de cadastre dont ils étoient dépositaires.
Si 1 on considere que les debordemens du Nil peuvent, chaque année, confondre
les propriétés en faisant disparoitre une partie de leurs limites , on concevra
aisément que le droit de conserver les registres qui contenoient la description de
ces propriétés, etoit un des principaux privilèges de l’ordre sacerdotal. Il de voit
nécessairement donner à ceux qui en jouissoient un crédit d’autant plus grand et
une influence dautant plus marquée, que Ion éprouvoit plus souvent le besoin
de s adresser a eux pour obtenir des renseignemens qu’eux seuls étoient capables
de fournir. Ceci explique le soin que prenoient les prêtres de conserver dans leurs
familles le genre d instruction qui pouvoit contribuer le plus sûrement au maintien
de la considération et des privilèges de leur caste.
« Les prêtres, dit Diodore de Sicile,' instruisent leurs enfans en deux sortes de
» sciences qui ont leurs caractères ou leurs lettres particulières ; savoir, les sciences
» sacrées et les sciences profanes : mais ils leur font apprendre sur-tout la géométrie et
» 1 arithmétique, car, comme le fleuve, en se débordant tous les ans, change souvent
» la face de la campagne et confond les limites des héritages, il n’y a que des gens
» habiles dans l’art d’arpenter et de mesurer les terres qui, en assignant à chacun
» ce qui lui appartient, puissent prévenir les procès qui naîxroient continuelle-
» ment entre les voisins. Ainsi l’arithmétique leur sert non-seulement pour les
» spéculations de la géométrie, mais encore pour les besoins de la société (4). »
Ces témoignages prouvent suffisamment que l’arpentage des terres étoit une
des principales fonctions des pretres Égyptiens. Malheureusement la perte de
leur ancienne langue et la destruction des ouvrages qui auroient pu nous éclairer
sur l’état de leurs connoissances, nous réduisent aujourd’hui à rechercher, dans un
tres-petit nombre de passages anciens et dans quelques usages conservés jusqu’à
présent, loriginedes mesures agraires, leurs valeurs primitives, et l’ordre des clian-
gemens que le système de ces mesures a éprouvés.
Les pretres Égyptiens, aux récits desquels Hérodote doit, comme 011 sait,
la connoissance de la plupart des faits qu’il nous a transmis, apprirent à cet historien
que Sésostris, un de leurs anciens rois, avoit partagé l’Égypte entre tous
ses habitans, et qu’il avoit donné à chacun une portion égale de terre, sous la
( I l Plato, U Phædrû. Herodot. Hist. Iib. n , cap. 109. (a) Herod. ibid. cap. 164. Diodor. ihid. cap, 24 et 29.
Strabo, G'ograph. Iib. x v n , pag. 657 et 787. Diod or. (3) Clem. Alexand. Smm. Iib. v , pag. 566.
bicul. BMmh. iib. I , sect. I I , cap. 22. Jamblicut, (4) Diod ore de S ic ile, liv.l, sect. / / / traduc tion de de Vua Pythagcræ, cap. 2 2 , & c . & c . l’abbé Terrasson, umel.",pag. 172.
condition
condition de payer un tribut annuel. « Si le fleuve enlevoit à quelqu’un une partie
» de sa propriété ,J1 alloit trouver le roi, et lui exposoit ce qui étoit arrivé. Le
» prince envoyoit sur les lieux des arpenteurs pour voir de combien l’héritage
» étoit diminué, afin de ne faire payer la redevance qu’à proportion du fonds
» qui restoit (¡j-. »>
Les chronologistes placent le règne de Sésostris environ quinze cents ans avant
notre ère : ainsi.il reste constant, par ce passage, que l’art de mesurer les terres
en Égypte remontoit, dès le siècle d’Hérodote, à une haute antiquité, et que les
terres cultivées, étoient les seules/assujetties à payer l’impôt.
Dans un autre endroit, le même historien rapporte « que les gens de guerre et
» les prêtres étoient les seuls qui, pour marque d’un honneur insigne, possédoient
» chacun douze mesures de terre .exemptes de toute sorte de charges et de
» redevances (2).- » Il traduit par le mot Grec ¿'yugjc [arôme] le nom de la mesure
agraire dont il est? question ici. C’étoit, suivant la définition qu’il en donne,
un carré dont le côté avoit de longueur cent coudées d’Égypte ( 3 ), et dont
la superficie jé*0*? égale à celle, qu’une paire de boeufs pouvoit labourer en
un jour.
Nous avons‘'retrouvé l’ancienne coudée d’Égypte dans le nilomètre d’Éléphan-
tine, et nous avons fait voir .que la découverte de cette unité de mesure dissipoit
toutes les incertitudes que l’on avoit eues jusqu’à présent sur sa véritable longueur.
Sa valeur exacte est comprise entre om,52 3 et om,y 27 (4) : Ie côté de l’aroure
Égyptienne étoit, par conséquent, de J2m,3 ou de 32'",7; et sa surface, de
2756 mètres éarrés environ.
Mais on conçoit que, dans la pratique du mesurage des terres, on auroit perdu
beaucoup de temps si l’on avoit mesuré Je côté de l’aroure en appliquant successivement
le long de cette ligne une coudée simple; on fut donc naturellement conduit
à substituer à cette mesure une unité de mesure plus longue formée d’un certain
nombre de coudées, et. l’on obtint ainsi pour l’arpentage un instrument particulier.
( 1 ) Hérodote^ liv. i l , chap, i 09 fträduct. de Larcher. —
Moïse attribue à; Joseph ce que les prêtres Egyptiens
attribuoient à Sésostris sur la redevance que les terres
supportoient ; il indique même en quoi elle consistoit : Emit igitur Joseph omnein terrain Ægypti , vénden-
tibus singulis possessiones suas prce magnitudine famis ;
subjecitque eam Pharaoni,
Et cunctos populos ejus à novissimis terminis Ægypti
usque ad extremos fines ejus,
P raster terrain sacerdotum , q u æ à rege tradita fuerat eis,
quitus et statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur,
et idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas.
Dixit ergo Joseph ad populos : En ut cernìtis, et vos et
terram restrain Pharao possidet : occipite semina , et serite
agros ,
Utfruges haberepossitis. Quintana partem regi dabitis : quatuor reliquas permit to vobis in sementem, et in cibum fa-
miliis et liberis vestris.
Qui responderunt : Salus nostra in manu tua est : respiciat
nas tantum dominus noster, et latti serviemus regi.
A.
Ex eo tempore usque in proesentem diem, in universa terra
Ægypti regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in
legem, absque terrasacerdotali, quce libera ab hac conditione
fuit. ( Genesis, cap. XLVII, vers. 20, 21, 22,23, 24,23
' et *26. )
- S’il faut en croire Paul Orose, prêtre Espagnol, qui
voyagea en Afrique et en Sy r ie , et qui écrivit son Histoire
dans le V.c siècle, les impôts en nature qu’on levoit
en Égypte à-cette époque, étoient encore perçus sur le
même pied. | Quanquatn ht/jus temporis (J osephi patriarchs) argumen-
ium, historiis fastisque reticentibus, ipsa sibi terra Ægypti
testis pronunciat : quai tunc redacta in potestatem regiam,
restitutaque cul to ri bus suis, ex ornni fiructu suo usque- ad
nunc quinta* partis incessabile vectigal exsolvit. (Paul.
Oros. Hist. lib. I , cap. 8.)
(2) Herodot. Hist. Iib. I I , cap. 168.
(3 ) Ibid. . ■ ■
(4) Mémoire sur le nilomètre d’EIéphantine, ci-dessus,
pag. t8.
T t