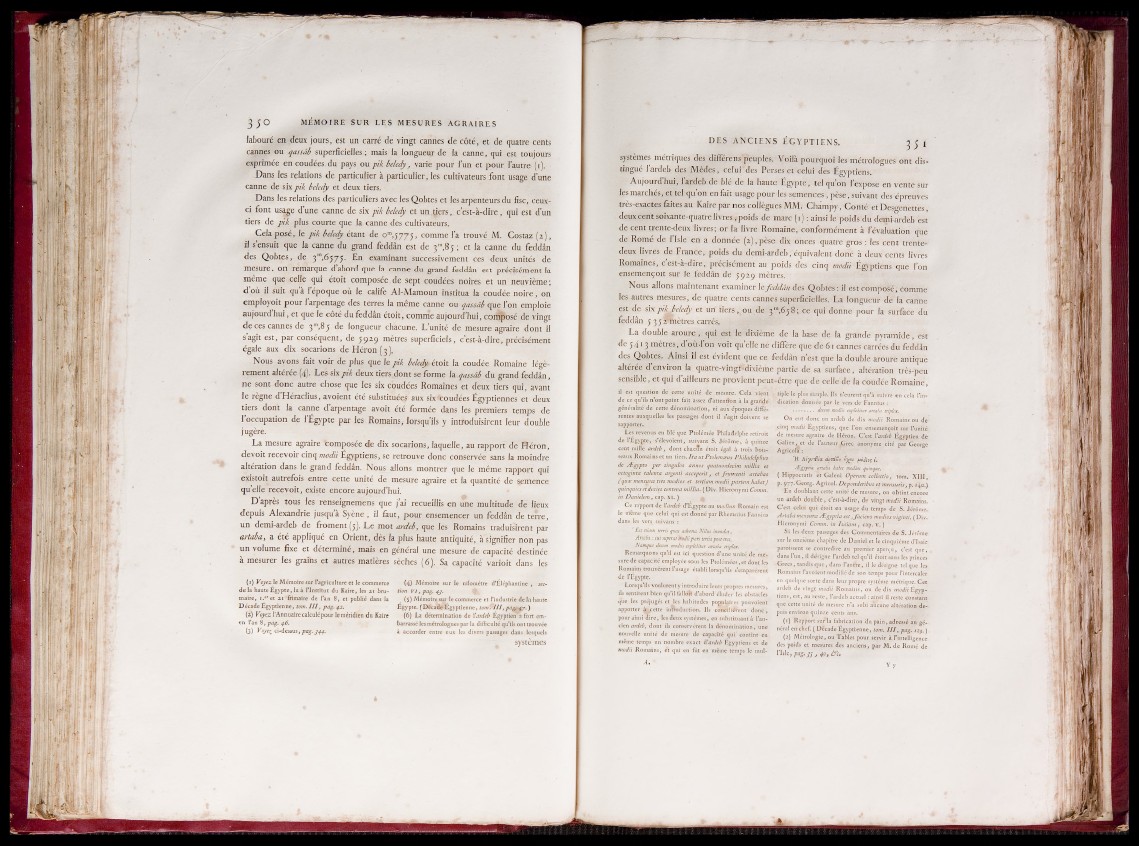
labouré en cieux jours, est un carré de vingt cannes de côté, et de quatre cents
cannes ou qassâb superficielles ; mais la longueur de la canne, qui est toujours
exprimée en coudées,du pays ou pik beledy, varie pour l’un et pour l’autre (i).
Dans les relations de particulier à particulier, les cultivateurs font usage d’une
canne de six pik beledy et deux tiers.
Dans les relations des particuliers avec les Qobtes et les arpenteurs du fisc, ceux-
ci font usage d’une canne de six pik beledy et un ÿers, c’est-à-dire, qui est d’un
tiers de pik plus courte que la canne des cultivateurs.
Gela posé, le pik beledy étant de o*",5775, comme l’a trouvé M. Costaz (2),
il s ensuit que la canne du grand feddân est de 3m,8^ ; et la canne du feddân
des Qobtes, de 3m,6^yy En examinant successivement ces deux unités de
mesure, on remarque d abord que la canne du grand feddân est précisément la
meme que celle qui etoit composée de sept coudées noires et un neuvième;
d ou il suit qu a 1 epoque ou le calife Al-Mamoun institua la coudée noire, on
employoit pour 1 arpentage des terres la meme canne ou qassâb que l’on emploie
aujourd hui, et que le cote du feddan etoit, comme aujourd’hui, composé de vingt
de ces cannes de 3m>&5 de longueur chacune. L ’unité de mesure agraire dont il
s agit est, par conséquent, de 5929 mètres superficiels, c’est-à-dire, précisément
égale aux dix socarions de Héron ( 3 ).
Nous avons fait voir de plus que le pik beledy étoit la coudée Romaine légèrement
alteree (4 )- Les six pik deux tiers dont se forme \&sqassâb du grand feddân,
ne sont donc autre chose que les six coudées Romaines et deux tiers qui, avant
le regne dHeraclius, avoient été substituées aux six ^coudées Égyptiennes et deux
tiers dont la canne d arpentage avoit été formée dans les premiers temps de
1 occupation de 1 Égypte par les Romains, lorsqu’ils y introduisirent leur double
jugère.
L a mesure agraire ^composée de dix socarions, laquelle, au rapport de Héron,
devoit recevoir cinq modii Égyptiens, se retrouve donc conservée sans la moindre
altération dans le grand feddan. Nous allons montrer que le même rapport qui
existoit autrefois entre cette unité de mesure agraire et la quantité de semence
qu’elle recevoit, existe encore aujourd’hui.
D après tous les renseignemens que j’ai recueillis en une multitude de lieux
depuis Alexandrie jusqua Syene, il faut, pour ensemencer un feddân de terre,
un demi-ardeb de froment (^). Le mot ardeb, que les Romains traduisirent par
artaba, a ete applique en Orient, des la plus haute antiquité, à signifier non pas
un volume fixe et déterminé, mais en général une mesure de capacité destinée
a mesurer les grains et autres matières seches (6). Sa capacité varioit dans les
(1) Foyez lé Mémoire sur l’agriculture et le commerce (4) Mémoire sur le nilométre d’ÉIéphantine , sec-
d e là haute E gyp te, lu à l’ Institut du Kaire, les 21 bru- tion v i , pag. 43.
maire, i . c ret 21 frimaire de l’an 8, et publié dans la (5) Mémoire sur le commerce et l’industrie d e là haute
Décade Égyptienne, tom. III, pag. 4.2. Égypte. ( Décade Égyptienne, tom. I I I , pag.^y. )
(2) Voyez l’Annuaire calculé pour le méridien du Kaire (6) La détermination de l'ardeb Égyptien a fort emen
1 an 8 , pag. 46. barrasse les métrologues par la difficulté qu’ils ont trouvée
(3) Foyeç ci-dessus, pag. 344. à accorder entre eux les divers passages dans lesquels
systèmes
systèmes métriques des différens peuples. Voilà pourquoi les métrologues ont distingué
l’ardeb des Mèdes , celui des Perses et celui des Égyptiens.
Aujourd’hui, l’ardeb de blé de la haute Égypte, tel qu’on l’éxpose en vente sur
les marchés, et tel qu’on en fait usage pour les semences, pèse, suivant des épreuves
très-exactes faites au Kaire par nos collègues MM. Cha'mpy, Conté et Desgenettes,
deuxcentsoixante-quatrelivresspoids de marc (i ) : ainsi le poids du demi-ardeb est
de cent trente-deux livres ; or la livre Romaine, conformément à l’évaluation que
de Romé de 1 Isle en a donnée (2), pèse dix onces quatre gros : les cent trente-
deux livres de France, poids du demi-ardeb, équivalent donc à deux cents livres
Romaines, cest-a-dire, précisément au poids des cinq modii Égyptiens que l’on
ensemençoit sur le feddân de 5929 mètres.
Nous allons maintenant examiner le feddân des Qobtes : il est composé, comme
les autres mesures, de quatre cents cannes superficielles. La longueur de la canne
est d e■ sixpij^eledy et un tiers, ou de 3IT1,6 j8; ce qui donne pour la surface du
feddân y 35 Fmètres carrés.
La double aroure, qui est le dixième de la base de la grande pyramide, est
de 5 4 13 mètres, d ou-1 on voit qu elle ne diffère que de 61 cannes carrées du feddân
des Qobtes. Ainsi il est évident que ce feddân n’est que la double aroure antique
altérée d environ la quatre-vingf-dixième partie de sa surface, altération très-peu
sensible, et qui d’ailleurs ne provient peut-être que de celle de la coudée Romaine,
il est question de cette unité de mesure. Ce la vient
de ce qu’ ils n’ont point fait assez d’attention à la grande
généralité de cette dénomination, ni aux époques différentes
auxquelles les passages dont il s’agit doivent se
rapporter.
Les revenus en blé que Ptolémée Philadelphe retiroit
de l’Egypte, s’élevoient, suivant S. Jérôme, à quinze
cent mille ardeb , dont chacun étoit égal à trois boisseaux
Romains et un tiers. Ita ut Ptolemoeus Philadelphus
de Ægypto per singulos annos quatuordecim tnillia et
octoginta talenta argenti acceperit, et frumenti artabas
( quæ mensura très modios et tertiam modii partem babet)
quinquieset decies contenu millia. (D iv . Hieronymi Cornm.
in Danieletn, cap. XI. )
C e rapport de Y ardeb d’Egypte au modius Romain est
le même que celui qui est donné par Rhemnius Fannius
dans les verç suivans :
Est ctiam terris qitas advena Nilus in nnd.it,
Artaba : cui superat modii pars tertia post très,
Namqitc deccin modiis explebitur artaba triplex.
Remarquons qu’ il est ici question d’une unité de me-
sufe de capacité employée sous les Ptolémées, et dont les
Romains trouvèrent 1 usage établi lorsqu’ ils s’emparèrent
de l’Egypte.
Lorsqu’ils voulurent y introduire leurs propres mesures,
ils sentirent bien qu’il falldit d’abord'éïuder les obstacles
que les préjugés et les habitudes populaires pouvoient ’
apporter à- cette introduction, lis concilièrent donc ,
pour ainsi aire, les deux systèmes, en substituant à l’ancien
ardeb, dont ils conservèrent la dénomination, une
nouvelle unité de mesure de capacité qui' contînt en
même temps un nombre exact d'ardeb Égyptiens et de
modii Romains, et qui en fut en même temps le multiple
le plus simple. Ils n’eurent qu’à suivre en cela l’indication
donnée par le vers de Fannius :
....... decem modiis explebitur artaba triplex.
On eut donc un ardeb de dix modii Romains ou de
cinq modii Egyptiens, que l’on ensemençoit sur l’unité
de mesure agraire de Héron. C ’est l'ardeb Egyptien de
Galien. et de l’auteur .Grec anonyme cité par George
Agricola :
H Aiyj-Hia. cù>mCn iy t t /uodtoçt.
Ægyptia artaba habet modios quinque.
( Hippocratis et Galêni Operum collectio, tom. X I I I ,
p. 977* Georg. Agricol. Deponderibus et mensuris, p. 140.)
En doublant cette unité de mesure, on obtint encore
un ardeb dou ble , c’est-à-dire, de vingt modii Romains. ■
C ’est celui qui étoit en usage du temps de S. Jérôme.
Artabamensura Ægyptia est,faciens modios viginti. (Div.
Hieronymi Comm. -in Isaiatn, cap. v . )
S i les deux passages des Commentaires de S. Jérôme
sur le onzième chapitre de Daniel et le cinquième d’Isaïe
paroissent se contredire au premier aperçu, c’est que, *
dans l’u n , il désigne l’ardeb tel qu’ il étoit sous les princes
G recs, tandis que , dans l’autVe, il le désigne tel que les
Romains l’avoient modifié de son temps pour l’intercaler
en quelque sorte dans leur propre système métrique. Cet
ardeb de vingt modii Romains, ou de dix modii, É g yp - _
tiens, est, au reste, l’ardeb actuel : ainsi il reste constant
que cette unité de mesure n’a subi aucune altération depuis
environ quinze cents ans.
(1) Rapport sur la fabrication 'du pain, adressé au général
en chef. (Dé cade Égyptienne, tom. I I I , pag. 12p. )
(2) Métrologie, ou Tables pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, par M . de Romé de
l’ Isle, pag, 3 3 , 40, ¿ si,
Y y