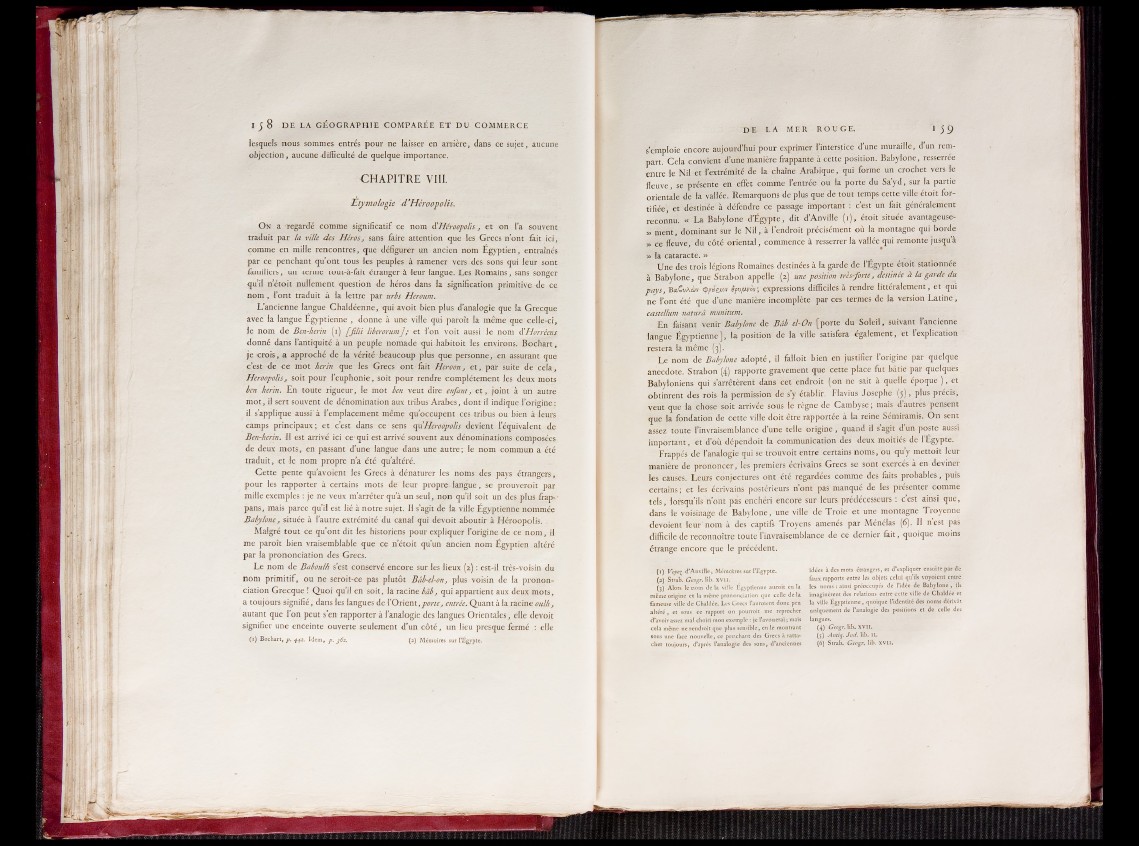
lesquels nous sommes entrés pour ne laisser en arrière, dans ce sujet, aucune
objection, aucune difficulté de quelque importance.
C H A P IT R E VIII.
Etymologie d ’Héroopolis.
O n a regardé comme significatif ce nom d’Héroopolis, et on l’a souvent
traduit par la ville des Héros, sans faire attention que les Grecs n’ont lait ici,
comme en mille rencontres, que défigurer un ancien nom Égyptien, entraînés
par ce penchant qu’ont tous les peuples à ramener vers des sons qui leur sont
familiers, un terme tout-à-fàit étranger à leur langue. Les Romains, sans songer
qu’il n’étoit nullement question de héros dans la signification primitive J e ce
n om , l’ont traduit à la lettre par tirls Heroum.
L’ancienne langue Chaldéenne, qui avoit bien plus d’analogie que la Grecque
avec la langue Égyptienne , donne à une ville qui paroît la même que celle-ci,
le nom de Ben-herin (i) [filii lilerorumj; et l’on voit aussi le nom d’Horréens
donné dans l’antiquité à un peuple nomade qui habitoit les environs. Bochart,
je crois, a approché de la vérité beaucoup plus que personne,.en assurant que
c ’est de ce mot herin que les Grecs ont fait Heroon, e t, par suite de cela,
Heroopolis, soit pour l’euphonie, soit pour rendre complètement les deux mots
ben herin. En toute rigueur, le mot ben veut dire enfant, e t , joint à un autre
mot, il sert souvent de dénomination aux tribus Arabes, dont il indique l’origine :
il s’applique aussi'à l’emplacement même qu’occupent ces tribus ou bien à leurs
camps principaux ; et c’est dans ce sens tpi’Heroopolis deyient l’équivalent de
Ben-herin. II est arrivé ici ce- qui est arrivé souvent aux dénominations composées
de deux mots, en passant d’une langue dans une autre; le nom commun a été
traduit, et le nom propre n’a été qu’altéré.
Cette pente qu’avoient les Grecs à dénaturer les noms des pays étrangers,
pour les rapporter à certains mots de leur propre langue, se prouveroit par
mille exemples : je ne veux m’arrêter qu’à un seul, non qu’il soit un des plus frap--
pans, mais parce qu’il est lié à notre sujet. Il s’agit de la ville Égyptienne nommée
Babylone, située à l’autre extrémité du canal qui devoit aboutir à Héroopolis.
Malgré tout ce qu’ont dit les historiens pour expliquer l’origine de ce nom, il
me paroît bien vraisemblable que ce n’étoit qu’un ancien nom Égyptien altéré
par la prononciation des Grecs.
Le nom de Baboulh s’est conservé encore sur les lieux (2) : est-il très-voisin du
nom primitif, ou ne seroit-ce pas plutôt Bâb-el-on, plus voisin de la prononciation
Grecque ! Quoi qu’il en soit, la racine bâb, qui appartient aux deux mots,
a toujours signifié, dans les langues de l’O rient,porte, entrée. Quant à la racine oulh,
autant que l’on peut s’en rapporter à l’analogie des langues Orientales, elle devoit
signifier une enceinte ouverte seulement d’un côté , un lieu presque fermé : elle
( 1) Bochart, p . 442. Idem, p . 3 6 z, (2) Mémoires sur I’Égypte.
s’emploie encore aujourd’hui pour exprimer l’interstice d’une muraille, dun rempart.
Cela convient d ’u n e manière frappante à cette position. Babylone, resserrée
entre le Nil et l’extrémité de la chaîne Arabique, qui forme un crochet vers le
fleuve, se présente en effet comme l’entrée ou la porte du Sa’yd, sur la partie
orientale de la vallée. Remarquons de plus que de tout temps cette ville étoit fortifiée,
et destinée à défendre ce passage important : c’est un fait généralement
reconnu. « La Babylone d’Égypte, dit d’Anville (i), étoit située avantageuse-
« ment, dominant sur le Ni l , à l’endroit précisément où la montagne qui borde
» ce fleuve, du côté oriental, commence à resserrer la vallée^qui remonte jusquà
» la cataracte.»
Une des trois légions Romaines destinées à la garde de l’Égypte étoit stationnée
à Babylone, que Strabon appelle (2) une position très-forte, destinée à la garde du
pays, Bie€vÀÙv qpu&iov expressions difficiles a rendre littéralement, et qui
ne l’ont été que d’une manière incomplète par ces termes de la version Latine,
castellum naturâ munitimi.
En faisant venir Babylone de Bâb el-On j porte du Soleil, suivant 1 ancienne
langue Égyptienne j , la position de la ville satisfera également, et 1 explication
restera la même (3).
Le nom de Babylone adopté, il fàlloit bien en justifier l’origine par quelque
anecdote. Strabon (4 ) rapporte gravement que cette place fut bâtie par quelques
Babyloniens qui s’arrêtèrent dans cet endroit [on ne sait a quelle epoque ) , et
obtinrent des rois la permission de s’y établir. Flavius Josephe (5), plus précis,
veut que la chose soit arrivée sous le règne de Cambyse ; mais d’autres pensent
que la fondation de cette ville doit être rapportée à la reine Sémiramis. On sent
assez toute l’invraisemblance d’une telle origine , quand il s agit dun poste aussi
important, et d’où dépendoit la communication des deux moitiés de l’Égypte.
Frappés de l’analogie qui se trouvoit entre certains noms, ou quy mettoit leur
manière de prononcer, les premiers écrivains Grecs se sont exerces a en devinei
les causes. Leurs conjectures ont été regardées comme des faits probables, puis
certains ; et les écrivains postérieurs n ont pas manque de les présenter comme
tels, lorsqu’ils n’ont pas enchéri encore sur leurs prédécesseurs : c’est ainsi que,
dans le voisinage de Babylone, une ville de Troie et une montagne Troyenne
devoient leur'nom à des captifs Troyens amenés par Menelas (6). Il nest pas
difficile de reconnoître toute l’invraisemblance de ce dernier fait, quoique moins
étrange encore que le précédent.
(1) Voyti d’A n v ille , Mémoires sur l’Egypte. idées à des mots étrangers, et d’expliquer ensuite par de
(2) Strab. Geogr. lib. XVII. faux rapports entre les objets celui qu’ils yoyoient entre
(3) Alors le nom de la ville Égyptienne auroit eu la les noms : ainsi préoccupés de l’idée de B a b y lo n e , ils
même origine et la même prononciation que celle de la imaginèrent des relations entre cette ville de Cbaldee et
fameuse ville de Chaldée. Les Grecs l’auroient donc peu la ville Égyptienne, quoique l'identité des noms dérivât
altéré , et sous ce rapport on pourvoit me reprocher uniquement de 1 analogie des positions et de celle des
d’avoir assez mal choisi mon exemple : je l’avouerai ; mais langues.
cela même ne rendroit que plus sensible, en le montrant ( 4) Geogr. lib. X VII.
sous une face nouvelle, ce penchant des Grecs à ratta- (5) Antiq. Jud. lib. H.
cher toujours, d’après l’analogie des sons, d’anciennes (6) Strab. Geogr. lib. x v i i .