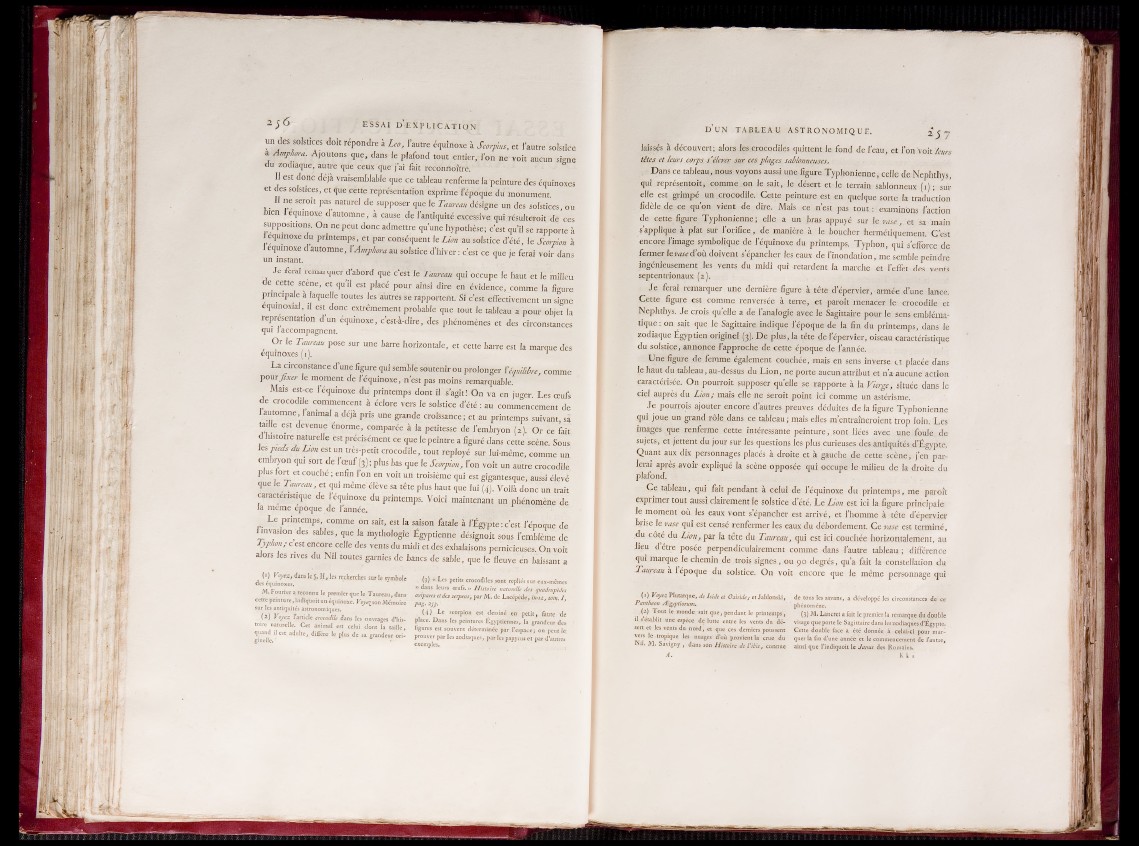
un des solstices doit répondre à Léo, l’autre équinoxe à Scorplus, et l’autre solstice
a Amplwra. Ajoutons que, dans le plafond tout entier, l’on ne voit aucun signe
du zodiaque, autre que ceux que j’ai fait reconnoître.
II est donc déjà vraisemblable que ce tableau renferme la peinture des équinoxes
et des solstices, et que cette représentation exprime l’époque du monument.
11 f S seroit Pas_ naturel de supposer que le Taureau désigne un des solstices, ou
bien equinoxe d automne, à cause de l’antiquité excessive qui résulteroit de ces
suppositions. On ne peut donc admettre qu’une hypothèse; c’est qu’il se rapporte à
lequinoxedu printemps, et par conséquent le Lion au solstice d’été, le Scorpion à
equinoxe d automne, ÏAmphora au solstice d’hiver : ¿est ce que je ferai voir dans
un instant.
Je ferai remarquer d’abord que ¿est le Taureau qui occupe le haut et le milieu
e cette scene, et qu’il est placé pour ainsi dire en évidence, comme la figure
principale à laquelle toutes les autres se rapportent. Si c’est effectivement un signe
équinoxial, il est donc extrêmement probable que tout le tableau a pour objet la
représentation d’un équinoxe, c’est-à-dire, des phénomènes et des circonstances
qui 1 accompagnent.
, ° r le Taunali pose sur une barre horizontale, et cette barre est la marque des
equinoxes (i).
La circonstance d’une figure qui semble soutenir ou prolonger l'équilibre, comme
poux fixer le moment de l’équinoxe, n’est pas moins remarquable.
Mais est-ce Jequinoxe.du printemps dont il s’agit! On va en juger. Les oeufs
de crocodile commencent à éclore vers le solstice d’été : au commencement de
iautomne, 1 animal a déjà pris une grande croissance; et au printemps suivant, sa
taille est devenue énorme, comparée à la petitesse de l’embryon (2). Or ce fait
d histoire naturelle est précisément ce que le peintre a figuré dans cette scène. Sous
f . est un très-petit crocodile, tout reployé sur lui-même, comme un
ermiyon qui sort de i oe uf (3); plus Las que Je Scorpion, l’on voit un autre crocodile
plus fon et couché ; enfin l’on en voit un troisième qui est gigantesque, aussi élevé
que te laureau, et qui même élève sa tête plus haut que lui (4). Voilà donc un trait
caractéristique de J’équinoxe du printemps. Voici maintenant un phénomène de
ia meme époque de l’année.
Le printemps, comme on sait, est 1a saison fatale à l’Égypte : c’est l’époque de
invasion des sables, que la mythologie Égyptienne désignoit sous l’emblème de
Typhon; c est encore celle des vents du midi et des exhalaisons pernicieuses. On voit
alors les rives du Nil toutes garnies de bancs de sable, que le fleuve en baissant a
J l u i « « . 113"* k S' H’lB r-CherCheS SM fe s3™b°1' (3) i l P'** crocodiles sont repliés sur eurt-mêmes
M ” dans ^eurs oeufs. » H is to ir e naturelle des quadrupèdes
retVen P.remKr Ie Taur' au’ »»/*>*■> t ld , s scrptns, par M . de JLacépèdc, ¡ 1 , 2 , Jm I
cette peinture, indiquoit un équinoxe. Voye^son Mémoire p a g, 2} J . ’
sur les annuités astronomiques (4) Le scorpion est dessiné en petit, faute de
L o i r e " ' i l r “ ° u v r a S « d ’h is - P 'a c c . Dans les peintures Égyptiennes, la grandeur des
quand iTesT ad . ^ ' d T , 1 d°nt I W “ ~ ^ n n in ïp a r Pesp J ; on peut ie
‘ ’ e p lu ! d e s a 8 r a n d c u r o r ‘ - P r o u v c r par les zodiaques, par les papyrus et par d’autres
laissés à découvert; alors les.crocodiles quittent le fond de l’eau, et l’on voit leurs
têtes et leurs corps s ’élever sur ces plages sablonneuses.
Dans ce tableau, nous voyons aussi une figure Typhonienne, celle de Nephthys,
qui représentoit, comme on le sait, le désert et le terrain sablonneux (i) ; sur
elle est grimpé un crocodile. Cette peinture est en quelque sorte la traduction
fidèle de ce qu’on vient de dire. Mais ce n’est pas tout : examinons l’action
de cette figure Typhonienne; elle a un bras appuyé sur le vase, et sa main
s’applique à plat sur l’orifice, de manière à le boucher hermétiquement. C’est
encore l’image symbolique de l’équinoxe du printemps. Typhon, qui s’efforce de
fermer te vase d’où doivent s’épancher les eaux de l’inondation, me semble peindre
ingénieusement les vents du midi qui-retardent la marche et l’effet des vents
septentrionaux (2).
Je ferai remarquer une derniere figure à tête d’épervier, armée d’une lance.
Cette figure est comme renversée à terre, et paroît menacer le crocodile et
Nephthys. Je crois qu’elle a de l’analogie avec le Sagittaire pour le sens emblématique
: on sait que le Sagittaire indique l’époque de la fin du printemps, dans le
zodiaque Égyptien originel (3). De plus,la tête delepervier, oiseau caractéristique
du solstice, annonce l’approche de cette époque de l’année.
Une figure de femme également couchée, mais en sens inverse a placée dans
le haut du tableau, au-dessus du Lion, ne porte aucun attribut et n’a aucune action
caractérisée. On pourroit supposer qu’elle se rapporte à la Vierge, située dans le
ciel auprès du Lion; mais elle ne seroit point ici comme un astérisme.
Je pourrois ajouter encore d’autres preuves déduites de la figure Typhonienne
qui joue un grand rôle dans ce tableau ; mais elles m’entraîneroient trop loin. Les
images que renferme cette intéressante peinture, sont liées avec une foule de
sujets, et jettent du jour sur les questions les plus curieuses des antiquités d’Égypte,
Quant aux dix personnages placés à droite et à gauche de cette scène, j’en parlerai
après avoir expliqué la scène opposée qui occupe le milieu de la droite du
plafond.
Ce tableau, qui fait pendant à celui de l’équinoxe du printemps, me paroît
exprimer tout aussi clairement le solstice d’été. Le Lion est ici la figure principale
le moment ou les eaux vont s’épancher est arrivé, et l’homme à tête d’épervier
brise le vase qui est censé renfermer les eaux du débordement. Ce vase est terminé,
du côté du Lion, par la tête du Taureau, qui est ici couchée horizontalement, au
lieu d etre posée perpendiculairement comme dans l’autre tableau ; différence
qui marque^ le chemin de trois signes, ou 90 degrés, qu’a fait la constellation du
Taureau à 1 époque du solstice. On voit encore que le même personnage qui
( 1 ) Voyez Plutarque, de Iside et 0 si ride; et Jablonski, de tous les savans, a développé les circonstances de ce
Panthéon Ægyptiorum. j phénomène.
| | ^ 0ut Ie monde sa»« q«e, pendant le printemps, (3) M. Lancret a fait le premier la remarque du double
1 * - une esPèce de lutte entre les vents du dé- visage que porte le Sagittaire dans les zodiaques d’Égypte.
sert et- les vents du nord, et que ces derniers poussent Cette double face a été donnée à celui-ci pour mar-
NM m t çG?I?ue Ies nuaSes d’où provient la crue du quer la fin d’une année et le commencement de l’autre,
1 . M. Savigny , dans son Histoire de l'ib is , connue ainsi que ¡’ indiquoit le Janus des Romains.
A. ® K k *