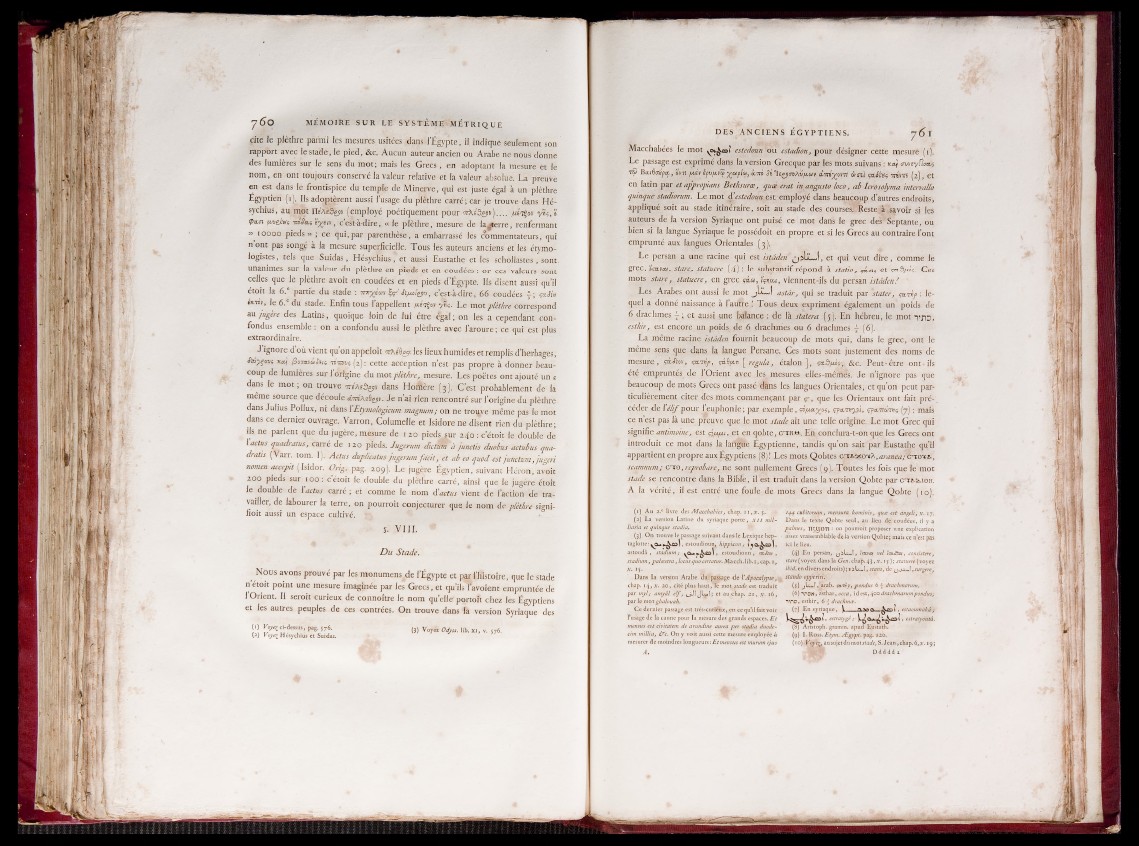
y Ô O M É M O I R E S U R L E S Y S T È M Ë M É T R I Q U E
cite le plethre paimi les mesures usitces dans iEgypte, il indique seulement son
rapport avec le stade, le pied, &c. Aucun auteur ancien ou Arabe ne nous donne
des lumières sur le sens du mot; mais les Grecs , en adoptant la mesure et le
nom, en ont toujours conservé la valeur relative et la valeur absolue. La preuve
en est dans le frontispice du temple de Minerve, qui est juste égal à un plèthre
Egyptien (i) Ils adoptèrent aussi l’usage du plèthre carré; car je trouve dans Hé-
sychius, au mot néA'êâjyv (employé poétiquement pour •u\é9çpti'j,... pdiçoii yXç, o
cpasn iA.vci.Vf ■mia.i g g | | cest-à-dire, « le plèthre, mesure de la^terre, renfermant
» toooo pieds» ; ce qui,par parenthèse, a embarrassé les commentateurs, qui
n ont pas songe à la mesure superficielle. Tous les auteurs anciens et les étymo-
logistes, tels que Suidas, Hésychius, et aussi Eustathe et les schofiastes , sont,
unanimes sur la valeur du plethre en pieds et en coudées : or ces valeurs sont
celles que le plèthre avoit en coudées et en pieds d’Egypte. Ils disent aussi qu’il
étoit la 6.' partie du stade : £ç-' JV^/gou, c’est-à-dire, 66 coudées f ; çnSia
tu.™, le 6.' du stade. Enfin tous l’appellent yuéiçov Le mot plèthre correspond
au jugère des Latins, quoique loin de iui être égal; on les a cependant confondus
ensemble : on a confondu aussi le plèthre avec i’aroure ; ce qui est plus
extraordinaire.
J ignore d où vient qu on appeloit arhé&gy. les lieux humides et remplis d’herbages,
SVj^ ovî xaj Ponoûhiç A-mv; (2) : cette acception n’est pas propre à donner beaucoup
de lumières sur 1 origine du mot plèthre, mesure. Les poètes ont ajouté un e
dans le mot ; on trouve 7réA£%>» dans Hoiftère ( 3 ). C ’est probablement de la
même source que découle dmixt6gyv. Je n’ai rien rencontré sur l’origine du plèthre
dans Julius Pollux, ni dans 1 Etymologicum magnum; on ne trouve même pas le mot
dans ce dernier ouvrage. Varron, Columelle et Isidore ne disent rien du plèthre;
ils ne parlent que du jugère, mesure de 120 piedssur 240 : cetoit le double de
\actiis quadroius, carré de 120 pieds. Jugcrum diçtuinà junctis duobus actubus qua-
dratis (Varr. tom. I). Actus duplicatas jugerum frteit, et ab eo quod est junctum, jugeri
nomen accepit (Isidor. Ong. pag. 209). Le jugère Égyptien, suivant Héron, avoit
200 pieds sur 100: c étoit le double du plèthre carré, ainsi que le jugère étoit
le double de 1 actus carre ; et comme le nom à’actus vient de l’action de travailler,
de labourer la terre, on pourrait conjecturer que le nom de plèthre signi-
fioit aussi un espace cultivé. ;
Si V U E
D u Stade.
, Nous avons prouvé par les monumens^de l’Egypte et par l’h’istoire, que le stade
n’étoit point une mesure imaginée par les Grecs, et qu’ilsfavoient empruntée de
1 Orient. Il serait curieux de connoître le nom qu’elle portoft chez les Égyptiens
et les autres peuples de ces contrées. On trouve dans la version Syriaque des
( 0 ci-dessus, pag. 576.
(2) Voye1 Hésychius et Suidas.
(3) V oyez Odyss. Iib. XI, v. 576.
mm
9
D E S A N C I E N S É G Y P T I E N S . 7 61
Macchabées le mot estedoun ou estadion, pour désigner cette mesure (i).
Le passage est exprimé dans la version Grecque par les mots suivans : ta) mjteyfioztf
■m Ba-iMpa., ’¿rit ¡ch ipu/ivSytafta, im Si'l£gjmAu/2«ï ¿iàypnt u n 1 çaJHvt iréra (2), et
en latin par etappropians Bethsuræ, quoeerat inangusto loco, ab lerosolyma intervallo
quinque stadiorum. Le mot S estedoun est employé dans beaucoup d’autres endroits*
appliqué soit au stade itinéraire, soit au stade des coursés. Reste .à savoir si les
auteurs de la version Syriaque ont puisé ce mot dans le grec deS^Septante, ou
bien si la langue Syriaque le possédoit en propre et si les Grecs au contraire l’ont
emprunté aux langues Orientales (3).
Le persan a une racine qui est istâden jJsLL-J , et qui veut dire , comme le
grec, ?5M»|, s tare, statuere (4 ) ; le substantif répond à statio, çn-mç et çadpùç. Ces
mots stare , statuere, en grec çaa, Ypt/tu, viennent-ils du persan istâden!
Les Arabes ont aussi le mot astâr, qui se traduit par ‘stater, çurif : lequel
a donné naissance a 1 autre 1 Tous deux expriment également un poids de
6 drachmes ~ ; et aussi une balance : de là stdtera (5 ). En hébreu, le mot Trio,
esthir, est encore un poids de 6 drachmes ou 6 drachmes f (6).
La même racine istâden fournit beaucoup de mots qui, dans le grec, ont le
même sens que dans la langue Persane. Ces mots sont justement des noms de
mesure, çu.Sïov, ra-irg, <jzcÔ/a.vi ^régula, étalon], ça-3pi>f\ &c. Peut-être ont-ils
ete empruntes de 1 Orient avec les; mesures elles-mêriîës. Je n’ignore pas que
beaucoup de mots Grecs ont passé dans les langues Orientales, et qu’on peut particulièrement
citer des mots commençant par , que les Orientaux ont fait précéder
dé \élif pour (euphonie; par exemple, Opa/yy4, çpa.'mysî, çj>a.'uânvf (y) : mais
ce n est pas là une preuve que le mot stade ait une telle origine. Le mot Grec qui
signifie antimoine, est ÏÈÿÛ et en qobte, c'th«-. En conclura-t-on que les Grecs ont
introduit ce mot dans la langue Égyptienne, tandis qu’on sait par Eustathe qu’il
appartient en propre aux Égyptiens (8)! Les mots Qobtes cct>tco-t?.!aranea; CTrott-,
scamnum; cnro, reprobare, ne sont nullement Grecs (9). Toutes les fois que le mot
stade se rencontre dans la Bible, il est traduit dans la version Qobte par CTt>2.iost.
A la vérité, il est entré une foule de mots Grecs dans la langue Qobte (10).
(1) A u 2.® livre des Macchabées, chap. u , j v . 5. ■*
(2) La version Latine du syriaque porte, x i l mil-
l\ art a et quinque stadia.
(3) On trouve le passage suivant dans le Lexique hep-
t a g l o t t e : , estoudioun, hippicon;
astoudâ , stadium ; , estoudioun, sa,'«ftor,
stadium, paloestra, locusquo certatur. M acch. Iib. I , cap. 1,
15.
Dans la version Arabe du passage de V Apocalypse ,n
chap. 14 20, cité plus haut, le mot .stade est traduit
par mylf amyâl e lf , JU»Î ; et au chap. 2 1 , y . 16,
par le mot ghalouah.
C e dernier passage est très-curieux, en ce qu’ il fait voir
l’usage de la canne pour la mesure des grands espaces. E t
rnensus est civitatem de arundine aurea per stadia duode-
chn millia, ¿7c. On y voit aussi cette mesure employée à
mesurer de moindres longueurs : Et mensus est murum ejus
A .
144 cubitorum, mensuru hominisj quoe est angeli, y . 17.
Dans le texte Qobte seul, au lieu de coudées, il y a
palmes, TTOJOTT •' on pourroit proposer une explication
assez vraisemblable de la version Qob te; mais ce n’est pas
ici le lieu.
(4) En persan, isaraf vel ïça.<dui, consistere,
stare ( voyez dans la G en. chap. 43 > .v. 1 j ) ; statuere ( voyez
ibid. en divers endroits) ; s i U J , s tans, de w j jg J , surgere,
stando opperiri.
(5) jljùwî,*arab. sirnij), pondus 6 7 drachmarum,
(6) asthar, occa, id est, 400 drachmarum pondus;
*VhD, esthir, 6 4 drachmoe.
(7) En syriaque, ) u _ _ _ _ A 2 o a , estaoumakâ;
, estratygê ; , estratyôutâ.
(8) Aristoph. gramm. apud Eustath.
(9) I. Ross. Etym. Ægypt. pag. 120,
( 1 o) Vqy%, au sujet du mot stade, S. J ean, chap. 6,y . 1 o ;
D d d d d z
(If
I îIlü
l1ü « :
uf|rlf i
I I
I
; v*Hi
;i -il »KjU
i l
1
l'tjH
il®f !» VJHil
l i l
H
1
«J li 1
I l i
l l l l f t
ü
1 R i
i l i ' l
■l: v
11
1 1