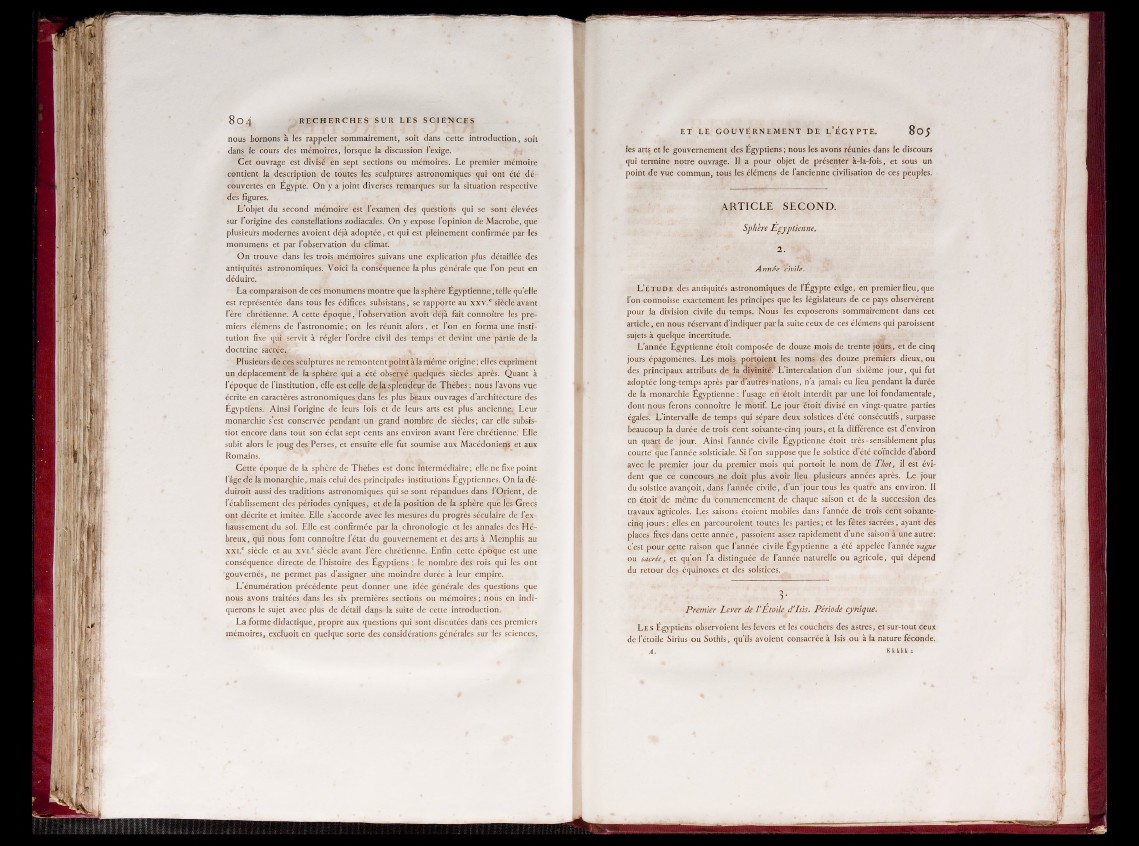
nous bornons à les rappeler sommairement, soit dans cette introduction, soit
dans le cours des mémoires, lorsque la discussion l’exige.
Cet ouvrage est divise en sept sections ou mémoires. L e premier mémoire
contient la description de toutes les sculptures astronomiques qui ont été découvertes
en Egypte. On y a joint diverses remarques sur la situation respective
des figures.
L ’objet du second mémoire est l’examen des questions qui se sont élevées
sur l’origine des constellations zodiacales. On y expose l’opinion de Macrobe, que
plusieurs modernes avoient déjà adoptée, et qui est pleinement confirmée par les
monumens et par l’observation du climat.
On trouve dans les trois mémoires suivans une explication plus détaillée des
antiquités astronomiques. V o ici la conséquence la plus générale que l’on peut en
déduire.
L a comparaison de ces'monumens m ontre que la sphère Égyptienne, telle qu’elle
est représentée dans tous les édifices subsistans, se rapporte au x x v . c siècle avant
l’ère chrétienne. A cette époque, l’observation avoit déjà fait connoître les premiers
élémens de l’astronomie ; on les réunit alors, et l’on en forma une institution
fixe qui servit à régler l’ordre civil des temps et devint une partie de la
doctrine sacrée.
Plusieurs de ces sculptures ne remontent point à la même origine ; elles expriment
un déplacement de la sphère qui a été observé quelques siècles après. Quant à
l’époque de l’institution, elle est celle de la splendeur de Thèbes: nous l’avons vue
écrite en caractères astronomiques dans tes plus beaux ouvrages d’architecture des
Egyptiens. Ainsi l’origine de leurs lois et de leurs arts est plus ancienne. Leur
monarchie s’est conservée pendant un grand nombre de siècles; car elle subsis-
tiot encore dans tout son éclat sept cents ans environ avant l’ère chrétienne: Elle
subit alors le joug des Perses, et ensuite elle fut soumise aux Macédonien! et aux
Romains.
Cette époque de la sphère de Thèbes est donc intermédiaire; elle ne fixe point
l’âge de la monarchie, mais celui des principales institutions Égyptiennes. On la déduirait
aussi des traditions astronomiques qui se sont répandues dans l’Orient, de
l’établissement des périodes cyniques, et de la position de la sphère que lés Grecs
ont décrite et imitée. Elle s’accorde avec les mesures du progrès séculaire de l’exhaussement
du sol. Elle est confirmée par la chronologie et les annales des H é breux,
qui nous font connoître l’état du gouvernement et des arts à Memphis au
XXI,e siècle et au x v i .e siècle; avant l’ère chrétienne. Enfin cette époque est une
conséquence directe de l’histoire des Egyptiens : le nombre des rois qui les ont
gouvernés, ne permet pas d’assigner une moindre durée à leur empire.
L ’énumération précédente peut donner une idée générale des questions que
nous avons traitées dans les six premières sections ou mémoires ; nous en indiquerons
le sujet avec plus de détail dans la suite de cette introduction.
La forme didactique, propre aux questions qui sont discutées dans ces premiers
mémoires, excluoit en quelque sorte des considérations générales sur les sciences,
les arts et le gouvernement des Égyptiens ; nous les avons réunies dans le discours
qui termine notre ouvrage. Il a pour objet de présenter à-la-fois, et sous un
point de vue commun, tous les élémens de l’ancienne civilisation de ces peuples.
A R T I C L E S E C O N D .
Sphère Egyptienne,
2.
A n n ée civile.
L ’ é t u d e des antiquités astronomiques de l’Egypte exige, en premier lieu, que
l’on connoisse exactement les principes que les législateurs de ce pays observèrent
pour la division civile du temps. Nous les exposerons sommairement dans cet
article, en nous réservant d’indiquer par la suite ceux de ces élçmens qui paraissent
sujets à quelque incertitude.
L ’année Égyptienne étoit composée de douze mois de trente jours, et de cinq
jours épagomènes. Les mois portoient les noms des douze premiers dieux, ou
des principaux attributs de la divinité. L ’intercalation d’un sixième jour, qui fut
adoptée long-temps après par d’âutres^nations, n’a jamais eu lieu pendant la durée
de la monarchie Égyptienne : l’usage en étoit interdit par une loi fondamentale,
dont nous ferons connoître le motif. L e jour étoit divisé en vingt-quatre parties
égales. L ’intervalle de temps qui sépare deux solstices d’été consécutifs, surpasse
beaucoup la durée de trois cent soixante-cinq jours5 et la différence est d environ
un quart de jour. Ainsi l’année civile Égyptienne étoit très-sensiblement plus
courte* que l’année solsticiale. Si l’on suppose que le solstice d’été coïncide d’abord
avec le premier jour du premier mois qui portoit le nom de T liot, il est évident
que ce concours ne doit plus avoir lieu plusieurs années après. Le jour
du solstice avançoit, dans l’année civile, d’un jour tous les quatre ans environ. Il
en étoit de même du ’commencement de chaque saison et de la succession des
travaux agricoles. Les saisons étoient mobiles dans l’année de trois cent soixante-
cinq jours : elles en parcouraient toutes les parties; et les fêtes sacrées, ayant des
places fixes dans cette année, passoient assez rapidement d’une saison à une autre:
c’est pour cette raison que l’année civile Égyptienne a été appelée 1 année vague
ou sacrée, et qu’on l’a distinguée de l’année naturelle ou agricole, qui dépend
du retour des équinoxes et des solstices.
3*
Premier Lever de l ’E to ile d’Isis. Période cynique.
L e s Égyptiens observoient les levers et les couchers des astres, et sur-tout ceux
de l’étoile Sirius ou Sothis, qu’ils avoient consacrée à Isis ou à la nature féconde.
A. Klkkl»