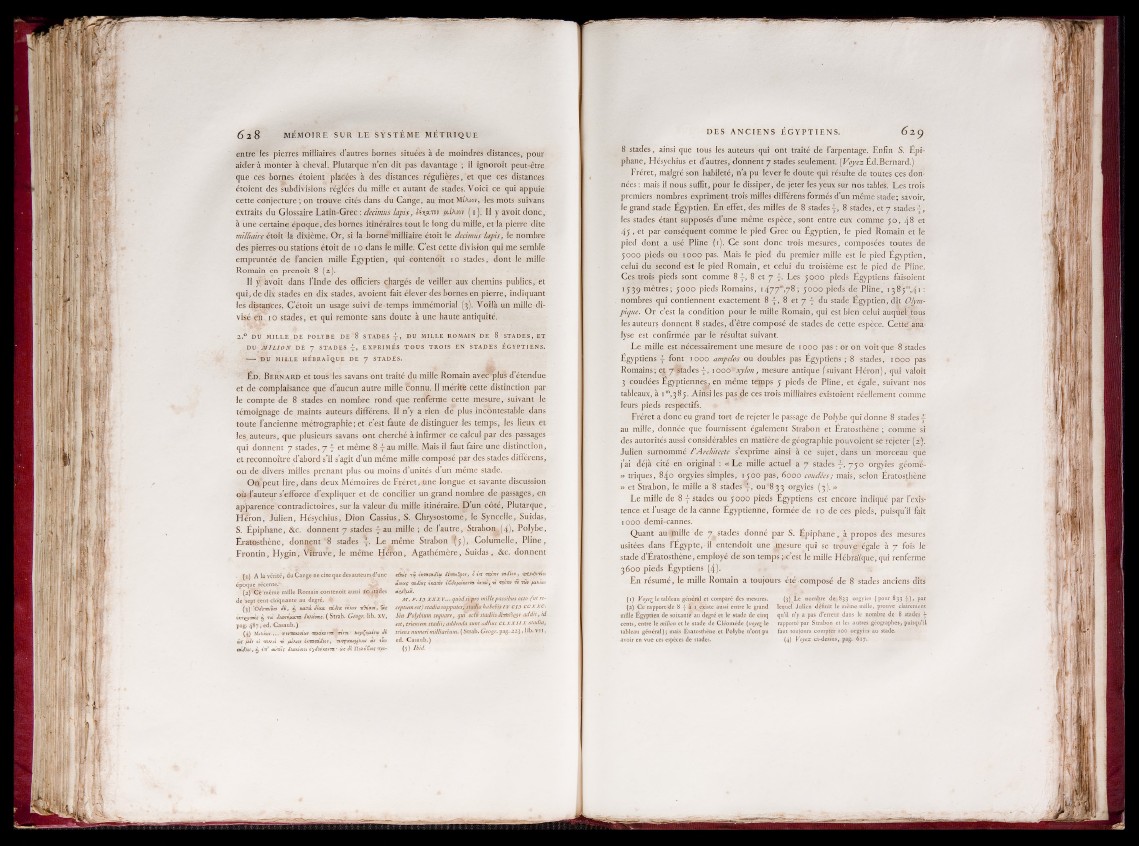
entre les pierres militaires d’autres bornes situées à de moindres distances, pour
aider à monter à cheval. Plutarque n’en dit pas davantage ; il ignoroit peut-être
que ces bornes étoient placées à des distances régulières, et que ces distances
étoient des Subdivisions réglées du mille et autant de stades. Voici ce qui appuie
cette conjecture ; on trouve cités dans du Cange, au mot M ì a » * , les mots suivans
extraits du Glossaire Latin-Grec : decimus lapis, iïxsrav /kJAiov ( i ). Il y avoit donc,
à une certaine époque, des bornes itinéraires tout le long du mille, et la pierre dite
milliaire étoit la dixième. Or, si la borné 'milliaire étoit le decimus lapis, le nombre
des pierres ou stations étoit de 1 o dans le mille. C’est cette division qui me semble
empruntée de l’ancien mille Égyptien, qui contenoit 10 stades, dont le mille
Romain en prenoit 8 (2).
Il y àvoit dans l’Inde des officiers chargés de veiller aux chemins publics, et
qui, de dix stades en dix stades, avoient fait élever des bornes en pierre, indiquant
les distantes. C’étoit un usage suivi de-temps immémorial (3). Voilà un mille divisé
en 10 stades, et qui remonte sans doute à une haute antiquité.
2 .° D U M I L L E D E P O L Ï B E D E 8 S T A D E S y , D U M I L L E R O M A I N D E 8 S T A D E S , E T
D U M I L I O N D E 7 S T A D E S y, E X P R I M É S T O U S T R O I S E N S T A D E S É G Y P T I E N S .
D U M I L L E H É B R A Ï Q U E D E 7 S T A D E S .
É d . B e r n a r d et tous les savans ont traité du mille Romain avec plus d étendue
et de complaisance que d’aucun autre mille connu. Il mérite cette distinction par
le compte de 8 stades en nombre rond que renferme cette mesure, suivant le
témoignage de maints auteurs différens. II n’y a rien de plus incontestable dans
toute l’ancienne métrographie; et c’est faute de distinguer les temps, les lieux et
les auteurs, que plusieurs savans ont cherché à infirmer ce calcul par des passages
qui donnent 7 stades, 7 y et même 8 ÿ au mille. Mais il faut faire une distinction,
et reconnoître d’abord s’il s’agit d’un même mille composé par des stades différens,
ou de divers milles prenant plus ou moins d’unités d’un même stade.
On peut lire, dans deux Mémoires de Fréret, une longue et savante discussion
où l’auteur s’efforce d’expliquer et de concilier un grand nombre de passages, en
apparence contradictoires, sur la valeur du mille itinéraire. D ’un côté, Plutarque,
Héron, Julien, Hésychius, Dion Cassius, S. Chrysostome, le Syncelle, Suidas,
S. Épiphane, &c. donnent 7 stades ÿ au mille ; de l’autre, Strabom (4 )> Polybe,
Ératosthène, donnent’ 8 stades y. Le même Strabon ?('5}, Columelle, Pline,
Frontin, Hygin, Vitruve, le même Héron, Agathémère, Suidas, &c. donnent
( 1 ) A la v é r it é , du C a n g e ne c ite qu e des auteurs,d*une çfiûç t u ôxieKaJia JÿafttSpsr, o est >i&-nv çaJïou, dinov
ép oq u e récente.*“ y afMç ço.«ftW iiccnèv ¿ÇA/junnovut ¿ktu, i i nç/nn *» iSv ¡u hiw
(2 ) C e même mille Rom a in con ten o it aussi i o stades ¿ sa^/xS.
d e sept cen t cin q u an te au degré. ♦ * M .P . I O X X X V ... quodsvrp.ro mille passibus odo ( ut vel
i ) ‘OtfbTTDivej A , 5 narrò. Axa. s a Jïa n\nr iftiam, Htç ceptumest) stadia supputes, stadia habebis I V CIO C CX XC.
ÎK T&m ç Hj Tct ¿¡anpam Ahxtntç. ( S t ra b . Geogr. Iib. XV, Sin Polybium sequare, qui ocfd stadiis ¿itâiQ&Y a ddit,id
pa g. 4 8 7 , e d . C a s a u b .) est, trientem stadii; addenda sunt udhuc C L X X I IX stadia,
(4) M i*/ a r .... Trivmwmav neuharm 'm vii ' xoytÇojxivcp A triens numerimilliarium. ( S t ra b . Geogr. pa g. 2 2 3 , Iib. V I I ,
¿¡Ç jUtY 01 OTMOI TB pUMOY ¿KHtidilOV, 'Ti'TpOUUJgtoOl CCY utv ed. C a s a u b .)
fttjioi, Xj iir tw’ntç ¿¡amiei01 óyJbtinovm F Lsç A Tla^vCioç irpo- (5) Ibid.
8 stades, ainsi que tous les auteurs qui ont traité de l’arpentage. Enfin S. Épiphane,
Hésychius et d’autres, donnent 7 stades seulement. [Voyez Éd.Bernard.)
Fréret, malgré son habileté, n’a pu lever le doute qui résulte de toutes ces données
: mais il nous suffit, pour le dissiper, de jeter les yeux sur nos tables. Les trois
premiers nombres expriment trois milles différens formés d’un même stade; savoir,
le grand stade Égyptien. En effet, des milles de 8 stades -j-, 8 stades, et 7 stades ÿ ,
les stades étant supposés d’une même espèce, sont entre eux comme yo, 48 et
45 , et pai- conséquent comme le pied Grec ou Égyptien, le pied Romain et le
pied dont a usé Pline (1). Ce sont donc trois mesures, composées toutes de
y000 pieds ou 1000 pas. Mais le pied du premier mille est le pied Égyptien,
celui du second est le pied Romain, et celui du troisième est le pied de Pline.
Ces trois pieds sont comme 8ÿ, 8 et 7 ÿ. Les 5000 pieds Égyptiens faisoient
1539 mètres ; y 000 pieds Romains, 1477“,78 ; yooo pieds de Pline, 138ym,4 1 :
nombres qui contiennent exactement 8 ÿ, 8 et 7 ÿ du stade Égyptien, dit Olympique.
Or c’est la condition pour le mille Romain, qui est bien celui auquel tous
les auteurs donnent 8 stades, d’être composé de stades de cette espèce. Cette analyse
est confirmée par le résultat suivant.
Le mille est nécessairement une mesure de 1000 pas : or on voit que 8 stades
Égyptiens - font 1000 ampelos ou doubles pas Égyptiens ; 8 stades, 1Ò00 pas
Romains; et T^tades ÿ , 1000*xylon, mesure antique (suivant Héron), qui valoit
3 coudées Égyptiennes, en même temps y pieds de Pline, et égale, suivant nos
tableaux, à im,38y. Ainsi les pas de ces trois milliaires existoient réellement comme
leurs pieds respectifs.
Fréret a donc eu grand tort de rejeter le passage de Polybe qui donne 8 stadesB
au mille, donnée que fournissent également Strabon et Ératosthène ; comme si
des autorités aussi considérables en matière de géographie pouvoient se rejeter (2).
Julien surnommé l ’Architecte s’exprime ainsi à ce sujet, dans un morceau que
j’ai déjà cité en original : «Le mille actuel a 7 stades (B 7yo orgyies géomé-
» triques, 84o orgyies simples, iyo o pas, 6000 coudées; mais, sejon Ératosthène
» et Strabon, le mille a 8 stades y , ou'833 orgyies (3).»
Le mille de 8 ÿ stades ou yooo pieds Égyptiens est encore indiqué par l’existence
et l’usage de la canne Égyptienne, formée de 1 o de ces pieds, puisqu’il fait
1000 demi-cannes.
Quant au mille de 7 stades donné par S. Épiphane, à propos des mesures
usitées dans l’Égypte, - il entendoit une mesure qui se trouve égale à 7 fois Je
stade d Ératosthène, employé de son temps ; -c est le mille Hébraïque, qui renferme
3600 pieds Égyptiens (4).
En résumé, le mille Romain a toujours été.composé de 8 stades anciens dits
(1) Voyei le tableau général et comparé des mesures. (3) Le nombre de 833 orgyies (pour 833 4- ) , par
(2) C e rapport-de 8 j à 1 existe aussi entre le grand lequel Julien définit le même mille, prouve clairement
mille Égyptien de soixante au degré et le stade de cinq qu’il n’y a pas d’erreur dans le nombre de 8 stades y
cents, entre le milion et le stade de Cléomède (voyeç le rapporté par Strabon et les autres géographes, puisqu’ il
tableau général); mais Ératosthène et Polybe n’ont pu faut toujours compter 100 orgyies au stade.
avoir en vue ces espèces de stades. (4) Voyez ci-dessus, pag. 617.