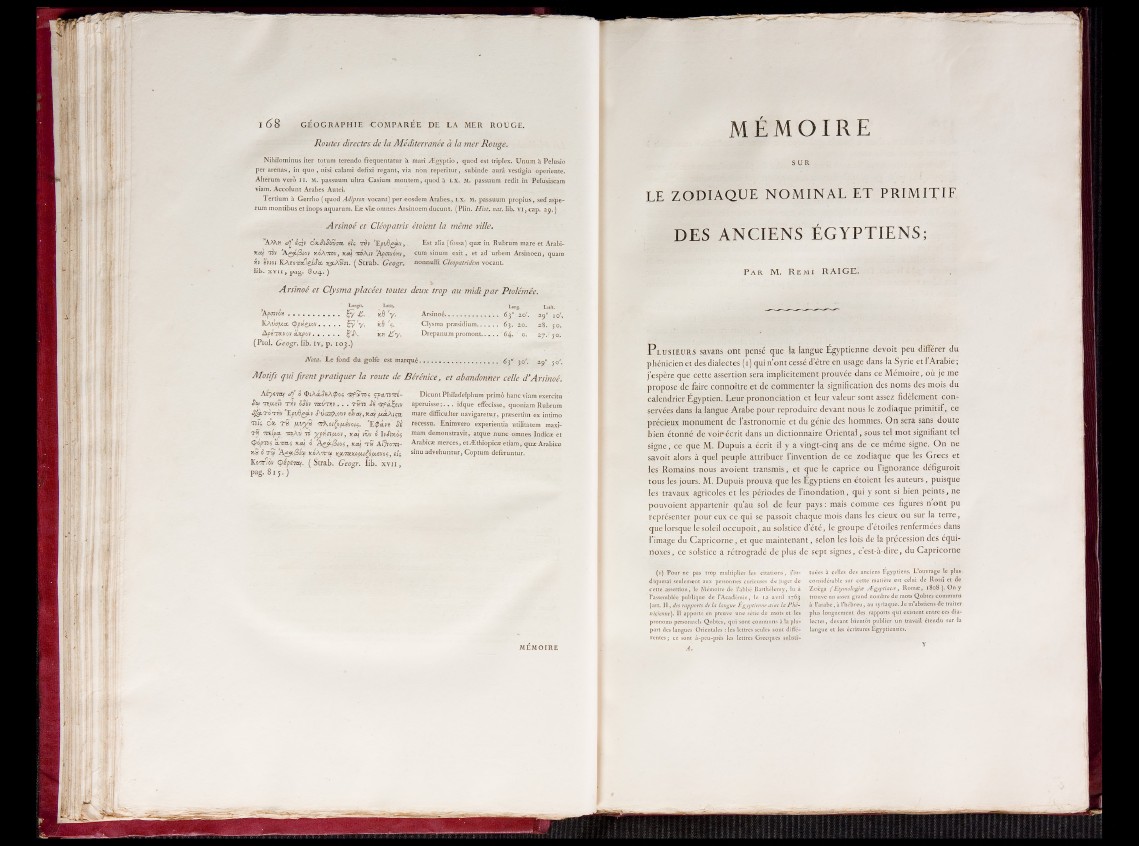
Routes directes de la Méditerranée à la mer RouOse.
N ih ilom irm s ite r totum teren d o fre q u en ta tu r à. mari Æ g y p t io , q u o d es t trip lex. U n um à. P e lu s io
p e r a r e n a s , in q u o , nis i ca lami d e fix i r e g a n t , v ia n o n r e p e r itu r , su b in d e au ra v e s t ig ia op erien te.
A ite rum v e ro l i t M. pa s su um u ltra C a s ium m o n t e n t ,-quod à l x . M« pa s suum red it in Pe lu s ia cam
v iam . A c c o lu n t A rab e s A u te i.
T e r t ium à G e r rh o (q u o d Adipson v o c an t ) p e r eosd em A r a b e s , l x . m. p a s su um p r o p iu s , sed asp e -
iu m m o n t ib u s e t in o p s aqu a rum. Eæ.vïæ omn es A r s in o em d u cu n t. (P lin . H i s t . not. lib . V I , cap . 20 . )
Arsinoé et Cléopatris étoient la même ville.
À M î i r f . è à ctcS iSb vaa. eï$ t>;v ’ EpvQgytv, , E s t a lia (fossa ) quæ in R u b rum mare e t A ra b i-
îccq 70V ’A ^ ß i o v x.oÀ7rov, icctj m A / v ’Aptnvovv, cu ra s in um e x i t , e t a d 'u r b e in A r s in o e n , quam
vv g vio; KÀeo7rwIeJSbo tycXS'in. ( S t r a b . G e o g r . nonnuJIi Cleopatridem v o can t .
l ib . x v i i , p a g . 8 0 4 . )
Arsinoé et Clysma placées toutes deux trop au midi p a r Ptolêfnée-.
Longit. I Latît. Long. Latît.
’A p o iv o n .......................................... | y >c9 V A r s in o é . . ......................... 6 3 ° 20'. zp ° io\
KAvopicL <pp%£jLov | y 'y . itô 'ç . C ly sm a præsidium 6 3 . 20 . 2 8 . 50.
AperrzLVov cLxpov 701 É y . D rep a n um p rom o n t ' 6 4 . ‘ o . 2 7 . 5 0.
( P t o L Geogr. lib. i v , p. 1 0 3 . )
N ota. L e fo n d d u g o lf e es t m a r q u é 63 °’ 30 '. 2 p 0 5 o '.
M otifs qui firent pratiquer la route de Bérénice, et abandonner celle d’Arsinoé.
Ag>«7zq 0 O/Act«&A0os '© fSm s ç p ^ m ^ é - D ic u n t P h ilad e lp h um p r im o h an c v iam e xerc itu
Sep TtfAetv r ) îv oSèy 7 a u 7 i jv . . . t S t o Sè •Qpod'W a p e ru is s e ; . . . id q u e e f fe c is s e , q u on iam R u b rum
« Ç ^ ro T i iv JE pvQçp.v S'vazÿs.ovv eîveti,Kctj p u ÎA iça , mare difficu lte r n a v ig a r e tu r , præsertim e x intimo
70J$ c/x, t S [ ¿ v y y '^Ào/£o/uivo/$. ’ E tp iv n S è re c e s su . E n im v e ro e x p e r ien t ia u tilitatem maxi-
TA 7ttipcc TtoAti 70 ^prien/Ae»), Kctj vt»v 0 IvStKoç marn d em o n s t ra v it , a tq u e n u n c omn es In dicæ et
Ç>op70$ CL7HLÇ jtcLj 0 A ^S i-ß loç,, jtcq t S AiJio7n~ A rab icæ m e r c e s , e tÆ th io p icæ e t iam , quæ A ra b ic o
k ü 0 TO) A ocf.ßlca X.0A7rcp xjt,7u.xopn^ôpi€Vo<i y g/$ s in u a d v e h u n tu r , C o p tum de fe run tur.
Kovriov (péperaf. ( Strab. Geogr. iib. x v i i ,
pag. 8 1 5 . )
S U R
LE ZODIAQUE NOMINA L ET PRIMITIF
DES ANCIENS ÉGYPTIENS;
P a r M. R em i RAIG E .
P l u s i e u r s savans ont pensé que la langue Égyptienne devoit peu différer du
phénicien et des dialectes (i) qui n’ont cessé d’être en usage dans la Syrie et l’Arabie;
j’espère que cette assertion sera implicitement prouvée dans ce Mémoire, où je me
propose de faire connoître et de commenter la signification des noms des mois du
calendrier Égyptien. Leur prononciation et leur valeur sont assez fidèlement conservées
dans la langue Arabe pour reproduire devant nous le zodiaque primitif, ce
précieux monument de l’astronomie et du génie des hommes. On sera sans doute
bien étonné de voir écrit dans un dictionnaire Oriental, sous tel mot signifiant tel
signe, ce que M. Dupuis a écrit il y a vingt-cinq ans de ce même signe. On ne
savoit alors à quel peuple attribuer l’invention de ce zodiaque que les Grecs et
les Romains nous avoient transmis, et que le caprice ou l’ignorance défiguroit
tous les jours. M. Dupuis prouva que les Égyptiens en étoient les auteurs, puisque
les travaux agricoles et les périodes de l’inondation, qui y sont si bien peints, ne
pouvoient appartenir qu’au sol de leur pays ; mais comme ces figures n ont pu
représenter pour eux ce qui se passoit chaque mois dans les cieux ou sur la terre,
que lorsque le soleil occupoit, au solstice d’été, le groupe d’étoiles renfermées dans
l’image du Capricorne, et que maintenant, selon les lois de la précession des équinoxes,
ce solstice a rétrogradé de plus de sept signes, c’est-à-dire, du Capricorne
(1) Pour ne pas trop multiplier les citations, j’in- tuées à celles des anciens Égyptiens. L ’ouvrage le plus,
diquerai seulement aux personnes curieuses de juger de considérable sur cette matière est celui de Rossi et de
cette'assertion, le Mémoire de l’abbé Barthélémy, lu à Zoëga ( Etymologiæ Ægyptiacæ, Romæ, 1808 ). On y
l’assemblée publique de l’Académie, le 12 avril 1763 trouve un assez grand nombre de mots Qobtes communs
(art. 11, des rapports de la langue Égyptienne avec la P lié- à l’arabe, à l’hébreu, au syriaque. Je m abstiens de traiter
niçïenne). 11 apporte en preuve une série de mots et les plus longuement des rapports qui existent entre ces diapronoms
personnels Qobtes, qui sont communs à la plu- lectes, devant bientôt publier un travail etendu sur la
part des langues Orientales : les lettres seules sont diffé- langue et les écritures Egyptiennes,
rentes ; ce sont à-peu-près les lettres Grecques substi-
A . Y