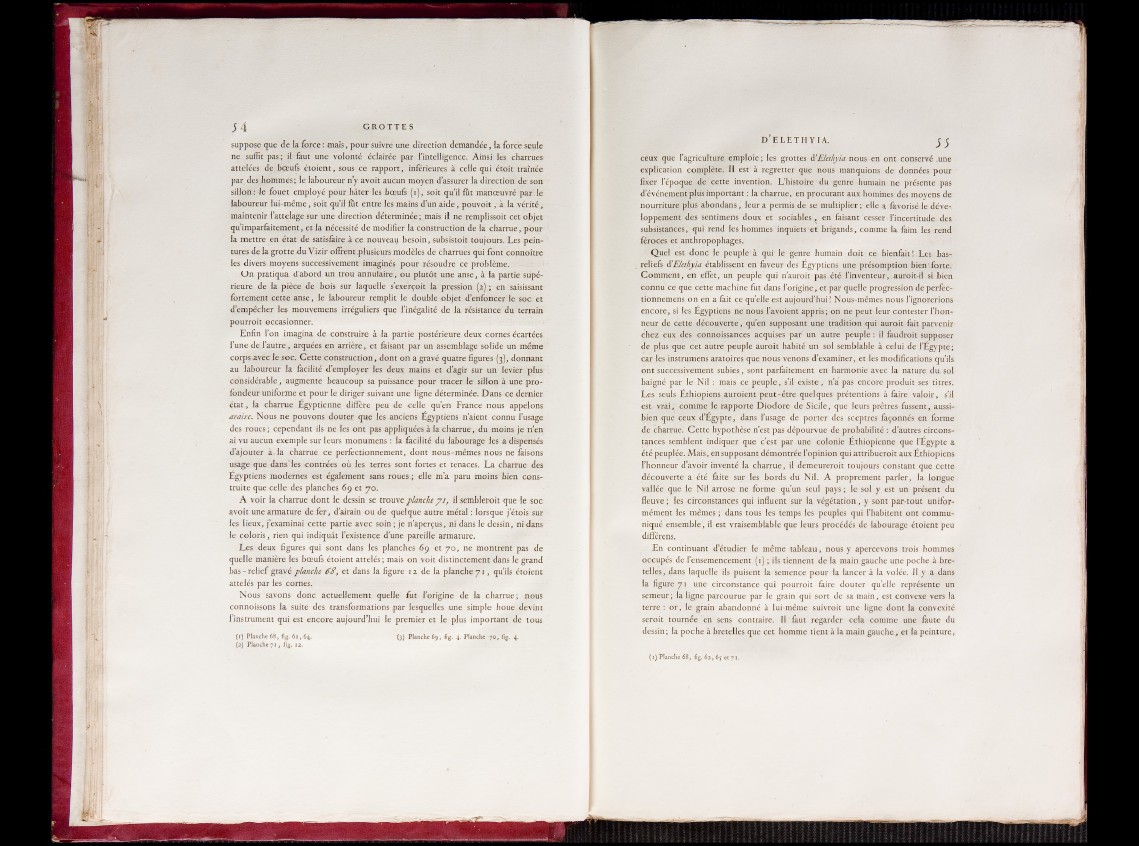
suppose que de la force : mais, pour suivre une direction demandée, la force seule
ne suffit pas ; il faut une volonté éclairée par l’intelligence. Ainsi les charrues
attelées de boeufs étoient, sous ce rapport, inférieures à celle qui étoit traînée
par des hommes; le laboureur n’y avoit aucun moyen d’assurer la direction de son
sillon : le fouet employé pour hâter les boeufs (i), soit qu’il fut manoeuvré par le
laboureur lui-mème, soit qu’il fût entre les mains d’un aide, pouvoit, à la vérité,
maintenir l’attelage sur une direction déterminée ; mais il ne remplissoit cet objet
qu’imparfaitement, et la nécessité de modifier la construction de la charrue, pour
la mettre en état de satisfaire à ce nouveau besoin, subsistoit toujours. Les peintures
de la grotte du Vizir offrent.plusieurs modèles de charrues qui font connoître
les divers moyens successivement imaginés pour résoudre ce problème.
On pratiqua d’abord un trou annulaire, ou plutôt une anse, à la partie supérieure
de la pièce de bois sur laquelle s’exerçoit la pression (2).; en saisissant
fortement cette anse, le laboureur remplit le double objet d’enfoncer le soc et
d’empêcher les mouvemens irréguliers que l ’inégalité de la résistance du terrain
pourroit occasionner.
Enfin l’on imagina de construire à la partie postérieure deux cornes'écartées
l’une de l’autre, arquées en arrière, et faisant par un assemblage solide un même
corps avec le soc. Cette construction, dont on a gravé quatre figures (3), donnant
au laboureur la facilité d’employer les deux mains et d’agir sur un levier plus
considérable, augmente beaucoup sa puissance pour tracer le sillon à une profondeur
uniforme et pour le diriger suivant une ligne déterminée. Dans ce dernier
état, la charrue Égyptienne diffère peu de celle qu’en France nous appelons
araire. Nous ne pouvons douter que les anciens Égyptiens n’aient connu l’usage
des roues ; cependant ils ne les ont pas appliquées à la charrue, du moins je n’en
ai vu aucun exemple sur leurs monumens : la facilité du labourage les a dispensés
d’ajouter à. la charrue ce perfectionnement, dont nous-mêmes nous ne faisons
usage que dans’ les contrées où les terres sont fortes et tenaces. La charrue des
Égyptiens modernes est également sans roues ; elle m’a paru moins bien construite
que celle des planches 69 et 70.
A voir la charrue dont le dessin se trouve planche y 1, il semblerait que le soc
avoit une armature de fer, d’airain ou de quelque autre métal : lorsque j’étois sur
les lieux, j’examinai cette partie avec soin ; je n’aperçus, ni dans le dessin, ni dans
le coloris, rien qui indiquât l’existence d’une pareille armature.
Les deux figures qui sont dans les planches 69 et 70, ne montrent pas de
quelle manière les boeufs étoient attelés ; mais on voit distinctement dans le grand
bas - relief gravé planche 68, et dans la figure 12 de la planche 7 1 , qu’ils étoient
attelés par les cornes.
Nous savons donc actuellement quelle fut l’origine de la charrue; nous
connoissons la suite des transformations .par lesquelles une simple houe devint
l’instrument qui est encore aujourd’hui le premier et le plus important de tous
(1) Planche 68, fig. 6i , 64.
(2) Planche 7 1 , fig. 12.
(3) Planche 6 9 , fig. 4• Planche 70 , fig. 4*
D ’ E L E T H Y l A .
ceux que l’agriculture emploie ; les grottes d’E/et/ryia nous en ont conservé .une
explication complète. Il est à regretter que nous manquions de données pour
fixer l’époque de cette invention. L ’histoire du genre humain ne présente pas
d’événement plus important : la charrue, en procurant aux hommes des moyens de
nourriture plus abondans, leur a permis de se multiplier ; elle a favorisé le développement
des sentimens doux et sociables, en faisant cesser l’incertitude des
subsistances, qui rend les hommes inquiets et brigands, comme la faim les rend
féroces et anthropophages.
Quel est donc le peuple à qui le genre humain doit ce bienfait! Les bas-
reliefs d'Elethyia établissent en faveur des Égyptiens une présomption bien forte.
Comment, en effet, un peuple qui n’auroit pas été l’inventeur, auroit-il si bien
connu ce que cette machine fut dans l’origine, et par quelle progression de perfec-
tionnemens on en a fait ce qu’elle est aujourd’hui! Nous-mêmes nous l’ignorerions
encore, si les Egyptiens ne nous l’avoient appris; on ne peut leur contester l’honneur
de cette découverte, qu’en supposant une tradition qui auroit fait parvenir
chez eux des connoissances acquises par un autre peuple : il faudrait supposer
de plus que cet autre peuple auroit habité un sol semblable à celui de l’Égypte;
car les instrumens aratoires que nous venons d’examiner, et les modifications qu’ils
ont successivement subies, sont parfaitement en harmonie avec la nature du sol
baigné par le Nil : mais ce peuple, s’il existe, n’a pas encore produit ses titres.
Les seuls Éthiopiens auraient peut-être quelques prétentions à faire valoir, s’il
est vrai, comme le rapporte Diodore de Sicile, que leurs prêtres fussent, aussi-
bien que ceux d’Égypte, dans l’usage de porter des sceptres façonnés en forme
de charrue. Cette hypothèse n’est pas dépourvue de probabilité : d’autres circonstances
semblent indiquer que c’est par une colonie Éthiopienne que l’Égypte a
été peuplée. Mais, en supposant démontrée l’opinion qui attribuerait aux Éthiopiens
l’honneur d’avoir inventé la charrue, il demeurerait toujours constant que Cette
découverte a été faite sur les bords du Nil. A proprement parler, la longue
vallée que le Nil arrose ne forme qu’un seul pays ; le sol y est un présent du
fleuve ; les circonstances qui influent sur la végétation, y sont par-tout uniformément
les mêmes ; dans tous les temps les peuples qui l’habitent ont communiqué
ensemble, il est vraisemblable que leurs procédés de labourage étoient peu
différens.
En continuant d’étudier le même tableau, nous y apercevons trois hommes
occupés de l’ensemencement (i) ; ils tiennent de la main gauche une poche à bretelles,
dans laquelle ils puisent la semence pour la lancer à la volée. Il y a dans
la figure y i une circonstance qui pourroit faire douter qu’elle représente un
semeur ; la ligne parcourue par le grain qui sort de sa main, est convexe vers la
terre : o r, le grain abandonné à lui-même suivrait une ligne dont la convexité
serait tournée en sens contraire. Il faut regarder cela comme une faute du
dessin; la poche à bretelles que cet homme tient à la main gauche., et la peinture,
(1) Planche 68, fig. 6 2 , 65 et 71.