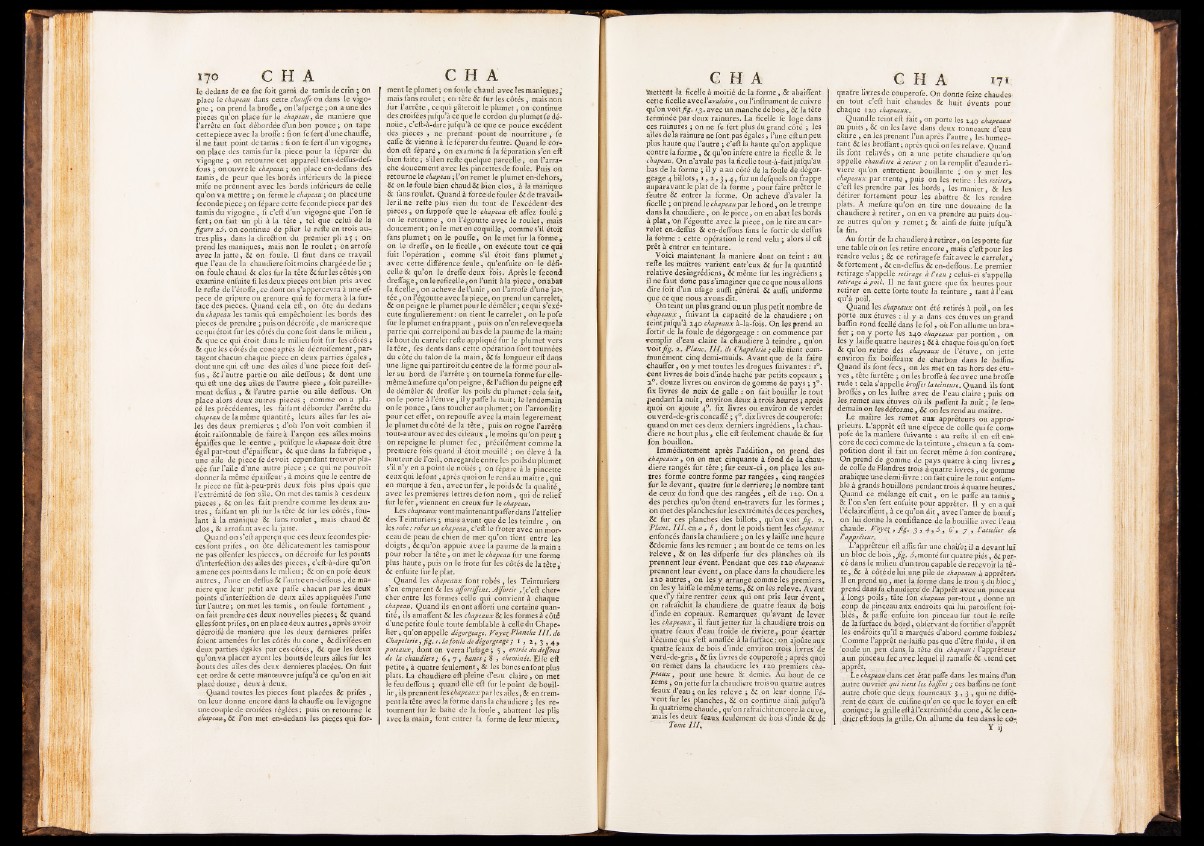
le dedans de ce fac foit garni de tamis de crin ; On
place le chapeau dans cette chauffa ou dans le vigogne
; on prend la broffe, onl’alperge ; on a une des
pièces qu’on place fur le chapeau, de maniéré que
l’arrête en foit débordée d’un bon pouce ; on tape
cette piece avec la brolfe : fi on fe fert d’une chauffe,
il ne faut point de tamis : fi on fe fert d’un vigogne,
on place des tamis fur la piece pour la féparer du
vigogne ; on retourne cet appareil fens-deffus-def-
fous ; on ouvre le chapeau ; on place en-dedans des
tamis, de peur que les bords inférieurs de la piece
mife ne prennent avec les bords inférieurs de celle
?u’on v a mettre ; on ferme le chapeau ; on place une
èconde piece ; on fépare cette fécondé piece par des
tamis du vigogne , fi c’eft d’un vigogne que l’on fe
fe r t; on fait un pli à la tête , tel que celui de la
figure 26. on continue de plier le refte en trois autres
p lis , dans la direûion du premier pli *5 ; on
prend les maniques, mais non le roulet ; on arrofe
avec la ja tte , & on foule. Il faut dans ce travail
que l’eau de la chaudière foit moins chargée de lie ;
on foule chaud & clos fur la tête & fur les côtés ; on
examine enfuite fi les deux pièces ont bien pris avec
le refte de l’étoffe, ce dont on s ’appercevra à une ef-
pece de gripurc ou grenure qui fe formera à la fur-
face des pièces. Quand cela eft, on ôte du dedans
du chapeau les tamis qui empêchoient les bords des
pièces de prendre ;puisondécroife ,d e maniéré que
ce qui étoit fur les côtés du cône foit dans le milieu ,
& que ce qui étoit dans le milieu foit fur les côtés ;
& que les côtés du cône après le décroifement, partagent
chacun chaque piece en deux parties égales ,
dont une qui eft une des ailes d’une piece foit def-
fus , & l ’autre partie ou aile deffous ; & dont une
qui eft une des ailes de l’autre piece , foit pareillement
deffus , & l’autre partie ou aile deffous. On
place alors deux autres pièces ; comme on a placé
les précédentes, les faifant déborder l’arrête du
chapeau de la même quantité, leurs ailes fur les aî-
Je s des deux premières ; d’oit l’on voit combien il
étoit raifonnable de faire à l’arçon ces ailes moins
épaiffes que le centre , puifque le chapeau doit être
égal par-tout d’épaiffeur, & que dans la fabrique ,
une aile de piece fe devoit cependant trouver placée
fur l’aile d’une autre piece ; ce qui ne pouvoit
donner la même épaiffeur, à moins que le centre de
la piece ne fut à-peu-près deux fois plus épais que
l ’extrémité de fon aile. On met des tamis à ces deux
pièces , Sc on les fait prendre comme les deux autres
, faifant un pli fur la tête & fur les c ô té s , foulant
à la manique &c fans ro u le t, mais chaud &
c lo s , & arrofant avec la jatte.
Quand on s’eft apperçu que ces deux fécondés pièces
font prifes , on ôte délicatement les tamis pour
ne pas offenfer les pièces, on décroife fur les points
d’interfefrion des ailes des pièces, c’eft-à-dire qu’on
amené ces points dans le milieu ; & on en pofe deux
autres, l’une en-deffus & l’autre en-deffous , de maniéré
que leur petit axe paffe chacun par les deux
points d’interfeélion de deux ailes appliquées l’une
fur l’autre ; on met les tamis , on foule fortement ,
on fait prendre ces deux nouvelles pièces; & quand
plies font prifes, on en place deux autres, après avoir
dé.croifé de maniéré que les deux dernieres prifes
foient amenées fur les côtés du cône , & divifées en
deux parties égales par ces côtés, & que les deux
qu’on va placer ayentles bouts de leurs ailes fur les
bouts des ailes des deux dernieres placées. On fuit
çet ordre & cette manoeuvre jufqu’a ce qu’on en ait
placé douze, deux à deux.
Quand toutes les pièces font placées & prifes ,
on leur donne encore dans la chauffe ou le vigogne
une cou pleine croifées réglées; puis on retourne le
chapeau, St l’on met en-dedans les pièces qui forment
le plumet ; on foule chaud avec les maniques,
mais fans roulet ; en tête & fur les côtés, mais non
fur l’arrête, ce qui gâteroit le plumet, on continue
des croifées jufqu’à ce que le cordon du plumet fe dé-
noüe, c’eft-à-dire jufqu’à ce que ce pouce excédent
des pièces , ne prenant point de nourriture , fe
caffe & vienne à fe féparer du feutre. Quand le cordon
eft féparé , on examine fi la féparation s’en eft
bien faite ; s’il en refte quelque parcelle, on l’arrache
doucement avec les pincettes de foule. Puis on
retourne le chapeau ; l’on remet le plumet en-dehors,
& on le foule bien chaud & bien clos , à la manique
& fans roulet. Quand à force de fouler & de travailler
il ne refte plus rien du tout de l’excédent' des
pièces, on fuppofe que le chapeau eft allez fotilé ;
on le retourne , on l’égoutte avec le roulet, mais
doucement; on le met en coquille, comme s’il étoit
fans plumet ; on le pouffe, on le met fur la forme ,
on le dreffe, on le ficelle , on exécute tout ce qui
fuit l’opération , comme s’il étoit fans plumet
avec cette différence feule, qu’enfuite on le défi-,
celle & qu’on le dreffe deux fois. Après le fécond
dreflage, on le reficelle ^ on l’unit à la piece, on abat
la ficelle, on achevé de l’unir , on l’arrofe d’une jat-
té e , on l’égoutte avec la piece, on prend un carrelet,
& on peigne le plumet pour le démêler; ce qui s’exécute
fingulierement : on tient le carrelet, on le pofe
fur le plumet en frappant, puis on n’enrelevequela
partie qui correfpond au bas de la paume de la main:
le bout du carrelet refte appliqué fur le plumet vers
la tête, fes dents dans cette opération font tournées
du côté du talon de la main, & fa longueur eft dans
une ligne quipartiroitdu centre de la forme pour aller
au bord de l’arrête ; on tourne la forme fur elle-
même à mefure qu’on peigne, & l’aftion du peigne eft
de démêler & dreffer les poils du plumet : cela fait,
on le porte à l’étuve, il y paffe la nuit ; le lendemain
on le ponce, fans toucher au plumet ; on l’arrondit :
pour cet effet, on repouffe avec la main legerement
le plumet du côté de la tête, puis on rogne l’arrête
tout-autour avec des cifeaux, le moins qu’on peut 5
on repeigne le plumet fe c , précifément comme la
première fois quand il étoit mouillé ; on éleve à la
hauteur de l’oeil, on regarde entre les poils du plumet
s’il n’y en a point de noiiés ; on fépare à la pineette
ceux qui le fon t, après quoi on le rend au maître, qui
en marque à feu, avec un fer, le poids & la qualité,
avec les premières lettres de fon nom, qui de relief
fur le fe r , viennent en creux fur le chapeau.
Les chapeaux vont maintenant paffer dans l’attelier
des Teinturiers ; mais avant que de les teindre , on
les robe : rober un chapeau, c’eft le froter avec un morceau
de peau de chien de mer qu’on tient entre les
doigts , & qu’on appuie avec la paume de la main |
pour rober la tête, on met le chapeau fur une forme
plus haute, puis on le frote fur les côtés de la tête ,
& enfuite fur le plat.
Quand les chapeaux font robés , les Teinturiers
s’en emparent & les ajfortijfent. A fortir , *c’eft chercher
entre les formes celle qui convient à chaque
chapeau. Quand ils en ont afforti une certaine quantité
, ils amaffent & les chapeaux & les formes à côté
d’une petite foule toute femblable à celle du Chapelier
, qu’on appelle dégorgeage. Voyeç Planche I II. dt
Chapelerie , fig, /. la foule de dégorgeage ; 1 , î , 3 , 1 ,
poteaux, dont on verra l’ufage ; 5 , entrée du deffous
de la chaudière; 6 , 7 , bancs ; 8 , cheminée. Elle eft
petite, à quatre feulement, & les bancs en font plus
plats. La chaudière eft pleine d’eau claire, on met
le feu deffous ; quand elle eft fur le point de bouillir
, ils prennent les chapeaux par les ailes, & en trempent
la tête avec la forme dans la chaudière ; les retournent
fur le banc de la foule, abattent les plis
avec la main, font entrer la forme de leur mieux,
mettent la ficelle à moitié de la forme, & abarffent
cette ficelle avec Vavaloire, ou l’inftrument de cuivre
qu’on voit fig. 13. avec un manche de bois, & la tête
terminée par deux rainures. La ficelle fe loge dans
ces rainures ; on ne fe fert plus du grand côté ; les
ailes delà rainure ne font pas égales, l’une eft un peu
plus haute que l’autre ; c’eft la haute qu’on applique
contre la forme, & qu’on infère entre la ficelle & lé
chapeau, "On n’avale pas la ficelle tout-à-fait jufqu’âu
bas de la forme ; il y a au côté de la foule de degor-
geage 4 billots, x, 2 ,3 ,4 , fur un defquels on frappe
auparavant le plat de la forme, pour faire prêter le
feutre & entrer la forme. On achevé d’avaler la
ficelle ; On prend le chapeau par le bord, on le trempe
dans la chaudière, on le piece, on eh abat les bords
à plat, oh l’égoutte avec la piece, oh le tire au carrelet
èn-deffus & en-deflbus fans le fortir de deffus
l’a forme : cette opération le rend velu ; alors il eft
prêt a entrer en teinture.
Voici maintenant la maniéré dont on teint : au
refte les maîtres varient entr’eux &c fur la quantité
relative desingrédiens, & même fur les ingrédiens ;
il ne faut donc pas s’imaginer que ce que nous allons
dire foit d’un ïifage aufli général & aulîi uniforme
que ce que nous avons dit.
On teint un plus .grand ou un plus petit nombre de
(chapeaux, fiiivant la capacité de la chaudière ; on
teint jufqu’à 240 chapeaux à-la-fois. On les prend au
fortir de la foule de dégorgeage : oh commence par
remplir d’eau claire la chaudière à teindre, qu’on
voit fig. 2. Plane. I I I . de Chapelerie ; elle tient communément
cinq demi-muids. Avant que de la faire
chauffer, on y met toutes les drogues fuivantes : i°.
cent livres de bois d’inde haché par petits copeaux ;
i ° . douze livrés ou environ de gomme de pays ; 30.
lix livres de noix de galle : on fait bouillir le tout
pendant la nuit, environ deux à trois heures ; après
quoi on ajoute 40. fix livres ou environ de verdet
ou verd-de-grîs concaffé ; 50. dix livres de couperofe:
quand on met ces deux derniers ingrédiens, la chau-
fiiere ne bout plus, elle eft feulement chaude &c fur
fon bouillon.
Immédiatement après l’addition, on prend des
chapeaux, on en met cinquante à fond de la chau-r
diere rangés fur tête ; fur ceux-ci, on place les autres
forme contre forme par rangées, cinq rangées
fur le devant, quatre furie derrière; le nombre tant
de ceux du fond que des rângéês , eft de iao. On a
des perches qu’on étend en-travers fur les formes ;
on met dès planches fur les extrémités de ces perches,
& fur ceS planches des billots, qu’on voit fig. 2.
Plant. I I I . en a , b , dont ie poids tient les chapeaux
enfoncés dans la chaudière ; on les y laiffe une heure
&demie fans les remuer ; au bout de ce tems on les
feleve, & on les difperfe fur des planches oh ils
prennent leur évent. Pendant que ces 110 chapeaute
prennent leur évent, on place dans la chaudière les
120 autres, on lès y arrange comme les premiers ,
Oh les y laiffe le même tems, & on les rele ve. Avant
que dV faire rentrer ceux qui ont pris leur évent ,
on rafraîchit ( la chaudière , de quatre féaux de bois
d’inde ën copeaux. Remarquez qu’avant de lever
les chapeaux, il faut jetter fur la chaudière trois ou
quatre féaux d’eau froide dé rivière, pour écarter
l’écume, qui s’eft amaffée à là fut face :'qn ajoute aux
quatre féaux de bois d’inde environ trois livres- de
.Verd-de-gris , &fix livres de couperofe.; âpres quoi
on remet dahs la chaudière les 120 premiers chapeaux
, pour une heure & demie. Au bout de ce
ïems, on jette fur la chaudière trois ou quatre autres
féaux d’eau ; on les releve ; & on leur, donne l’é-
"Vent fur les planches , & on continue; iinfi jufqu’à
la quatrième chaude, qu’on rafraîchit encore la cuve,
mais les deux féaux feulement de bois d’inde êc de
Tonte I I I î 3
quatre livres de couperofe. On donrte feize chaudes
en tout c’eft huit chaudes & huit évents pour
chaque 120 chapeaux.
Quand le teint eft f a it , on porte les 240 chapeaux
au puits , oc on les lav e dans deux tonneaux d’eaù
claire , en les prenant l’un après l’autre, les humectant
& les broffant ; après quoi on les relave. Quand
ils foht re lav é s, on a une petite chaudière qu’on
appelle chaudière a retirer ; on la remplit d’eau de rivière
qu’on entretient bouillante ;' on y met les
chapeaux par trente , puis on les retire : les retirer.;
c’eft les prendre par les bords , les manier, & les
détirer fortement pour les abattre & les rendre
plats. À mefure qu’on en tire une douzaine de la
chaudière à retirer, on en v a prendre au puits douze
autres qu’on y remet ; & ainfi de fuite jufqu’à
la fin.
Au fortir de la chaudière à retirer, on les porte fur
une table oii on les retire encore,.mais c’eft pour les
rendre velus ; & ce retirage fe fait avec le c arrelet,
& fortement, & en-deffus & en-deffous. L e premier
retirage s’appelle retirage à l'eau ; celui-ci s’appelle
retirage à poil-. Il ne faut guere que fix heures pour
retirer en cette forte toute la teinture , tant à l’eau
qu’à poil.
Quand les chapeaux ont été retirés à po il, on les
porte aux étuves : il y a dans ces étuves un grand
bafiin fond fcellé dans le fo l, où l’on allume un bra-
fier ; on y porte les 240 chapeaux par portion , on
les y laiffe quatre heures ; & à chaque fois qu’on fort
& qu’on retire des chapeaux de l’é tuv e, on jette
environ fix boiffeaux de charbon dans le bafiin.
Quand ils font fe e s, on les met en tas hors des étuv
e s , tête fur tête ; on les broffe à fec avec une broffe
rude : cela s’appelle brofier la teinture. Quand ils font
broffes, on les luftre avec de l’eau claire ; puis on
les, remet aux étuves où ils pafient la nuit ; le lendemain
on les déforme, & on les rend au maître.
L e maître les remet aux apprêteurs ou appro-
prieûrs. L ’apprêt eft une efpece de colle qui fe com-
pofe de la maniéré fuivante : au refte il en eft encore
de ceci comme de la teinture, chacun a fa com-
pofition dont il fait un fecret même à fon confrère«
On prend de gomme de pay s quatre à cinq livres ,
de colle de Flandres trois à quatre livres , de gomme
arabique une demi-livre : on fait cuire le tout enfem-
ble à grands bouillons pendant trois à quatre heures..
Quand ce mélange eft c u it, on le paffe au t am is ;
& l’ on s’en fert enfuite pour apprêter. Il y en a qui
réclairciffçnt, à ce qu’on d it , avec l’amer de boe u f ;
on lui donne la confiftance de la bouillie avec l’eau
chaude. Voye^, fig. 3 > 4> 7 , Tattelier de
V' appréteur.
L ’appr êteur eft affis fur une chaife; il a devant lui
un bloc de bois ,fig. 3. monté fur quatre piés, & percé
dans le milieu d’un trou capable de recevoir la tê-
te , & à cpte.delui une pile de chapeaux à apprêter.
Il en prend uq , met la.forme dans le trou j du bloc ,
.p/end dansTa.chaudière' de l’apprêt avec un pinceau
à longs poils , tâte fon chapeau par-tout, donne un
.coup de .pinceau aux .endroits qui lui paroiffent foi-
blés, & paffe enfuite Ion pinceau fur tout le refte
de lafurface du bord, obfervant de fortifier d’apprêt
les endroits qu’ii a marqués d’abord comme foibles.'
Comme l’apprêt neiaiflè pas que d’être fluide, il eu
'coule un peu dans, lq tête du chapeau ; l’apprêteur
,aun pinceau.fecave.ç lequel il ramaffe & a en d cet
“apprêt. .
Le chapeau dans cet état paffe dans les mains d’un
autre ouvrier qui tient les baffins ; ces baflins“ ne font
I Autre chôfe que deux fourneaux 3 , 3 , qui ne different
de c,eux de cuifine qu’en ce que le foyer en eft
“conique; la grille eft à l’extrémité du côn e , & le cen-
. drier eft fous la grille. Ôn allume du feu dans le co