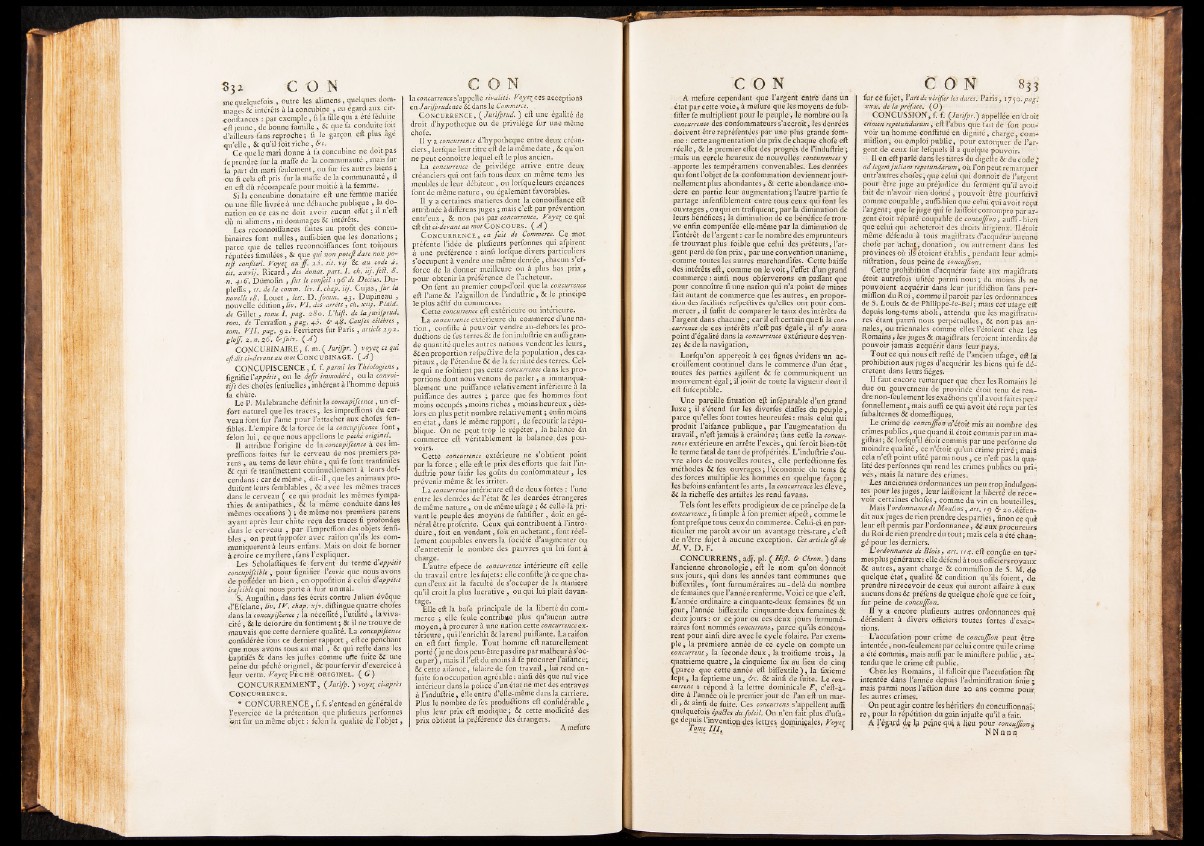
§31 C Q N
me quelquefoisoutre les alimens, quelques dommages
& intérêts à la concubine , eu égard aux cir-
■ conftances : par exemple, fi la fille qui a ete feduite
•«fi jeune, de bonne famille, & que fa conduite foit
d’ailleurs 'fans reproche ; fi le garçon eft plus âge
qu’elle , & qu’il foit riche, &c.
Ce que le mari donne à fa concubine ne doit .pas
fe prendre fur la maffe de la communauté -, mais fur
la part du mari feulement, ou fur fes autres biens j
•ou fi cela eft pris fur la maffe de la communauté, il
en eft dû récompenfe.pour moitié à la femme.
Si-la concubine donataire eft une femme mariee
ou une fille livrée à une débauche publique , la donation
en ce cas ne doit avoir aucun effet ; il n eft
dû ni alimens, ni dommages & intérêts.
Les reconnoiffances faites au profit des concu-
binaires font nulles, auffi-bien que les donations ;
parce que de telles reconnoiffances font toûjours
réputées fimulées, & que qui non potefl dan non potefl
confiuri. Vqyc[ au ff. z 5. tit. vij &C au code i .
tit, xxvij. Ricard, des donat. part. I. ch. ïij.fect. 8.
~n. 416". Dümolin , fur le confeil igCde Decius. Du-
pleffis , tr. de la comm. liv. I . chap. iij. Cujas, fur la
novelle 18. Louet , lett. D. fomm. 43. Dupineau ,
nouvelle édition, liv. VI. des arrêts, ch. xiij. Plaid,
de Gillet , tome I. pag. z8o. L'hifl. de lajurifprud.
rom. de Terraffon , pag. 46. & 4 8 . Caufes célébrés ,
tom. VII. pag. ÿ 2. Ferrieres fur Paris , article zc,z.
glojf. z .n . 2<T. &fuiv. ( A )
CONCUBIN AIRE, f. m. ( Jurifpr. ) voye{ ce qui
efl dit ci-devant au mot CONCUBINAGE. ( A )
CONCUPISCENCE, f. f.parmi les Théologiens ,
lignifie Y appétit, ou le . dejîr immodéré, ou la convoi-
tife des chofes fenfuelles, inhérent à l’homme depuis
fa chûre.
Le P. Malebranche définit la concupifcence , un effort
naturel que les traces, les impreflions du cerveau
font fur l’ame pour l’attacher aux chofés fen-
fibles. L’empire & la force de la concupifcence fon t,
félon lui, ce que nous appelions le péché originel.
Il attribue l’origine de la.concupifcence à ces im-
preflions faites fur le cerveau de nos premiers païens
, au tems de leur chute , qui fe font tranfmifes
& qui fe tranfmettent continuellement à leurs def-
cendans : carde même, dit-il, que les animauxpro-
duifent leurs femblables , & avec les mêmes traces
dans le cerveau ( ce qui produit les mêmes fympa-
thies & antipathies, & la même conduite dans les
mêmes occafions ) ; de même nos premiers parens
ayant après leur chiite reçu des traces fi profondes
dans le cerveau , par l’impreffion des objets fenfi-
bles , on peut fuppofer avec râifon qu’ils les communiquèrent
à leurs enfans. Mais on doit fe borner
à croire ce myftere ,fans l’expliquer.
Les Scholaftiques fe fervent du terme iïappétit
concupifcible , pour fignifier l'envie que nous avons
de pofféder un bien , en oppofition à celui d’appétit
irafcible qui nous porte à fuir un mal.
S. Auguftin, dans fes écrits contre Julien évêque
d’Efclane, liv. IV . chap. xjv. diftingue quatre chofes
dans la concupifcence ; la néceffité, l’utilité , la vivacité
, 8e le delordre du fentiment ; 8c il ne trouve de
mauvais que cette derniere qualité. La concupifcence
confidérée fous ce dernier rapport, eft ce penchant
que nous avons tous au mal , & qui refte dans les
baptifés 8c dans les juftes comme ufre fuite & une
peine du péché originel, & pourfervir d’exercice à
leur vertu. Voye^ Péché originel. ( G )
CONCURREMMENT, ( Jurifp. ) voyei ci-après
C oncurrence.
* CONCURRENCE, f. f. s’entend en général de
l’exercice de la prétention que plufieurs perfonnes
©nt fur un même objet : félon la qualité de l’ob je t,
la concurrence s’appelle rivalité. Voye^ ces acceptions
en Jur'fprudence & dans le Commerce. .
C o n c u r r e n c e , ( Jurifpru d. ) eft une égalité de
droit d’hypotheque ou de privilège fur une même
chofe.
Il y a concurrence d’hypotheque entre deux créanciers,
iorfque leur titre eft de la même date , & qu’on
ne peut connoître lequel eft le plus ancien.
La concurrence de privilège arrive entre deux
créanciers qui ont faifi tous deux en même tems les
meubles de leur débiteur, ou Iorfque leurs créances
font de même nature, ou également favorables.
Il y a certaines matières dont la connoiffance eft
attribuée à différens juges ; mais c’eft par prévention
entr’eux , 8e non pas par concurrence. Voye^ ce qui
eft dit ci-devant au mot ConCOURS. ( A )
C o n c u r r e n c e , en f a i t de Commerce. Ce mot
préfente l’idée de plufieurs perfonnes qui afpirent
à une préférence : ainfi Iorfque divers particuliers
s’occupent à vendre une même denrée, chacun s’efforce
de la donner meilleure ou à plus bas prix,
pour obtenir la préférence de l’acheteur.
On fent au premier coup-d’oeil que la concurrence
eft l’ame 8c l’aiguillon de l’induftrie, 8c le principe
le plus aâif du commerce.
Cette concurrence eft extérieure ou intérieure.
La concurrence extérieure du commercé d’une nation
, confifte à pouvoir vendre au-dehors les productions
de fes terres 8c de fohinduftrie en aufligrande
quantité que les autres nations vendent les leurs,
8c en proportion refpe&ive de la population, des capitaux
, de l’étendue 8c de la fertilité des terres. Celle
qui ne foûtient pas cette concurrence dans les proportions
dont nous venons de parler , a itnmanqua-
blement une puiffance relativement inférieure a la
puiffance des autres ; parce que fes hommes font
| moins occupés , moins riches , moins heureux , dès-
j lors en plus petit nombre relativement ; enfin moins
j en état, dans lé même rapport, de fecourir la répu-
| blique. On ne peut trop le répéter , la balance du
commerce eft véritablement la balance ; des pou-
yoirs. . #
Cette concurrence extérieure ne s’obtient point
par la force ; elle eft le prix des efforts que fait l’in-
duftrie pour faifir les goûts du confommateur, les
prévenir même 8c les irriter.
La concurrence intérieure eft de deux fortes : i’üne
entre les denrées de l’état 8c les denrées étrangères
de même nature, ou de mêmeufage ; 8c celle-là privant
le peuple des moyens de fubfifter, doit en général
être proferite. Ceux qui contribuent à l’introduire
, foit en vendant, foit en achetant, font réellement
coupables envers la fociété d’augmenter ou
d’entretenir le nombre des pauvres qui lui font à
charge.
L’autre efpece de concurrence intérieure eft celle
du travail entre les fujets : elle confifte ;à ce que chacun
d’eux ait la faculté de s’occuper de la maniéré
qu’il croit la plus lucrative , ou qui lui plaît davan-
tage.
Elle eft la bafe principale de la liberté du commerce
; elle feule contribue plus qu’aucun autre
moyen, à procurer à une nation cette concurrence ex-
térieure, qui l’enrichit 8c la rend puiffante. La raifon
en eft fort fimple. Tout homme eft naturellement
porté ( je ne dois peut-être pas dire par malheur às’oc-
cuper) , mais il l’eft du moins à fe procurer l’aifance;
8c cette aifance, falàire de fon travail, lui rend en-
fuite fonoccupation agréable : ainfi dès que nul vice
intérieur dans la police d’un état ne met des entraves
à l’induftrie, elle entre d’elle-même dans la carrière.
Plus le nombre de fes productions eft confidérable,
plus leur prix eft modique; 8c .cette modicité des
prix obtient la préférence des étrangers.
Améfure
C O N
A mefure cependant que l’argent entre dans un
. état par cette voie, à mèfure que les moyens defub-
. fifter fe multiplient pour le peuple', le nombre ou la
concurrence des confommateùrs s’accroît, lès denrées
. doivent être repréfentées par une plus grande fom-
• me : cette augmentatioffdu prix de chaque chofe eft
réelle, & le premier effet des progrès de Tinduftrie';
rmais un cercle heureux de nouvellés; concurrences y
- apporte les tempéramens convenables. Les denrées
qui font l’objet de la confommation deviennent joiir-
: nellement plus abondantes, 8c cette abondance mo-
:dere en partie leur augmentation ; l’autre partie fe
partage infenfiblement entre tous ceux qui font les
. ouvrages, ou qui en trafiquent, par la diminution de
leurs bénéfices; la diminution de ce bénéfice fe trou-
. ve enfin compenfée elle-même par la diminution de
, l’intérêt de l’argent : car le nombre des emprunteurs
. fe trouvant plus foible que celui des prêteurs, l’ar-
:gent perd de fon prix, par une convention unanime,
comme toutes les autres marchandifes. Cette baiffe
des intérêts eft, comme on le voit, l’effet d’un grand
. commerce : ainfi nous obferverons en paffant que
pour connoître fi une nation qui n’a poiRt de mines
fait autant .de commerce que les autres, en proportion
des facilités refpeftives qu’elles ont pour commercer
, il fuffit de comparer le taux des intérêts de
l’argent dans chacune ; car il eft certain que fi la con-
. currence de ces intérêts n’eft pas égale, il n’y aura
point d’égalité dans la concurrence extérieure des ventes
8c de la navigation.
Lorfqu’on apperçoit à ces lignes évidens un ac-
croiffement continuel dans le commerce d’un état,
toutes fes parties agiffent 8c fe communiquent un
mouvement égal; il joiiit de toute la vigueur dont il
eft fufceptible.
Une pareille fituation e|t inféparable d’un grand
luxe ; il s’étend fur les diverfes claffes du peuple,,
parce qu’elles font toutes heureufes : mais celui qui
produit l’aifance publique, par l’augmentation du
travail, n’eft jamais à craindre; fans ceffe la concurrence
extérieure en arrête l’excès, qui feroit bien-tôt
le terme fatal de tant de profpérités. L’induftrie s’ouvre
alors de nouvelles routes, elle perfectionne fes
méthodes 8c fes ouvrages; l’économie du tems 8c
des forces multiplie les hommes en quelque .façon ;
les befoins enfantent les arts, la concurrence les éleve,
8c la richeffe des artiftes les rend favans.
Tels font les effets prodigieux de ce principe de la
concurrence, fi fimple à fon premier afpeCt, comme le
font prefque tous ceux du commerce. Celui-ci en particulier
me paroît avoir un avantage très-rare, c’eft
de n’être fujet à aucune exception. Cet article eß de
M . V. D. F.
CONCURRENS, adj. pl. ( Hiß» 8* Chron. ) dans
l’ancienne chronologie, eft le nom qu’on donnoit
r u x jours, qui dans les années tant communes que
biffextilès, font furnuméraires au-delà du nombre
de femaines que l’année renferme. Voici ce que c’eft.
L’année ordinaire a cinquante-deux femaines 8c un
jour, l’année biffextile cinquante-deux femaines 8e
deux jours : or ce jour ou ces deux jours furnuméraires
font nommés concurrens, parce qu’ils concourent
pour ainfi dire avec le cycle folaire. Par exemple
, la première année de ce cycle on compte un
concurrent9 la fécondé deux, latroifieme trois, là
quatrième quatre, la cinquième fix au lieu do cinq
(parce que cette année eft biffextile), la fixieme
fept, la leptieme un, &c. 8c ainfi de fuite. Le concurrent
1 répond à la lettre dominicale F , c’eft-à-
dire à l’année oîi le premier jour de l’an eft un mardi,
8e ainfi de fuite. Ces concurrens s’appellent auffi
quelquefois épactes du foleil. On n’en fait plus d’ufage
depuis l’inventfop des lettres dominicales, Voyez
Tome I I I k ' “ 1 ^ -
C O N 833
fur ce fujet, ra f t de vérifier les datés. Paris, i J ’jO .p a g l
x x x '. de la prcfacc.> (O) •
CONCUSSION, f. f. (Jurifpr.') àppellée endroit
crimtn repetundamm ^ eft. l’abus que fait de fon pou^
voir un homme conftitdé en dignité, Charge, com-*
million', ou emploi public, pour extorquer de l’argent
de ceux fur lefquèls il a quelque pouvoir. '
• Il en eft parlé dans les titres du digefte 8e du code 1
a d legem ju li am repetùndàrufn ; oii l’on peut remarquer
entr’aufreschofès,que celui qui donhoit de l’afgent
pouf êfre jugé au préjudice du ferment qu’il avoir
fait de n’avoir rien donné, pouvoit être pourfuivï
comme coupable, auflùbien que celui qui à voit reçut
l’argent ; que le juge qui fe laiffoit corrompre par argent
éfoit réputé coupable de concuffion, auffi -bieri
que celui qui achetërdit des droits litigièiix: Il étoit
même défendu à tous magiftrats d’acquérir’aucune
chofe par ‘achat * donation, ou autrement dans leâ
provinces oit ils étoient établis, pendant leur admi-
niftration, fous peine de concuffion.
Cettè prohibition d’acquérir faite aux magiftrats
étoit autrefois ufitée parmi nous; du moins ils ne
pouvaient acquérir dans leur jurifdi&ion fans per-
miffion du Roi, comme il paroît par les ordonnances
de S. Louis & de Philippe-Ie-Bel; mais cét ufage eft
depuis long-tems aboli » attendu que les riiagiftratu-
res étant parmi nous perpétuelles, & non pas annales,
ou triennales comme elles l’étoient chez les
Romains , les ju g e s & magiftrats feroient interdits de
pouvoir jamais acquérir dans leur pays,.
Tout ce qui nous eft refté de l’ancien ufage, eft là
prohibition aux juges d’acquérir les biens qui fe décrètent
dans leurs fiéges.
Il faut encore remarquer que chez les Romains l é
duc pu gouverneür de prpvinde étoit tenu de rendre
non-feulement lès exaftions qu’ij avoit faites per-
fonnellement, mais aufli ce qui avoit été reçu par fes
fubalternes & domeftiques.
Le crime de concuffion n’étoit mis au nombre des
crimes publics, que quand il étoit commis par un ma-
giftrat ; & lorfqu’il éfoit commis par une perfonne de
moindre qualité, ce n’étoit qu’un crime privé ;mais
cela n’eft point ufité parmi nous, ce 'n’eft pas la qualité
des perfonnes qui rend les crimes publics ou privés
, mais la nature des crimes.
Les anciennes ordonnances un peu trop indulgentes
pour les juges, leur laifloient la liberté de recevoir
certaines chofes, comme du vin en bouteilles.
Mais Y ordonnance de M o u lin s, art. ic) 6* z o . défendit
aux juges de rien prendre des parties, ifinon ce qui
leur eft permis par l’ordonnance, & aux procureurs
du Roi de rien prendre du tout; mais cela a été changé
pour les derniers.
L’ordonnance de B lo is , art. 114. eft conçûe èn termes
plus généraux : elle défend à tous officiers royaux
& autres, ayant charge 8t commiffion de S. M. de
quelque état, qualité & condition qu’ils foient, de
prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire à eux
aucuns dons & préfens de quelque chofe que ce foit,
fur peine de concuffion.
Il y a encore plufieurs autres ordonnances qui
défendent à divers officiers toutes fortes d’exactions.
L’accufation pour crime de concuffion peut être
intentée, non-feulement par celui contre qui le crime
a été commis, mais auffi par le miniftere public, attendu
que le crime eft public.
Chez les Romains, il falloir que l’accufation fut
intentée dans l’année depuis l’adminiftration finie ;
mais parmi nous l’aftion dure 2.0 ans comme pour,
les autres crimes.
On peut agir contre les héritiers du concuffionnai-1
re, pour la répétition du gain injufte qu’il a fait.
A l’égard dç lu pèinç qui a lieu pour concuffion*
NNnnn