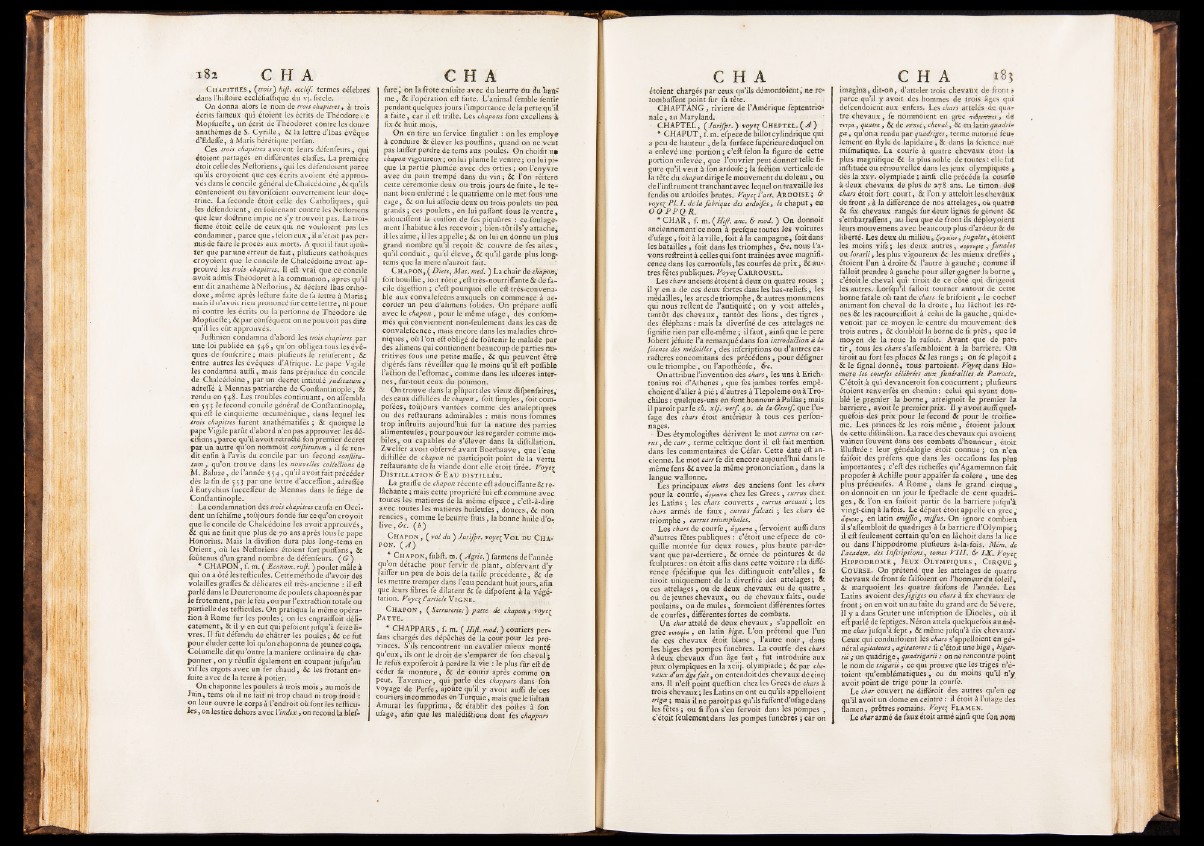
C hapitres , (trois') hiß. eccléf. termes célébrés
•dans l’hiftoire eccléfiaftique du vj. fiecle.
On donna alors le nom de trois chapitres, à- trois
•écrits fameux qui étoient les écrits de Théodore de
Mopfuefte, un écrit de Théodoret contre les douze
anathèmes de S. Cyrille, & la lettre d’ibas évêque
d’Edefle, à Maris hérétique perfan.
Ces trois chapitres avoient leurs défenfeurs-, qui
étoient partagés en différentes claffes. La première
étoit celle des Neftoriens, qui les défendoient parce
^qu’ils croyoient que ces écrits avoient été approu-
vés dans le concile général de Chalcédoine, & qu’ils
contenoient ou favorifoient ouvertement leur doctrine.
La fécondé étoit celle des Catholiques, qui
les défendoient, enfoûtenant contre les Neftoriens
que leur do&rine impie ne s’y trouvoit pas. La troi-
fieme étoit celle de ceux qui ne vouloient pas1 les
condamner, parce que, félon eu x , il n’étoit pas permis
de faire le procès aux morts. A quoi il faut ajouter
que par une erreur de fait ,- plufieurs catholiques
croyoient que le concile de Chalcédoine avoit approuvé
les trois chapitres. Il eft vrai que ce concile
•avoit admis Théodoret à la communion, après qu’il
eut dit anathème à Neftorius , & déclaré Ibas orthodoxe
,.même après leéture faite de fa lettre à Maris ;
mais il n’avoit rien prononcé fur cette lettre, ni pour,
ni contre les écrits ou la perfonne de Théodore de
Mopfuefte ; & par conféquent on ne pou voit pas dire
qu’il les eût approuvés».
Juftinien condamna d’abord les trois chapitres par
une loi publiée en 546, qu’on obligea tous les évêques
de fouferire ; mais plufieurs le refuferent, &
entre autres les évêques d’Afrique. Le pape Vigile
les condamna aufli, mais fans préjudice du concile
de Chalcédoine, par un decret intitulé judicatum|
adreffé à Mennas patriarche de Conftantinople, &
rendu en 548. Les troubles continuant, onaffembla
eh 5 5 3 le fécond concile général de Conftantinople,
qui eft le cinquième oecuménique, dans lequel les
trois chapitres furent anathématifés ; & quoique le
pape Vigile parût d’abord n’en pas approuver les décriions
, parce qu’il avoit retratté fon premier' decret
par un autre qu’on nommoit conflitutum , il fe rendit
enfin à l’avis du concile par un fécond confiitu-
tum, qu’on trouve dans les nouvelles collections de
M. Baluze, de l’année 554, qu’il avoit fait précéder
dès la fin de 753 par une lettre d’acceflîon, adreffée
à Eutychius lucceffeur de Mennas dans le fiége de
Conftantinople.
La condamnation des trois chapitres caufa en O ccident
unfchifme,toûjours fondé fur ce qu’on croyoit
que le concile de Chalcédoine les avoit approuvés,
& qui ne finit que plus de 70 ans après fous le pape
Honorius. Mais la divifion dura plus long-tems en
Orient, où les Neftoriens étoient fort puiffans, &
foûtenus d’un grand nombre de défenfeurs. ( G )
* CHAPON, f. m. ( Econom. rufi. ) poulet mâle à
qui on a ôté les tefticules. Cette méthode d’avoir des
volailles grafles& délicates eft très-ancienne : il eft
parlé dans le Deuteronome depoulets chaponnés par
le ff otement, par le feu , ou par l’extraâion totale ou
partielle des tefticules. On pratiqua la même opération
à Rome fur les poules ; on les engraiffoit délicatement,
& il y en eut qui pefoient jufqu’à feize livres.
Il fut défendu de châtrer les poules ; & ce fut
pour éluder cette loi qu’on chaponna de jeunes coqs.
Columelle dit qu’outre la maniéré ordinaire de cha-
ponner, on y réuffit également en coupant jufqu’au
v i f les ergots avec un-fer chaud , & les frotant en-
fuite avec de la terre à potier*
On chaponne les poulets à trois mois, au mois de
Juin , tems où il ne fait rii trop chaud ni trop froid :
on leur ouvre le corps à l’endroit où font les teftieu-
ies, on les tire dehors avec Yindfx » on recoud fa bieffuré
j On la fiote enfuîtè avec du beulte Ou du bau*
me, & l’opération eft faite. L ’animal femble feritir
pendant quelques jours l ’importance de la peftequ’il
a faite, car il eft trifte. Les chapons font excellens à
fix & huit mois.
On en tire un fervice fingulier : on les employé
à conduire & élever les pouflins, quand on ne veut
pas laifler perdre de tems aux poules. On choifit 11»
chapon vigoureux; on lui plume le ventre; on lui pi»
que la partie plumée- avec des orties-; on l’enyvre
avec du pain trempé dans du vin ; & l’on réitère
cette cérémonie deux ou trois jours de fuite, de te»
nant bien enfermé : le quatrième on le met fous une
■ cage, & on lui aflocie deux ou trois poulets un pèit
grands ; ces poulets, en lui paflant fous le ventre ,
adouciflent la cuilfon de fes piquûres : ceToulage*
ment l’habitue à les recevoir ; bien-tôt ils’y attache^
il les aime, il les appelle ; & on lui en donne un plus
grand nombre qu’il reçoit & couvre de fes ailes-,
qu’il conduit, qu’il éleve, & qu’il garde plus long*-
tems que la mere n’auroit fait.
C hapon, ( Dicte, Mat. med. ) La chair de chapon»
foit bouillie, loit rôtie, eft très-nourri(Tante & de facile
digeftion ; c’eft pourquoi elle eft très-convenable
aux convalefcens auxquels on commence à accorder
un peu d’alimens folides. On prépare- aiiflt
avec le chapon , pour le même ufage, des confom-
més qui conviennent non-feulement dans les cas de
convalefcence, mais encore dans les maladies chroniques
, où l ’on eft obligé de foûtenir le malade par
des alimens qui contiennent beaucoup de parties nutritives
fous une petite maffe, & qui peuvent être
digérés fans réveiller que le moins qu’il eft pofiiblè
l’aélion de l’eftomac, comme dans les ulcérés internes,
fur-tout ceux du poumon.
On trouve dans la plupart des vieux difpenfaires,’
des eaux diftillées de chapon, foit fimples, foit com-
poféeS, toujours vantées comme des analeptiques
ou des reftaurans admirables : mais nous fommes
trop inftrùits aujourd’hui fur la nature des parties
alimenteufes, pour pouvoir les regarder comme mobiles,
ou capables de s’élever dans la diftillatiorù
Zwelfer avoit obfervé avant Boerhaave, que l’eau
diftillée de chapon né participôit point de là vertu
reftaurante de là viande dont elle étoit tirée. Voyez
D ist il la t io n <S*Eàu d is t il l é e .
La graiflè de chapon récente eft adouciflante & relâchante
; mais cette propriété lui eft commune avec,
toutes les matières de la même efpece, c’eft-à-diré
avec toutes les matières huileufes, douces, & non
rencies , comme le beurre frais, la bonne huile d’o»
liv e ,& c . (&)
C hapon , ( vol du ) Jurifpr. voye^Vol du C ha-
pon . ( A )
* C hapon, fubft. m. ( Agric. ) farmens dê l’année
qu’on détache pour fervir de plant, obfervant d’y
laifler un peu de bois de la taille précédente, & de
les mettre tremper dans l’eau pendant huit jours, afin
que leurs fibres fe dilatent & fe difpofent à la végétation.
Voye^fiarticle V ig n e .
CHAPON, ( Serrurerie.-) patte, dt chapon»-.voye?
Pa t t e .
* CHAPPARS, f. m. ( Hiß. mod. ) couriers per-
fans chargés des dépêches de la cour pour les prd-
vinces. S’ils rencontrent un cavalier mieux monté
qu’eux, ils ont le droit de s’emparer de fon cheval;;
le refus expoferoit à perdre la vie : le plus fur eft dè
céder fa monture, &ç de çôurir après comme oh
peut. Tavernier, qui parle des chappars dans fon
voyage de Perfe, ajoute qu’il y avoit aufli de ces
couriers incommodes en Turquie, mais que le fultan
Amürat les fupprima, & établit des poftes à fon
ufage, afin que les malédi&ions dont fes çkappars
étoient chargés par ceux qu’ils démontôient, ne fe*
tombaflent point fur la tête.
CHAPTANG, rivière de l’Amérique feptentrio*
nale, au Maryland.
CHAPTEL, ( Jurifpr. ) voyez C hepteL. ( A }
* CHAPUT, 1. m. efpece de billot cylindrique qui
a peu de hauteur, delà furface fupérieureduquel on
a enlevé une portion ; c’eft félon la figure de cette
portion enlevée, que l’ouvrier peut donner telle figure
qu’il veut à fon ardoifë ; la feftion verticale de
la tête du chaput dirige le mouvement du doleau, ou
de l’inftrument tranchant avec lequel on travaille les
fendis ou ardoifes brutes. Voye^L'art. A rd o ise ; &
voye^ PI. I . de la fabrique des ardoifes , le chaput, en
O O P P Q R .
* CH AR , f. m. ( Hifi. anc. & mod. ) On donnoit
anciennement ce nom à pr.efque toutes les voitures
d’ufage, foit à la ville, foit à la campagne, foit dans
les batailles, foit dans les triomphes, &c. nous l ’avons
reftreint à celles qui font traînées avec magnificence
dans les carroufels,les courfes de prix, &<au-.
très fêtes publiques. Voyez C arrousel. .
Les chars anciens étoient à deux ou quatre roues ;
il y en a de ces deux fortes dans les bas-reliefs, les
médailles, les arcs de triomphe, & autres monumens
qui nous relient de l’antiquité ; on y voit attelés,
tantôt des chevaux, tantôt des lions , des tigres ,
des éléphans : mais la diverfité de ces attelages ne
lignifie rien par elle-même ; il faut, ainfi que le pere
Jobert jéfuite l’a remarqué dans fon introduction à la
fcience des médailles, des inferiptions ou d’autres caractères
concomitans des précédens, pour défigner
ou le triomphe, ou l’apothéofe, &c.
On attribue l’invention des chars, les uns à Erich-
tonius roi d’Athènes , que fes jambes torfes empê-
choient d’aller à pié ; d’autres àTlepoleme ou à Trq-
chilus : quelques-uns en font honneur à Pallas ; mais
il paroît parle ch. x lj. verf. 40. de la Genef. que L’u-
fage des chars étoit antérieur à tous ces perfon-
nages.
Des étymologiftes dérivent le mot currus ou car-
rus , de carr,. terme celtique dont il eft fait mention
dans les commentaires de Céfar. Cette date eft ancienne.
Le mot carr fe dit encore aujourd’hui dans le
même fens & avec la même prononciation, dans la
langue vallonné.
Les principaux chars des anciens font les chars
pour la courfe, dpptret chez les G re c s, currus chez,
les Latins ; les chars couverts , currus arcuati ; les.
chars armés de faux, currus falcati ; les chars de
triomphe , currus triumphales.
Les chars de courfe, uppara, fervoient aufli dans
d’autres 'fêtes publiques : c’étoit une efpece de coquille
montée fur deux roues, plus haute par-de^
vant que par-derriere, & Ornée de peintures & de
fculptures : on étoit affis dans cette voiture : la différence
fpécifique qui les., diftinguoit entr’elles, fe
tiroit uniquement de la diverfité des attelages ; 8c
ces attelages , ou de deux chevaux ou de quatre ,
ou de jeunes chevaux, ou de chevaux faits, ou de
poulains, ou de mules, formoient différentes fortes
de courfes, différentes fortes de combats.
Un char attelé de deux chevaux, s’appelloit en
grec evvaput , en latin bigoe. L’on prétend que l’un
de ces chevaux étoit blanc , l’autre n o ir, dans
les biges des pompes funèbres. La courfe des chars
à deux chevaux d’un âge fa it , fut introduite aux
jeux olympiques en la xciij. olympiade ; & par chevaux
eCun âge fa it, on entendoitdes chevaux de cinq
ans. Il n’eft point queftion chez les Grecs de chars à
trois chevaux ; les Latins en ont eu qu’ils appelloient
trigoe ; mais il ne paroît pas qu’ils fuffent d’ufage dans
les fêtes ; ou li l’on s’en fervoit dans les pompes ,
c’ctoit feulement dans les pompes funèbres ; car on
imagina* dit-oft, d’atteler trois chevaüx de front »
parce qu’fl y avoit des hommes de trois âges qui
defeendoient aux enfers. Les chars attelés de quatre
chevaux * fe nommoient en grec TtBpfnVroi, de
Ttrpet, quatre , & de /ttwoç , cheval, &c en latin efuadri*
gtef qu’on a rendu par quadriges, terme autorité feulement
en ftyle de lapidaire, & dans la fcience nu^
mil'matique. La courfe à quatre chevaux étoit la
plus magnifique & la plus noble de toutes t elle fut
inftituée ou renouvellée dans les jeux olympiques *
dès la xxv* olympiade ; ainfi elle précéda la courfe
à deux chevaux de plus de 278 ans. Le timon , de$
chars ctoit fort court, & l’pn y atteloitleschevâux
de front, à la différence de nos attelages, où quatre
<3c fix . chevaux rangés fur deux lignés fe gênent &£
s’embarraffent, au lieu que de front ils déplo.yoient
leurs mouvemens avec beaucoup plus d’ardeur & de
liberté. Les deux du milieuÇu'yaîoi, /ugales, étoient
les moins vifs ; les deux autres, aopruptç, funale$
où lorarii » les plus vigoureux & les mieux drefles *
étoient l’un à droite ôc l’autre à gauche ; comme il
falloit prendre à gauche,pour aller gagner la borne ,
c’étoit le cheval qui1 tirait de ce côte qui dirigeoit
lesjiutres. Lorfqu’il fallait tourner autour de cette
borne fatale où tant de chars. fè brifoient, |le cocher
animant fon cheval de la droite , lui lâchoit les renés
& les racourciffoit à :celui de la gauche, qûiide-
venoit par ce moyen le centre du mouvement des
trois autres, & doubloit la borne de fi. près , que le
moyen de la roue la rafoit> Avant que de par<î
tir, tous les chars s?affembloient à la barrière; On
tiroit au fort les places & les rangs ; on fe plaçoit ;
& le lignai donné, tous , partoient. Vcyez davs Homère
les courfes célébrées aux funérailles de Patrocle.
C’étoit à qui devancerait fon concurrent ; plufieurs
étoient xenverfés en. chemin : celui qui ayant dou*
blé îe premier la borne, atteignoit le premier la
barrière, avoit le premier prix. Il y avoit àuflî quelquefois
des prix pour le fécond & pour le troifie»
trie, Les princes & les rois même, étoient jaloux
de cette diftinâion.. La race des chevaux qui avoient
vaincu fouvent dans ces combats d’honneur, étoit
illuftrée : leur généalogie étoit connue ; on n’en
faifoit des préfens que dans les occafions les plus
importantes ; c’eft des richefles qu’Agamemnon fait
propofer à Achille pour appaifer fa colere , une des
plus précieufes. A Rome, dans le grand cirque ,
on donnoit en un jour le fpeétacle de cent quadriges
, & l’on en faifoit partir de la barrière jufqu’à
vingt-cinq à la fois. Le départ étoit appellé en grec,’
dçieiç, en latin emifjio, miffus. On ignore combien
il s’aflembloit de quadriges à la barrière d’Olympie;
il eft feulement certain qu’on en lâchoit dans la lice
ou dans l’hippodrome plufieurs à-Ia-fois. Mém. de
tacadejn. des Inferiptions, tomes V III. & IX . Voyez
Hip p o d r o m e , Jeux O lympiqu es , C ir q u e ,
C ourse. On prétend que les attelages de quatre
chevaux de front fe faifoient en l’honneur du io le il,
& marquoient les quatre faifons de l’année. Les
Latins avoient desfegiges ou chars à fix chevaux de
front ; on en voit un au faîte du grand arc de Sévere.
II y a dans Gruter une infeription de Dioclès, où it
eft parlé de feptiges. Néron attela quelquefois au même
char jufqu’à fept, & même jufqu’à dix chevaux*
Ceux qui conduifoient les chars s’appelloient en général
agitateurs, agitatores : fi c’étoit une bige, bigar-
r ii} un quadrige, quadrigarii : on ne rencontré point
le nom de trigarii, ce qui prouve que les triges fi’é-
toient qu’emblématiques, ou du moins qu’il n’y
avoit point de trige pour la courfe.
Le char couvert ne différait des autres qu’en ce
qu’il avoit un dôme en ceintre : il étoit à l’ufage des
namen, prêtres romains. Voyez Fl amen.
Le char armé de faux étoit armé ainfi que fon nom