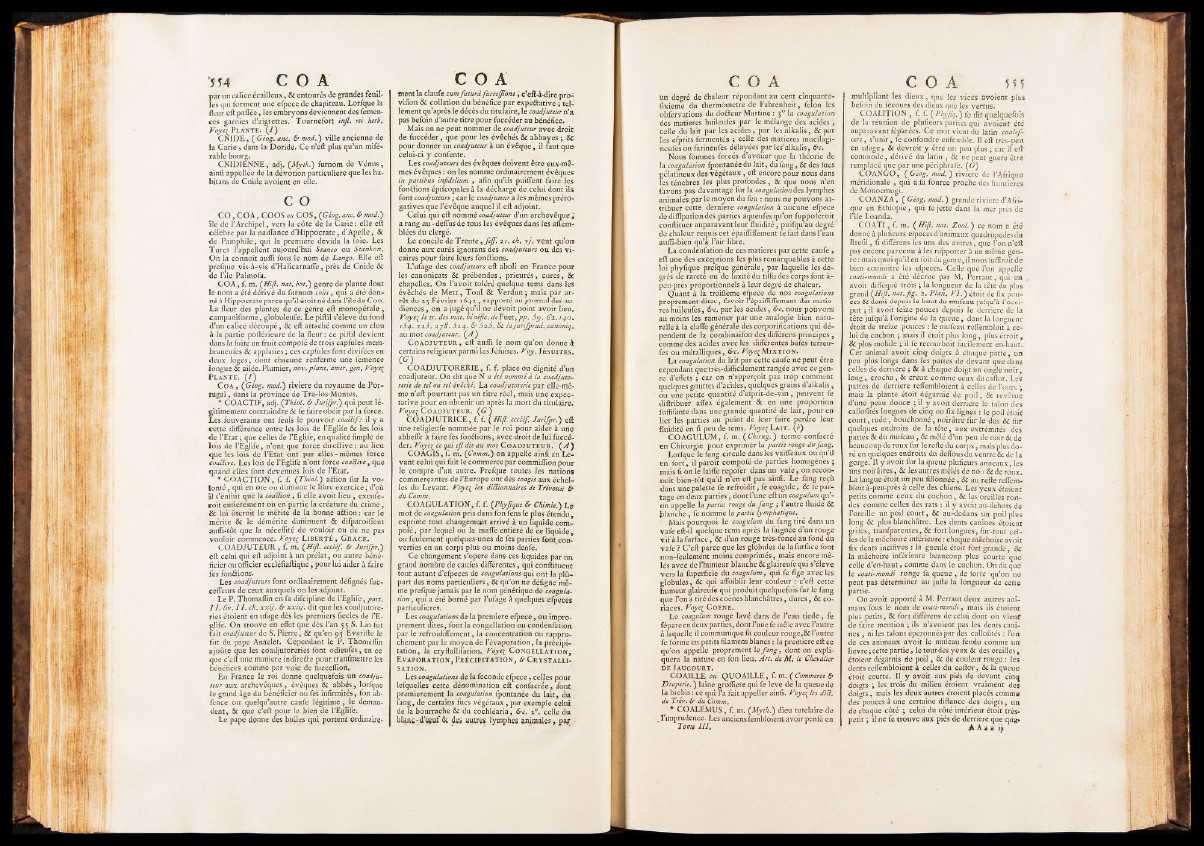
,’î'54 C O A
par un calice écailleux, & entourés de grandes feuilles
qui forment une efpece de chapiteau. Lorfque la
fleur eft paffée, les embryons deviennent des femen-
ces garnies d’aigrettes. Tournefort injt. rei forb.
Voyei Plante, (ƒ )
CN ID E , ( Géog. anc. & mod.) ville ancienne de
fa C a rie, dans la Doride. Ce n’eft plus qu’un mifé-
ràble bourg.
CNIDIENNE, adj. (Myth.) furnom de Vénus,
ainli appëllée de la dévotion particulière que les ha-
bitans de Cnide avoient en elle.
C O
CO , C O A , COOS ou CO S , (Géog. anc. & mod.')
île de l’Archipel, vers la côte de la Carie : éllè eft
célébré par la naiffance d’Hippocrate, d’Apelle, &
de Pamphile, qui la première dévida la l’oie. Les
Turcs l’appellent aujourd’hui Stanco ou Stankon.
On la eonnoît aulîi fous le nom de Lango. Elle eft
prefque vis-à-vis d’Halicarnaffe, près de Cnide &
de l’ile Palmofa.
C O A , f. m. (Hifl. nat. bot.) genre de plante dont
le nom a été dérivé du furnom cous, qui a été donné
à Hippocrate parce qu’il étoit né dans l’îlede Coo.
La fleur des plantes de ce genre eft monopétale,
campaniforme, globuleufe. Le piftil s’élève du fond
d’un calice découpé, & eft attaché comme un clou
à la partie pôftérieurë de la fleut : ce piftil dévient
dans la fuite un fruit compofé de trois capfules mérii-
braneufes & applaties ; ces capfules font divifées en
deux loges', dont chacune renferme une femence
longue & ailée. Plumier, nov.plant, amer. gen. Voye\_
P lan t e . ( / )
C o a , (Géog. mod.) riviere du royaume de Portugal
, dans la province de Tra-los-Montes.
* COACTIF, .adj. (Théol. & Jurifpr.) qui peut légitimement
contraindre &c fe faire obéir par la force.
Les fouverains ont feuls le pouvoir coactif: il y a
cette, différence entre les lois de l’Eglife &c les lois
de l’Etat ; que celles de l’Eglife, en qualité Ample de
lois de l’Eglife, n’ont que force directive : au lieu
que les lois de l’Etat ont par elles - mêmes force
coactive. Les lois de l’Eglife n’ont force coactive, que
qïîârid elles font devenues lois de l’Etat.
* * CO A C T IO N , f. f. (Théol.') aûion fur la vo lonté,
qui en ôte ou diminue .le libre exercice; d’où
i l s’enfuit que la coacHoh , fl elle a voit lieu , exeufe-
roit entièrement où en partie la créature du crime,
ôc lui ôteroit le mérité dé la bonne àâion : car le
mérite 6c le démérite diminuent & difparoiffent
aufli-tôt que la hëceflité de vouloir ou dé rie pas
vouloir commence. Voye^ L ib e r t é , Gr â c e .
COADJUTEUR , f. m. (Hift. eccléf. & Jurifpr.)
eft celui qui eft adjoint à un prélat, ou autre bénéficier
ou officier eccléfiàftique, pour lui aider à faire
fes fondions.
Les coadjuteurs font ordinairemerit défignés fuc-
ceffeurs de ceux auxquels on les adjoint.
Le P. Thomaflin en fa difeipline de l’Eglife, part.
1 1. liv. 1 1. ch. xx ij. & xxiij. ait que lés coadjutore-
riéS étoient en ufage dès les premiers fiecles de l’Eglife.
On trouve en effet que dès l’an 5 5 S. Lin fut
fait coadjuteur de S. Pierre, & qU’en 95 Evarifte le
fut du pape Anaclét. Cependant le P. Thomaflin
ajoute que les coadjutoreriès font odieufes, èn té
que c’en une maniéré indirefte pour tranfmëttre les
bénéfices côirimé par voie de fucceflion.
En France le roi donne quelquefois ün coadjuteur
aux archevêques $ évêques & abbés, lorfque
le grand âge du bénéficie^ ou fe§ infirmités, fon ab-
fence ou quelqu’autre caufe légitime, le demandent,
& que c’eft pour le bien de l’Ëglife.
Le pape donne des bulles qui portent ordinaire-
C O A
ment la claufe cum futura fucceßione , c ’eft-à-dïre pro-
viflon & collation du bénéfice par expeôative ; tellement
qu’après le décès du titulaire, le coadjuteur n’a
pas befoin d’autre titre pour fuccéder au bénéfice.
Mais on ne peut nommer dé coadjuteur avec droit
de fuccéder, que pour les évêchés 6c abbayes ; &
pour donner un coadjuteur à un évêque, il faut qu©
celui-ci y confente.
Les coadjuteurs des évêques doivent être eux-mêmes
évêques : on les nomme ordinairement évêques
in partibus infidelium , afin qu’ils puiffent faire les
fondions épifcopales à la décharge de celui dont ils
font coadjuteurs ; car le coadjuteur a les mêmes préro-,
gatives que l’évêque auquel il eft adjoint.
Celui qui eft nommé coadjuteur d’un archevêque i
a rang au-deffus de tous les évêques dans les affem*
blées du clergé.
Le concile de Trente, f f f . z i . ch. vj. veut qu’oit
donne aux curés ignorans des coadjuteurs ou des v icaires
pour faire leurs fondions.
L’ufage des coadjuteurs eft aboli en France pour
les canonicats 6c prébendes, prieurés, cures, &
chapelles. On l’avoit toléré quelque tems dans les
évêchés de Metz, Tout 6c Verdun; mais par arrêt
du 2.5 Février 16 4 1 , rapporté au journal des audiences
, on a jugé qu’il ne devoit point avoir lieu.
Voyc^ le tr. des mat. bénèfic. deFùet,pp. 5<). 62. 140
1S4. z z 5. zy8. S 24. & 5z 5, 6c lajurifprud. canoniq.
au mot coadjuteur. (À )
C oadjuteur , eft auffi le nom qu’on donne à
certains religieux parmi les Jéfuites. Voy. Jesùites.
(g ) ..........................m m .......................................
COADJUTORÉRiE, f. f. place ou dignité d’un-
coadjuteur. Q n dit que N a été nommé à la coadjuto-
rerie de tel ou tel évêché. La coàdjüiorerie par elle-même
n’eft pourtant pas uri titré réel, mais une expectative
pour en obtenir uri après la mort du titulaire'.
Voye^ C oad juteur. (G )
CO ADJÜTRICE , f. f. (Hiß. eccléf. Jurifpr.) eft
une réligieufe nommée par le roi pour aider à urie
abbeffe à faire fes fondions, avec droit de lui füëcé-
der. Voyt^ ce qui èfi dit àu mot CoADJUTEUft. ( A )
C O AGIS, f. m. (Comm.) on appelle ainfi ait t é -
varit celui qui fait le commerce par comiriilfiori pour
le compte d’un autre. Prefque toutes les riàtiori®
commerçantes de l’Europe ont des côdgis aux échelles
du Levant. Voyè{ les dictionnairei de Ttévèüx &
du Comm.
COAGULATION, f. f. (Phyfique & Chitniè.) Lé
mot de coagulation pris dans fon feris le plus étendu ,
eXprirrie tout changement arrivé à un liquide coftte
pofé, par lequel ou la ritäffe entiefé de ce liquide,
oit feulement quelques-unes dè fes parties fiiJrit converties
en un corps plus ou moins derifé*
Ce changement s’opère dans ces liquides par tin
grand riohtbrë de caufes différentes, qui côriftituent
tout autant d’efpeces de coagulations qui Ont là plupart
des noms particuliers, 6c qu’on ne défigüe ihé-
me prefque jamais par le nom générique de coagulation
, qui a été borné par l’üfagë à quelques ëfpéces
particulières.
Lés coagulations de la première efpecé, ou improprement
dites, font la congélation ou condënfàtion
par le refroidiffement, la concentration oit rapprochement
par le moyen de l’évaporation, la précipitation,
la cryftallifation. Vdye^ C o n g e l l a t io n ,
Ev a po r à t Io n , Pr é c ip it a t io n , & C r y s t a l l i -
SATION.
Les coagulations de la fécondé efpece, celles pour
lefquelles cette dénomination eft confacree, font
premierement la coagulation fpontanée du lait, du
lang, de certains fucs végétaux, par exemple celui
de la bourrache & du cochléaria, &c. i° . celle du
blanç-d’eguf & des autres lymphes animales; paf
C O A
Ün degré de èhaleitr répondant au cent cinqüante-
fixieme du thermomètre de Fahrenheit, félon les
obfervations du doéteur Martine : 30 la coagulation
des matières huileufes par le mélange des acides ;
celle du lait par les acides, par les alkalis, 6c par
les efprits fermentés $ celle des matières mucilagi-
heufes ou farineufes délayées par les*alkalis, &c.
Nous fommes forcés d’avoiier que la théorie de
la coagulation fpontanée du lait, du fang, & des lues
gélatineux des végétaux, eft encore pour nous dans
les ténèbres les plus profondes , & que nous n’en
favons pas davantage fur la coagulationd.es lymphes
animales par le moyen du feu : nous ne pouvons attribuer
cette derniere coagulation à aucune efpece
de diflïpation des parties aqueufes qu’on fuppoferoit
conftituer auparavant leur fluidité, puifqu’au degré '
de chaleur requis cet épaifliffement le fait dans l’eau
aulfi-bien qu’à l’air libre.
La condënfàtion de ces matières par cette caufe,
feft une des exceptions les plus remarquables à cette
loi phyfique prefque générale, par laquelle les degrés
de rareté ou de laxité du tiffu des corps font à-
peu-près proportionnels à leur degré de chaleur.
Quant à la troifieme efpece de nos coagulations
proprement dites, fa voir l’épaiffiffement des matières
huileufes, &c. par les acides, &c. nous pouvons
au moins les ramener par une analogie bien naturelle
à la claffe générale des corporifications qui dépendent
de la combinaifon des différens principes ,
comme des acides avec les différentes baies terreu-
fes ou métalliques, &c. Voye^Mix t io n »
La coagulation du lait par cette caufe ne peut être
cependant que très-difficilement rangée avec ce genre
d’effets ; car on n’apperçoit pas trop comment
quelques gouttes d’acides, quelques grains d’alkalis,
ou une petite quantité d’eljprit-de-vin, peuvent fe
diftribuër affez également & en une proportion
fuffifante dans une grande quantité de lait, pour en
lier les parties au point de leur faire perdre leur
fluidité en fi peu de tems. V oy e fL kn . (b)
COAGULUM, f. m. (Ckirug.) terme confacré
en Chirurgie pour exprimer la partie rouge du fang.
Lorfque le fang circule dans les yaiffeaux ou qu’il
en fort, il paroît compofé de parties homogènes ;
mais fi on le laiffe repofer dans un vafe , on recon-
noît bien-tôt qu’il n’en eft pas ainfi. Le fang reçu
dans une palette fe refroidit, fe coagule, & lëpartage
en deux parties, dont l’une eft un coagulum qu’on
appelle la partie rouge du fang ; l’autre fluide &
blanche , fe nomme la partie lymphatique.
• Mais pourquoi le coagulum du fang tiré dans un
vafe eft-il quelque tems après la faienée d’un rouge
v i f à la furface, & d’un rouge très-foncé au fond du .
vafe ? C’eft parce que les globules de la furface font
non-feuleme’nt moins comprimés, mais encore mêlés
avec de l’humeur blanche &glaireufe qui s’élève
vers la fuperficie du coagulum, qui fe fige avec les
globules, & qui affoiblit leur couleur : c’eft cette
humeur glaireufe qui produit quelquefois fur le fang
que l’on a tiré des coënes blanchâtres, dures, 6c coriaces.
T^oyei C oene.
Le coagulum rouge lavé dans de l’eau tiede, fe
fépare en deux parties, dont l’une fe mêle avec l’autre
à laquelle il communique fa couleur rouge,& l’autre
fe forme en petits filamens blancs : la première eft ce
qu’on appelle proprement le fang, dont on expliquera
la nature en fon lieu. Art. de M . le Chevalier
de Jaucou rt.
COAILLE ou QUOAILLE, f. m. ( Commerce &
Draperie. ) laine groffiere qui fe leve de la queue de
la brebis : ce qui l’a fait appeller ainfi. Voye^ les dict.
de Trèv. & du Comm.
* COALEMUS, f. m. (Myth.) dieu tutelaire de
^ ’imprudence. Les ancienslembloientavoir penfé en
Tome I II.
C O A 555
miiîtipîiarit les dieux, que lès vicês äVöient plus
befoin du fecours des dieux que les vertus*
COALITION , f. f. (Phyfiq.) fe dit quelquefois
de la réunion de plufieurs parties qui avoient été
auparavant fép’arées. Ce mot vient du latin coalef-
cere, s’unir, fe confondre enfemble. Il eft très-peii
en ufage, & devroit y être un peu plus ; car il eft
commode, dérivé du latin , & ne peut guère êtr<$
remplacé que par une périphrafe. (O)
CO ANGO, (Géog. mod.) riviere de l’Afrique
méridionale , qui a fa fource proche des frontières
de Monoemugi.'
CO AN Z A , ( Géog» mod. ) grande riviere d’Afrique
en Ethiopie 3 qui fe jette dans la mer près de
l’île Loanda.
C O A T I , f. m. ( Hiß. nat. Zool. ) ce nom à été
donné à plufieurs elpeces d’animaux quadrupèdes du
Brefil, fi différens les uns des autres, que l’on n’eft
pas encore parvenu à les rapporter à un même genre
: mais quoi qu’il en foitdu genre, il nous (uffiroit dè
bien connoître les efpeces. Celle que l’on appelle
coati-mondi a été décrite par M. Perraut, qui ert
avoit difféqué trois ; la longueur de la tête du plus
grand (Hiß. nat.fig, z . Plan. VI. ) étoit de fix pouces
& demi depuis le bout du mufeau jufqu’à l’occiput
; il avoit feize pouces depuis le derrière de la
tête jufqu’à l’origine de la queue, dont la longueur
étoit de treize pouces : le mufeau reffembloit à celui
du cochon ; mais il étoit plus long, plus étroit,
& plus mobile ; il fe recourboit facilement en-haut.
Cet animal avoit cinq doigts à chaque patte, un
peu plus longs dans les pattes de devant que dans
celles de derrière ; & à chaque doigt un ongle noir,
long, crochu, & creux comme ceux du caftor. Les
pattes de derrière rëffembloient à celles de l’ours ;
mais la plante étoit dégarnie’ de p o il, 6c revêtue
d’une peau douce ; il y avoit derrière le talon des
callofités longues de cinq ou fix lignes : le poil étoit
court, rude, bouchonné, noirâtre fur le dos & fur
quelques endroits de la tête, aux extrémités des
pattes & du mufeau, &c mêlé d’un peu de noir & de
beaucoup de roux fur lereftç du corps, mais plus doré
en quelques endroits du deffous du ventre & de la
gorge. Il y avoit fur la queue plufieurs anneaux, les
uns noirâtres, & les autres mêlés de noii Sc de roux.
La langue étoit un peu fillonnée, &c au refte reffembloit
à-peu-près à celle des chiens. Les yeux étoient
petits comme ceux du cochon, & les oreilles rondes
comme celles des rats : il y avoit au-dehors de
l’oreille un poil court, &c au-dedans un poil plus
long & plus blanchâtre. Les dents canines étoient
gril’es, tranfparentes, & fort longues, fur-tout celles
de la mâchoire inférieure : chaque mâchoire avoit
fix dents incifives : la gueule étoit fort grande, &
la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que
celle d’en-haut, comme dans le cochon. On dit que
le coati-mondi ronge fa queue , de forte qu’on ne
peut pas déterminer au jufte la longueur de cette
partie.
On avoit apporté à M. Perraut deux autres animaux
fous le nom de coati-mondi, mais ils étoient
plus petits, 6c fort différens de celui dont on vienf
de faire mention ; ils n’avoient pas les dents canines
, ni les talons éperonnés par des callofités : l’un
de ces animaux avoit le mufeau fendu comme un
lie vre ; cette partie, le tour des yeux & des oreilles,
étoient dégarnis de p o il, 6c de couleur rouge : les
dents reffembloient à celles du caftor, &c la queue
étoit courte. Il y avoit aux pies de devant cinq
doigts ; les trois du milieu étoient vraiment des
doigts, mais les deux autres étoient placés comme
des pouces à une certaine diftance des doigts, un
de chaque côté ; celui du côté intérieur étoit très-
petit ; il ne fe trouve aux piés de derrière que qua>