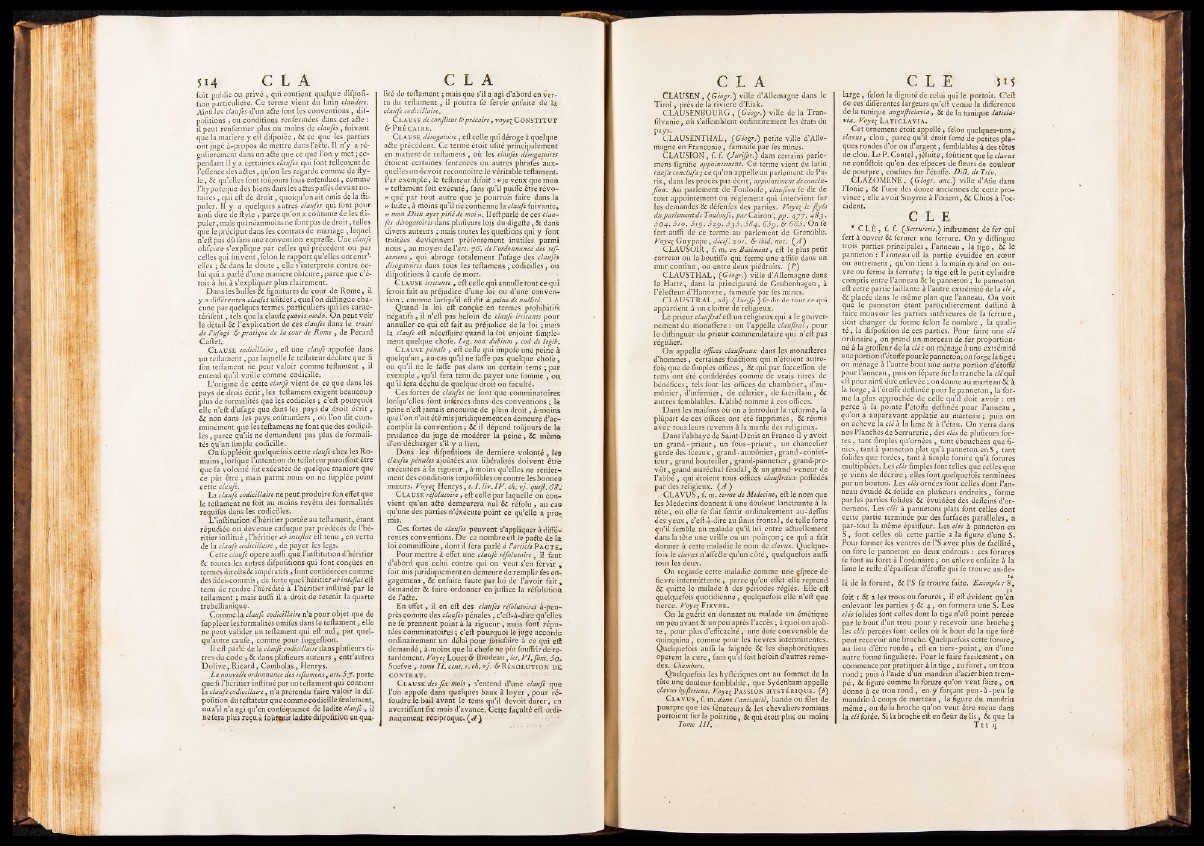
foit public ou privé , qui contient quelque difpofi-
tion particulière. Ce terme vient du latin claudere.
Ainfi les claufes d’un a&e font les conventions , difpofitions
, ou conditions renfermées dans cet afte :
il peut renfermer plus ou moins de claufes, fuivant
que la matière y eft difpofée, & ce que les parties
ont jugé à-propos de mettre dansl’aête. Il n’y a régulièrement
dans un aôe que ce que l’on y met ; cependant
il y a certaines claufes qui font tellement de
l’eflence des aû es , qu’on les regarde comme de fty-
l e , & qu’elles font toujours fous-entendues, comme
l’hypoteque des biens dans les aftespaffés devant notaires
, qui eft de droit, quoiqu’on ait omis de la fti-
puler. Il y a quelques autres claufes qui font pour
ainfi dire de ftyle parce qu’on a coutume de les fti-
puler, mais qui néanmoins ne font pas de droit, telles
que le préciput dans les contrats de mariage , lequel
n’eft pas dû fans une convention expreffe. Une claufe
obfcure s’explique par celles qui précèdent ou par
celles qui fuivent, félon le rapport qu’elles ont entr’-
elles ; & dans le doute, elle s’interprete contre ce^
lui qui a parlé d’une maniéré obfcure, parce que e’é-
toit à lui à s’expliquer plus clairement.
Dans les bulles oc lignatures de cour de Rome, il
y a différentes claufes ufitées, que l’on diftingue chacune
par quelques termes particuliers qui les carac-
térifent, tels que la claufe quovis modo. On peut voir
le détail & l’explication de ees claufes dans le traité
de Puf âge & pratique de la cour de Rome , de Perard
Caftel.
C lause codicillaire , eft une claufe appofée dans
un teftament, par laquelle le teftateur déclare que lï
fon teftament ne peut valoir comme teftament , il
entend qu’il vaille comme codicille.
L ’origine de cttttclaufe. vient de ce que dans les
pays de droit écrit, les teftamens exigent beaucoup
plus de formalités que les codiciles ; c’eft pourquoi
elle n’eft d’ufage que dans les pays de droit éc r it,
& non dans les pays coutumiers , oii l’on dit communément
que les teftamens ne font que des codicilles
, parce qu’ils ne demandent pas plus de formalités
qu’ un ümple codicille.
On fuppléoit quelquefois cette claufe chez les Romains
, lorfque l’intention du teftateur paroifloit être
que fa volonté fût exécutée de quelque maniéré que
ce pût être ; mais parmi nous on ne fupplée point
cette claufe. .
La claufe codicillaire ne peut produire fon effet que
le teftament ne foit au moins revêtu des formalités
requifes dans les codicilles.
L’inftitution d’héritier portée au teftament, étant
répudiée ou devenue caduque par prédécès de l’héritier
inftitué, l’héritier ab intefldt eft tenu , en vertu
de la claufe codicillaire, de payer les legs.
Cette claufe opéré aufli que l’inftitution d’héritier
& toutes les autres difpofitions qui font conçûes en
termes dire&s & impératifs , font confidérées comme
des fidefcommis, de forte que l’héritier ab intefiat eft
tenu de rendre l’hérédité à l ’héritier inftitué par le
teftament ; mais aufli il a, droit de retenir la quarte
trebellianique.
Comme .la. claufe codicillaire n’a pour objet que de
fuppiéer les formalités omifes dans le teftament, elle
ne peut valider un teftament qui eft nul, par quel-
qu’autte caufe, comme pour fuggeftion.
Il eft parlé de la claufe codicillaire dans plufieurs titres
du code , & dans plufieurs auteurs , entr’autres
D o liv e , Ricard, Cambolas, Henrys.
La nouvelle ordonnance des tefamens, art. 5y . porte
que fi l’héritier inftitué par un teftament qui contient
la claiife codicillaire, n’a prétendu faire valoir la dif-
pofition du teftateur que comme codicille feulement,
ou s’il n’a agi qu’en conféquence de ladite claufe , il
ne fera plus reçu à foûtexur ladite difpofition en qualité
de teftament ; mais que s’il a agi d’abord en vertu
du teftament, il pourra fe fervir enfuite de la
claufe codicillaire.
CLAUSE de confitut & précaire , voye^ CONSTITUT
& Pr é c a ir e .
C lause dérogatoire, eft celle qui déroge à quelque
aâ e précédent. Ce terme étoit ufité principalement
en matière de teftamens, où les claufes dérogatoires
étoient certaines fentences ou autres phrafes auxquelles
on devoit reconnoître le véritable teftament.
Par exemple, le teftateur difoit : «je veux que mon
» teftament foit exécuté, fans qu’il puifle être révo-
» qué par tout autre que je pourrois faire dans la
» lùite, à moins qu’il ne contienne la claufe fui vante,
» mon Dieu aye^pitié de moi ». Il eft parlé de ces claufes
dérogatoires dans plufieurs lois du digefte, & dans
divers auteurs ; mais toutes les queftions qui y font
traitées deviennent préfentement inutiles parmi
nous , au moyen de Yart. y S. de l'ordonnance des teftamens
, qui abroge totalement l’ufage des claufes
dérogatoires dans tous les teftamens , codicilles, ou
difpofitions à caufe de mort.
C lause irritante t eft celle qui annulle tout cequi
feroit fait au préjudice d’une loi ou d’une convention
, comme lorfqu’il eft dit à peine de nullité.
Quand la loi eft conçûe en termes prohibitifs
négatifs , il n’eft pas befoin de claufe irritante pour
annuller ce qui eft fait au préjudice de la loi ;mais
la claufe eft néceflaire quand la loi enjoint Amplement
quelque chofe. Leg. non dubiurn , cod de legitr.
C lause pénale , eft celle qui impofe une peine à
quelqu’un, au*cas qu’il ne faflé pas quelque chofe ,
ou qu’il ne le fafle pas dans un certain tems ; par
exemple, qu’il fera tenu de payer une fomme , ou
qu’il fera déchu de quelque droit ou faculté.
Ces fortes de claufes ne font que comminatoires"
lorfqu’elles font inférées dans des conventions ; la
peine n’eft jamais encourue de plein d roit, à-moins
que l’on n’ait été mis juridiquement en demeure d’accomplir
la convention ; & il dépend toûjours de la
prudence du juge de modérer la peine, & mémo
d’en décharger s’il y a lieu.
Dans les difpofitions de derniere volonté, le9
claufes pénales ajoûtées aux libéralités doivent être
exécutées à la rigueur , à-moins qu’elles ne renfer-;
ment des conditions impoflîblesou contre les bonnes*
moeurs. Voye^ Henrys, 1.1. liv. IV . ch. vj. queft. 68J
C lause réfolutoire, eft celle par laquelle on convient
qu’un aâ e demeurera nul & réfolu , au cas»
qu’une des parties n’éxécute point ce qu’elle à promis.
Ces fortes de claufes peuvent s’appliquer à différentes
conventions. De ce nombre eft le pafte de là
loi commiffoire, dont il fera parlé à C article Pa ct es
Pour mettre à effet une claufe réfolutoire , il faut
d’abord que celui contre qui on veut s’en fervir ,!
foit mis juridiquement en demeure de remplir fes eiï-
gagemens, & enfuite faute par lui de l’avoir fait ',
demander & faire ordonner en juftice la réfolutioa
de l’afte.
En effet, il en eft des claufes r é fo lu toir e à-peu-
près comme des claufes pénales , c’eft-à-dire qu’elleS
ne fe prennent point à là rigueur , mais font réputées
comminatoires ; c’eft pourquoi le jugé accordé
ordinairement un délai pOur fatisfaire à ce qui eft
demandé, à-moins que la chofe ne pût fouffrir de re-]
tardement< V o y t {L o \ iQ t& Brodeau, let. VI,fo n t . 5o-
rSoefve , tome I I . cent. r. ch. vj. & R É SO LU T IO N DE
CO N T R A T .
.Clause desJixmois, s’entend d’une' claufe que
l’on appofe dans quelques baux à loyer ,-pour réfoudre
le bail avant .le tems qu’il devoit durer, en
avertiffant fix mois d’avance. Cette faculté eft ordinairement
-réciproque. ( A )
CLAÜSEN, (Géogr.) ville d’Allemagne dans le
T iro l, près dè la rivière d’Èiak.
CLAUSENBOURG, ([Géogr.) ville de la Tran-
filvanie, où s’affemblent ordinairement les états du
pays. f
CLAUSENTHAL j (Géogr.) petite ville d’Allemagne
en Franconie, fameufe par fes mines.
CLAUSION, f. f. ( Jurifpr.) dans certains parle-
mens lignifie appointements Ce terme vient du latin .
caufa conclufa; ce qu’on appelle au parlement de Paris
, dans les procès par écrit, appointement de conclu-
Jîon. Au parlement de Touloufe, claufion fe dit de
tout appointement ou réglement qui intervient fur
les demandes & défenfes des parties. Voye%_ le fiyle
du parlement de Touloufe, par Cairon, pp. 477« 483 •
604. 5to. 5iÿ. Jzc)\ J3J. 584. 6 S f. & 665. On fe
fert aufli de ce terme au parlement de Grenoble.
Voye^ G uypape, décif. 20t. & ibid, not. (^4)
CLAUSOIR, f. m. en Bâtiment, eft le plus petit
carreau ou la boutiffe qui ferme une aflife dans un
mur continu, ou entre deux piédroits. (P )
CLAUSTHAL, (Géogr.) ville d’Allemagne dans
le Hartz, dans la principauté de Grubenhagen, à
l’éleâeur d’Hanovre, fameufe par fes mines.
CLAUSTRAL, adj, (Jurifp.) fe dit de tout ce qui
appartient à un cloître de religieux.
Le prieur clauftral eft un religieux qui a le gouvernement
du monaftere : on l’appelle clauftral > pour
le diftinguer du prieur commendataire qui n’eft pas
régulier.
On appelle offices claujtraux dans les monafteres
d’hommes, certaines fonctions qui n’étoient autrefois
que de fimples offices, & qui par fucceffion de
tems ont été confidérées comme de vrais titres de
bénéfices ; tels font les offices de chambrier, d’aumônier,
d’infirmier, de célerier, de facriftain , ôc
autres femblables. L’abbé nomme à ces offices.
Dans les maifons où on a introduit la réforme, la
plupart de ces offices ont été fupprimés , & réunis
avec tous leurs revenus à la manfe des religieux.
Dans l’abbayé de Saint-Denis en France il y avoit
un grand-prieur, un fous-prieur, un chancelier
garde des fceaux, grand-aumônier, grand-confef-
l'eur, grand bouteiller, grand-pannetier, grand-pre-
v ô t , grand maréchal féodal, & un grand-veneur de
l’abbe , qui étoient tous offices claujtraux poffédés
par des religieux, (-d )
CLAVUS, f. m. terme de Medecine, eft le nom que
les Médecins donnent à une douleur lancinante à la
tête , où elle fe fait fentir ordinairement au-deflùs
des y e u x , c’eft-à-dire au finus frontal, de telle forte
qu’il femble au malade qu’il lui entre aftuellement
dans la tête une vrille ou un poinçon ; ce qui a fait
donner à cette maladie le nom de clavus. Quelquefois
le clavus n’affeâe qu’un côté, quelquefois aufli
tous les deux.
On regarde cette maladie comme une efpece de
fievre intermittente, parce qu’en effet elle reprend
& quitte le malade à des périodes réglés. Elle eft
quelquefois quotidienne, quelquefois elle n’eft que
tierce. Voye{ Fievre.
On la guérit en donnant au malade un émétique
un peu avant & un peu après l’accès ; à quoi on ajoute
, pour plus d’efficacité, une dofe convenable de
quinquina, comme pour les fievres intermittentes.
Quelquefois aufli la faignée & les diaphorétiques
opèrent la cure, fans qu’il foit befoin d’autres reme-
des. Chambers.
Quelquefois les hyftériquês ont au fommet de la
tête une douleur femblable, que Sydenham appelle
clavus hyflericus. Voye{ PASSION HYSTÉRIQUE, (b)
C lavus , f. m. dans T antiquitéf bande ou filet de
pourpre que les fénateurs & les chevaliers romains
portoient fur la poitrine, & qui étoit plus ou moins
, Tome I I I , -
large, félon la dignité dé celui qui ié portoit; C ’eft
de ces différentes largeurs qu’eft venue la différence
de la tunique augufticlavia, & de la tunique laticla*
via. Voyei LATICLAVIA.
Cet ornement étoit appelle ) félon qùelquesMins*
clavus y clou, parce qu’il étoit femé de petites pla-*
ques rondes d’or ou d’argent, femblables à des tête*
de clou. Le P. Cantel, jéfuite, foutient que le clavus
ne eonfiftoit qu’en des efpeces de fleurs de couleur
de pourpre, coufues fur l’étoffe. D i cl. de Trévt
CLAZOMENE, (Géogr. anc.) ville d’Afie dans
l’Ionie , & l’une des douze anciennes de cette pro-*
vince ; elle avoit Smyrne à l’orient, ôc Chios à l’oe-*
cident.
C L E
* C L É , f. f. (Serrurerie.') infiniment de fer qui
fert à ouvrir & fermer une. ferrure. On y diftingue
trois parties principales , l’anneau , la tige , & le
panneton : l’anneau eft la partie évuidée en coeur
ou autrement, qu’on tient à la main quand on ouvre
ou ferme la ferrure ; la tige eft le pètit cylindre
compris entre l’anneau & le panneton ; le panneton
eft cette partie Taillante à l’autre extrémité de la clé ,
& placée dans le même plan que l’anneau. On voit
que le panneton étant particulièrement deftiné à
faire mouvoir les parties intérieures de la ferrure ,
doit changer de forme fél'on le nombre , la qualité
, la difpofition de ees parties. Pour faire une clé
ordinaire, on prend ,un morceau de fer proportion-?
né à la groffeur de la clé: on ménage à une extrémité
une portion d’étoffe pour lepanneton; ori forge la tige :
on, ménage à l’autre bout une autre portion d’étoffe
pour l’anneau, puis on fépare fur la tranche la clé qui
eft pour ainfi dire enlevée ; on donne au marteau & à
la forge, à l’étoffe deftinée pour le panneton, la forme
la plus approchée de celle qu’il doit avoir : on
perce à la pointe l’étoffe deftinée pour l’anneau,
qu’on a auparavant applatie au marteau ; puis on
on achevé la clé à la lime & à l’étau. On verra dans
nos Planches de Serrurerie, des clés de plufieurs for-,
te s , tant fimples qu’ornées , tant ébauchées que finies,
tant à panneton plat qu’à panneton en S , tant
folides que forées, tant à Ample forure qu’à forures
multipliées. Les clés fimples font telles que celles que
je viens de décrire ; elles font quelquefois terminées
par un bouton. Les clés ornées font celles dont l ’anneau
évuidé & folide en plufieurs endroits, forme
par les parties folides & évuidées des deffeins d’or-
nemens. Les clés à pannetons plats font celles dont
cette partie terminée par des furfaces parallèles, a
par-tout la même épaiffeur. Les clés à panneton en
S , font celles où cette partie a la figure d’une S*
Pour former les ventres de l’S avec plus de facilité ,
on fore le panneton en deux endroits : ces forure9
fe font au foret à l’ordinaire ; on çffleve enfuite à la
lime le refte d’épaiffeur d’etoffe qui fe trouve au-de-
14
là de la forure, & l’S fe trouve faite. Exemple : 8,
foit 1 & 2 les trous ou forures, il eft évident qu’en
enlevant les parties 3 & 4 , on formera une S. Les
clés folides font celles dont la tige n’eft point percée
par le bout d’un trou pour y recevoir une broche ;
les clés percées font celles où le bout de la tige foré
peut recevoir une broche. Quelquefois cette forure ,
au lieu d’être ronde, eft en tiers - point, ou d’une
autre forme finguliere. Pour le faire facilement, on
commence par pratiquer à la tige, au foret, un trou
rond ; puis à l’aide d’un, mandrin d’acier bien trempé
, & figuré comme la forure qu’on veut faire, on
donne à ce trou rond , en y forçant peu-à-peu le
mandrin à coups de marteau , la figure du mandrin
même, ou de la broche qu’bn veut être reçue darts
la clé forée. Si la broche eft en fleur de lis , & que U
T 1 1 ij