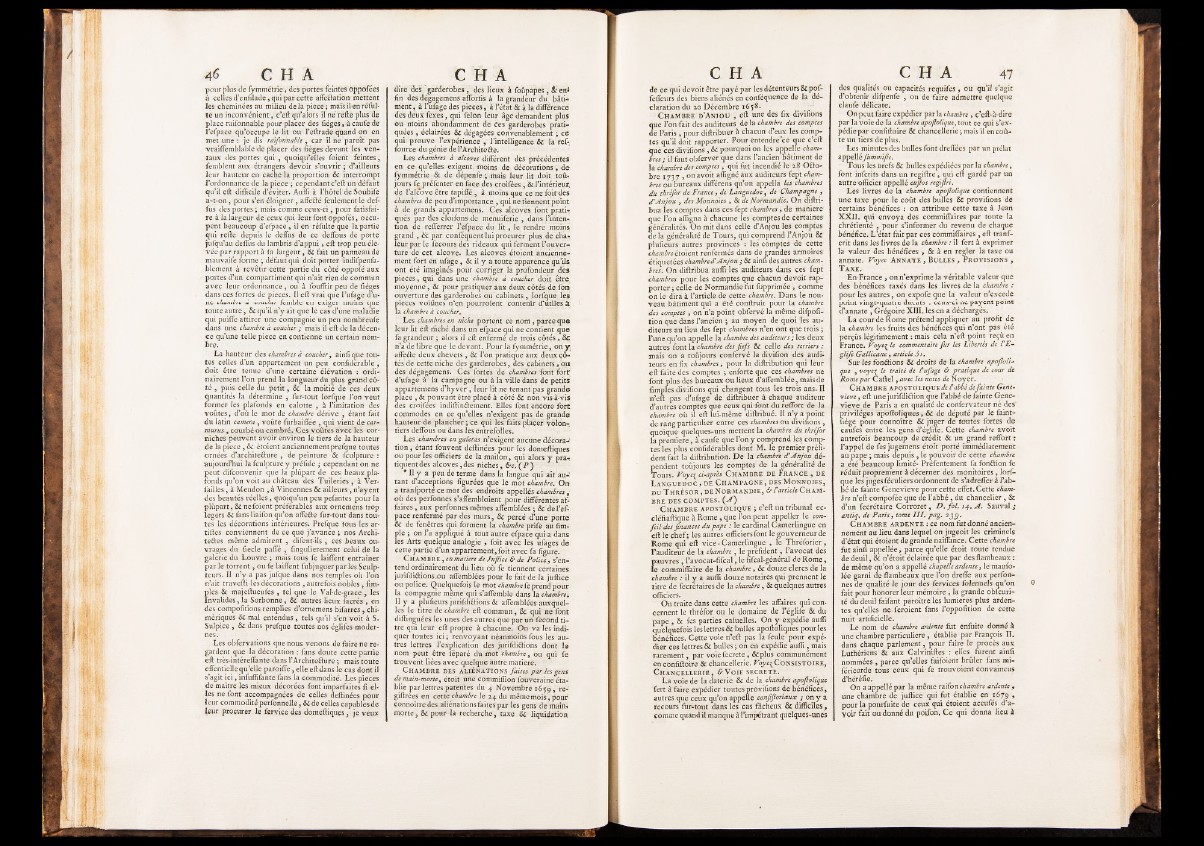
pour plus de fymmétrie, des portes feintes oppofées
à celles d’enfilade, qui par cette affectation mettent
les cheminées an milieu delà pièce; maïsilenréful-
le vin inconvénient-, c’eft qu’alors il ne relie pliis de
place raifonnable pour placer des lièges, à caufe de
l’efpace qu’occupe le lit ou l’ellrade quand on en
met une : je dis raifonnable, Car il ne paroît pas
vraiffemblable de placer des fiéges devant les vert-
taux des portes qui , quoiqifelles foierit feintes;
femblent aux étrangers devoir s’ouvrir ; d’ailleurs
leur hauteur en cache la proportion & interrompt
l’ordonnance de la piece ; cependant c’ell un défaut
qu’il ell difficile d’éviter. Audi à l’hôtel de Soubife
a-t-on, pour s’en éloigner, affeCté feulement le def-
fus des portes ; mais comme ceux-ci, pour fatisfai-
re à la largeur de ceux qui leur font oppofés, occupent
beaucoup d’efpaee , il en réfulté que la partie
qui relie depuis le deffus de ce delfous de porte
jufqu’au deffus du lambris d’appui > ell trop peu élevée
par rapport à la largeur, & fait un panneau de
mauvaife forme ; défaut qui doit porter indifpenfa-
blement à revêtir cette partie du côté oppofé aux
portes d’un compartiment qui n’ait rien de commun
avec leur ordonnance, ou à fouffrir peu de lièges
dans ces fortes de pièces. Il ell vrai que l ’ufage d’une
chambre à coucher femble en exiger moins que
toute autre, & qu’il n’y ait que le cas d’une maladie
qui puiffe attirer une compagnie un peu nombreufe
dans une chambre à coucher ; mais il ell de la décence
qu’une telle piece en contienne un certain nombre
.L
a hauteur dès chambres à coucher, ainfi que toutes
celles d’un appartement un peu eonfidérable ,
doit être tenue d’une certaine élévation : ordinairement
l’on prend la longueur du plus grand côté
, puis celle du petit, & la moitié de ces deux
quantités la détermine , fur-tout lorfque l’on veut
former les plafonds en calotte , à l’imitation des
voûtes, d’où le mot de chambre dérive , étant fait
du latin camera, voûte furbaiffée , qui vient de car-
mur us , courbé ou cambré. Ces voûtes avec les corniches
peuvent avoir environ le tiers de la hauteur
de la piece, ôc étoient anciennement prefque toutes
ornées d’architeûure , de peinture & fculpture :
aujourd’hui la fculpture y préfide ; cependant on ne
peut difconvenir que la plupart de ces beaux plafonds
qu’on voit au château des Tuileries , à Ver-
failles , à Meudon , à Vincennes & ailleurs, n’ayent
des beautés réelles, quoiqu’un peu pefantes pour la
plûpart, & nefoient préférables aux ornemens trop
legers ôc fans liaifon qu’on affeCte fur-tout dans toutes
les décorations intérieures. Prefque tous les ar-
tiftes conviennent de ce que j’avance ; nos Architectes
même admirent , difent-ils , ces beaux ouvrages
du fiecle paffé , fingulierement celui de la
galerie du Louvre ; mais tous fe laiffent entraîner
par le torrent, ou fe laiffent fubjuguer par les Sculpteurs.
Il n’y a pas jufque dans nos temples où l’on
n’ait travefti les décorations, autrefois nobles, Amples
& majeftueufes , tel que le Val-de-grace, les
Invalides, la Sorbonne, & autres lieux facrés , en
des compofitions remplies d’ornemens bifarres , chimériques
& mal entendus , tels qu’il s’en voit à S.
Sulpice, & dans prefque toutes nos églifes modernes.
Les obfervations que nous venons de faire ne regardent
que la décoration : fans doute cette partie
ell très-intéreffante dans l’Architecture ; mais toute
effentielle qu’elle paroiffe, elle eft dans le cas dont il
s’agit i c i , infuffifante fans la commodité. Les pièces
de maître les mieux décorées font imparfaites fi elles
ne font accompagnées de celles dellinées pour
leur commodité perfonnelle, & de celles capables de
leur procurer le fervice des domeftiquçs,• je veux
dire des garderobes, des lieux à foûpapes, & eni
fin des dégagemens affortis à la grandeur du bâti-»
ment, à l’ufage des pièces, à l’état & à la différence
des deux fexes, qui félon leur âge demandent plus
ou moins abondamment de Ces garderobes pratiquées
, éclairées & dégagées convenablement ; ce
qui prouve l’expérience , l ’intelligence & la ref-
fource du génie de l’ArchiteCte.
Les chambres à alcôves différent des précédentes
en ce. qu’elles exigent, moins de décorations , de
fymmétrie & de dépenfe.; mais leur lit doit toû-
jours fe préfenter en face des croifées, &.l’intérieur,
de l’alcove être tapiffé , à moins que ce ne foit des
chambres de peu d’importance , qui ne tiennent ppint
à de grands appartemens. Ces alcôves font pratiqués
par des cloifons de menuiferie , dans l’intention
de refferrer l’efpâce du l i t , le rendre moins
grand , & par conféquent lui procurer plus de chaleur
par le fecours des rideaux qui ferment l’ouverture
de cet, alcôve. Les alcôves étoient anciennement
fort en ufage, & il y a toute apparence qu’ils
ont été imaginés pour corriger la profondeur des
pièces, qui dans une chambre à coucher,'doit être
moyenne, & pour pratiquer aux deux côtés de fou
ouverture des garderobes ôu cabinets, lorfque les
pièces voifines n’en ppurroient contenir d’utiles ât
la chambre à 'coucher.
Les chambres en niche portent ce nom , parce que
leur lit eft niché dans un efpace qui ne contient que
fa grandeur ; alors il’ eft enfermé de trois côtés, &C
n’a de libre que le devant. Pour la fymmétrie, on y
affeCle deux chevets , & l’on pratique aux deux cotés
de cette niche des garderobes, des cabinets, ou
des dégagemens. Ces fortes de chambres font fort
d’ufage k' la campagne ou à la ville dans de petits
appartemens d’hy ver , leur lit ne tenant pas grande
place , & pouvant être placé à côté ôc non vis-à-vis
des croifées indiftin&èment. Elles font encore fort
cpmmodes en ce qu’elles n’exigent pas de grande
hauteur de plancher ; ce qui les faits placer volontiers
deffous ou dans les entrefolles.
Les chambres en galetas n’exigent aucune décora-'
tion, étant fouvent deftinées pour les domeftiques
ou pour les officiers de la mailon, qui alors y pratiquent
des alcôves, des niches, &c. ( P )
* Il y a peu de terme dans la langue qüi 'ait autant
d’acceptions figurées que le mot chambre. On
a tranfporté ce mot des endroits appellés chambres ,
où des perfonnes s’affembloient pour différentes affaires
, aux perfonnes mêmes affemblées ; & del’êf-
pace renfermé par des murs , & percé d’une porté
& de fenêtres qui forment la chambre prife au fim-
ple ; on l’a appliqué à tout autre efpace qui a dans
les Arts quelque analogie , foit avec les ufages de
cette partie d’un appartement, foit avec fa figure.
CHAMBRE, en matière de Jùfiice & de Police;, s’entend
ordinairement du lieu où fe tiennent certaines
jurifdiélionsjou affemblées pour le fait de la juftice
ou police. Quelquefois le mot chambre fe prend pour
la compagnie même qui s’affemble dans la chambre.
Il y a plufieurs jurifdiÔions & affemblées auxquelles
le titre de chambre eft commun, & qui ne font
diftinguées les unes des autres que par un-fècônd titre
qui leur eft propre à chacune. On va les indiquer
toutes ici ; renvoyant néanmoins fous les autres
lettres l’explication des jurifdiétions dont le
nom peut être féparé du mot chambre, ou qui fe
trouvent liées avec quelque autre matière.
C hambre des alién at io ns faites parles gens
de main-morte, étoit une commiffion foüveraine établie
par lettres patentés du 4 Novembre 1659,: re-
giftrées en cette chambre le 24 du même mois, pour
connoître des aliénations faites par les gens de main,
morte, & pour: la recherche, taxeIôc liquidation
de ce qui de voit être payé par les détenteurs & pof-
feffeurs des biens aliénés en conféquence de la déclaration
du 20 Décembre 1658.
C hambre d’Anjou , eft une des fix divifions
que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes
dé Paris ; pour diftribuer à chacun d’eux les comptes
qu’il doit rapporter. Pour entendre'ce que c’eft
que ces divifions, & pourquoi on les appelle chambres;
il faut obferver que dans l’ancien bâtiment de
la chambre des comptes, qui fut incendié le- 28 G£to-
bre 1737 , on a voit aflignéàux auditeurs chambres
ou bureaux différens qu’on appellà les chambres
du thréfor de France, de Languedoc, de Champagne ,
d’Anjou , des Monnoics , & de Normandie. On diftri-
bua les comptes dans ces fept chambres ; de maniéré
que l’on affigna à chacune les comptes de certaines
généralités. On mit dans celle d’Anjou les comptes
de la généralité de Tours, qui comprend l’Anjou &
plufieurs autres provinces : les comptes de cette
chambre étoient renfermés dans de grandes armoires
étiquetées chambre £ Anjou ; & ainfi des autres chambres,
On diftribua auffi les auditeurs dans ces fept
chambres pour les comptes que chacun devoit rapporter
; celle de Normandie fut fu’pprimée, comme
on le dira à l’article de cette chambre. Dans le nouveau
bâtiment qui a été çonftruit pour la chambre
des comptes ; on n’a point obfervé la même difpofi-
tion que dans l’ancien ; au moyen de quoi les auditeurs
au lieu des fept chambres n’en ont que trois ;
l ’une.qu’on appelle la chambre des auditeurs ; les deux
autres font la ckambre des fiefs & celle des terriers :
mais on a toûjours confervé la divifion des auditeurs
en fix chambres, pour la diftribution qui leur
eft faite des comptes ; enforte que ces chambres ne
font plus des bureaux ou lieux d’affemblée, mais de
Amples divifions qui changent tous les trois ans. Il
n’eft pas d’ufage de diftribuer à chaque auditeur
d’autres comptes que ceux qui font dureffort de la
chambre où il eft lui-même diftribué. Il n’y a point
de rang particulier entre ces chambres ou d ivifions,
quoique quelques-uns mettent h, chambre du thréfor
la première, à caufe que l’on y comprend les comptes
les plus confidérables dont M. le premier président
fait la diftribution. De la chambre d’Anjou dépendent
toûjours les comptes de la généralité de
Tours. Foye{ ci-aprïs C hambre de Franc e , de
L a n g u e d o c , de C h am p a g n e , d e sMonnoies,
du T hrésor , de No rm an d ie, & tarticle C h am bre
des COMPTES. { A )
C h ambre a po sto l iq u e ; ç’ eft un tribunal ec-
cléfiaftique à Rome , que l’on peut appeller le con-
feil-des finances du pape : le cardinal Camerlingue en
eft le chef; les autres officiers font le gouverneur de
Rome qui eft vice - Camerlingue , le Thréforier,
l ’auditeur de la chambre , le préfident, l’avocat des
pauvres , l’avocat-fifcal, le fifcal-général de R ome,
le commiffaire de la chambre, & douze clercs de la
chambre : il y a aufli douze notaires qui prennent le
titre de fecrétaires de la chambre, & quelques autres
officiers.
On traite dans cette chambre les affaires qui concernent
le thréfor ou le domaine de l’églile & du
pape , & fes parties cafuelles. On y expédie aufli
quelquefois les lettres & bulles apoftoliques pour les
bénéfices. Cette voie n’eft pas la feule pour expédier
ces lettres & bulles ; on en expédie aufli, mais
rarement, par voiefecrete, &plus communément
enconfiftoire & chancellerie. Voye^ C o n sisto ire,
C h an c e l le r ie , 6* V oie secrete.
La voie de la daterie & de la chambre apofiolique
fert à faire expédier toutes provifions de bénéfices,
autres que ceux qu’on appelle confijloriaux ; on y a
recours fur-tout dans les cas fâcheux & difficiles ,
comme quand il manque à l’impétrant quelques-unes
des qualités ou capacités requifes, ou qu’il s’agit
d’obtenir difpenfe , ou de faire admettre quelque
claufe délicate.
On peut faire expédier parla chambre , c*eft-à-dire
par la voie de la chambre apojlolique> tout ce qui s’expédie
par confiftoire & chancellerie ; mais il en coûte
un tiers de plus.
Les minutes des bulles font dreffées par un prélat
appellé fummifle.
' Tous les brefs & bulles expédiées par la ckambre,
font infcrits dans un regiftre, qui eft gardé par un
autre officier appellé cûfios regijlri.
Les livres de la chambre apofiolique contiennent
une taxe pour le coût des bulles & provifions de
certains bénéfices : on attribue cette taxe à Jean
XXII. qui envoya des commiffaires par toute la
chrétienté , pour s’informer du revenu de chaque
bénéfice. L ’état fait par ces commiffaires , eft tranf-
crit dans les livres de la chambre : il fert à exprimer
la valeur des bénéfices , & à en regler la taxe ou
annate. Voyec An n at e , Bulles , Pro v is io n s ,
T a x e .
En France, on n’èxprime la véritable valeur que
des bénéfices taxés dans les livres de la chambre t
pour les autres, on expofe que la valeur n’excede
point vingt-quatre ducats : ceux-ci ne payent point
d’annate , Grégoire XIII. les en a déchargés.
La cour de Rome prétend appliquer au profit de
la chambre les fruits des bénéfices qui n’ont pas été
perçûs légitimement : mais cela n’eft point reçû en
France. Voyeq_ le commentaire fur les Libertés de l’E-
glife Gallicane , article 5t.
Sur les fonctions & droits de la chambre apofiolique
, voye^ le traité de Cufage & pratique de cour de
Rome par C a ftel, avec les notes de N oyer.
CHAMBRE a po s to l iq u e^ Vabbédefainte Geneviève
, eft une jurifdiâion que l’abbé de fainte Geneviève
de Paris a en qualité de confervateur né des
privilèges apoftoliques, & de député par le faint-
liége pour connoître & juger de toutes fortes de
caufes entre les gens d’églife. Cette chambre avoit
autrefois beaucoup de crédit & un grand reffort :
l’appel de fes jugemens étoit porté immédiatement
au pape ; mais depuis , le pouvoir de cette ckambre
a ,été beaucoup limité- Préfentement fa fonôion fe
réduit proprement à décerner des monitoires, lorfque
les juges féculiers ordonnent de s’adreffer à l’abbé
de fainte G enevieve pour cette effet. Cettè chambre
n’eft compofée que de l’abbé, du chancelier , &
d’un fecrétaire Corroret, D . fol. 14. A . Sauvai ;
antiq, de Paris, tome I I I . pag. 2jc).
C hambre ardente : ce nom fut donné anciennement
au lieu dans lequel on jugeoit les criminels
d’état qui étoient de grande naiffance. Cette chambre
fut ainfi appellée, parce qu’elle étoit toute tendue
de deuil, & n’étoit éclairée que par des flambeaux :
de même qu’on a appellé chapelle ardente, lemaufo-
lée garni de flambeaux que l’on dreffe aux perfonnes
de qualité le jour des fervices folennels qu’on O
fait pour honorer leur mémoire , la grande obfcuri-
té du deuil faifant paraître les lumières plus ardentes
qu’elles ne feroient fans l’oppofition de cette
nuit artificielle.
Le nom de chambre ardente fut enfuite donné à
une chambre particulière, établie par François II.
dans chaque parlement, pour faire le procès aux
Luthériens & aux Calviniftes : elles forent ainfi
nommées , parce qu’elles faifoient brûler fans mi-
férieorde tous ceux qui fe trouvoient convaincus
d’héréfie.
On a appellé par la même raifon chambre ardente ,
une chambre de juftice qui fot établie en 1679 ,
pour la pourfuite de ceux qui étoient accufes d’a-
yoir fait ou donné du poifon. Ce qui donna lieu à