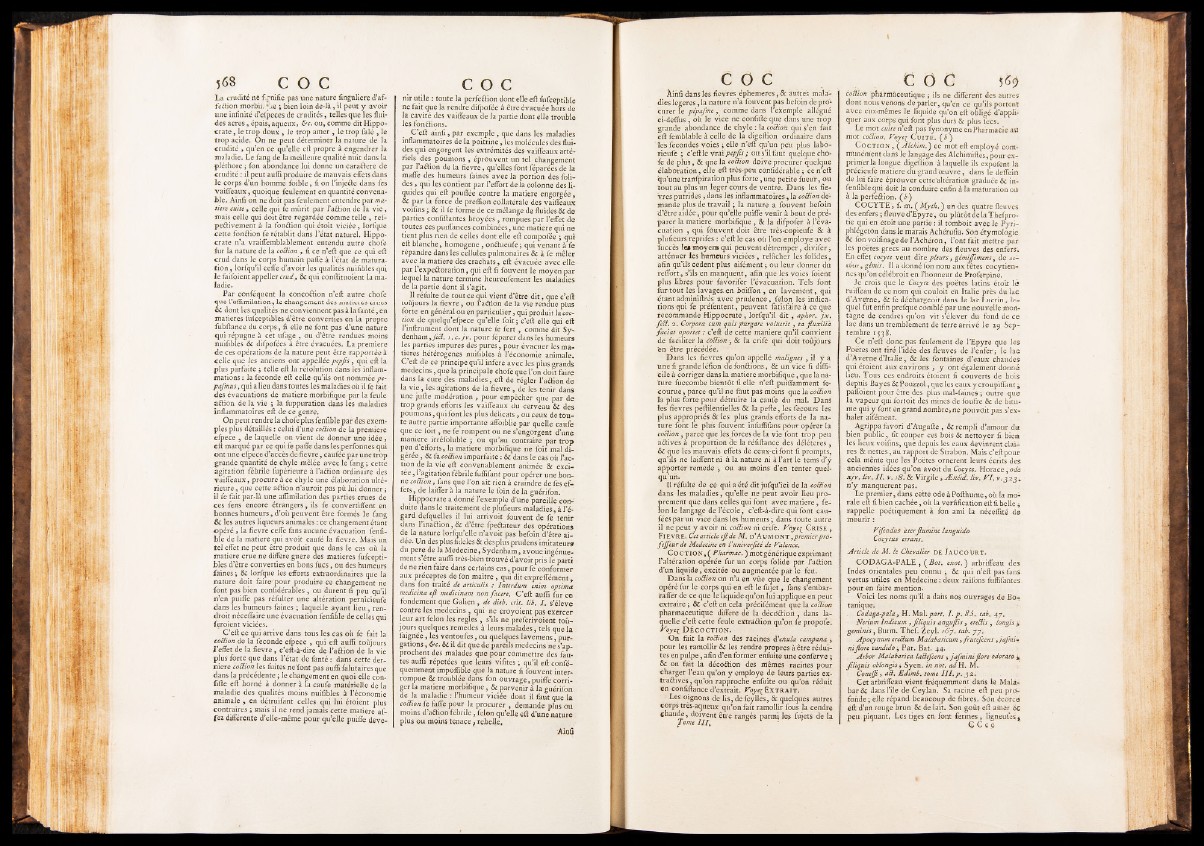
La crudité ne f.rnifie pas une nature finguliere d’af-
fe&ion morbifique ; bien loin de-là, il peut y avoir
une infinité d’efpeces de crudités, telles que les fluides
acres, épais, aqueux, &c. ou, comme dit Hippocrate
, le trop dou x, le trop amer , le trop falé , le
trop acide. On ne peut déterminer la nature de la
crudité , qu’en ce qu’elle eft propre à engendrer la
maladie. Le fang de la meilleure qualité nuit dans la
pléthore ; fon abondance lui donne un cara&ere de
crudité : il peut aufli produire de mauvais effets dans
le corps d’un homme foible, fi on l’inje&e dans fes
vaiffeaux, quoique feulement en quantité convenable.
Ainfi on ne doit pas feulement entendre par matière
cuite, celle qui fe mûrit par l’aûion de la v ie ,
mais celle qui doit être regardée comme telle , ref-
pe&ivement à la fonéfion qui étoit viciée, lorfque
cette fon&ion fe rétablit dans l ’état naturel. Hippocrate
n’a vraiffemblablement entendu autre chofe
fur la nature de la coBion , fi ce n’eft que ce qui eft
crud dans le corps humain paffe à l’état de maturation
, lorfqu’il celle d’avoir les qualités nuifibles qui
le faifoient appeller crud, 6c qui conftituoient la maladie.
Par conféquent la concoftion n’eft autre chofe
que l’affimilation, le changement des matières crues
6c dont les qualités ne conviennent pas à lafanté, en
matières fufceptibles d’être converties en la propre
fubftance du corps, fi elle ne font pas d’une nature
qui répugne à cet ufage , ou d’être rendues moins
nuifibles 6c difpofées à être évacuées. La première
de ces opérations de la nature peut être rapportée à
celle que les anciens ont appellée pepjîs, qui eft la
plus parfaite ; telle eft la réfolution dans les inflammations
: la fécondé eft celle qu’ils ont nommée pe-
pafmus, qui a lieu dans toutes les maladies où il fe fait
des évacuations de matière morbifique par la feule
aûion de la vie ; la fuppuration dans les maladies
inflammatoires eft de ce genre.
On peut rendre la chofe plus fenfible par des exemples
plus détaillés : celui d’une coction de la première
efpece , de laquelle on vient de donner une idée,
eft marqué par ce qui fe paffe dans les perfonnes qui
ont une efpece d’accès de fievre, caufée par une trop
grande quantité de chyle mêlée avec le fang ; cette
agitation fébrile fupérieure à l’a&ion ordinaire des
vaiffeaux, procure à ce chyle une élaboration ultérieure
, que cette aélion n’auroit pas pû lui donner ;
il fe fait par-là une aflimilation des parties crues de
ces fens encore étrangers, ils fe convertiffent en
bonnes humeurs, d’où peuvent être formés le fang
& les autres liqueurs animales : ce changement étant
op é ré , la fievre ceffe fans aucune évacuation fenfible
de la matière qui avoit caufé la fievre. Mais un
tel effet ne peut être produit que dans le cas où la
matière crue ne différé guere des matières fufceptibles
d’être converties en bons fucs, ou des humeurs
faines ; 6c lorfque les efforts extraordinaires que la
nature doit faire'pour produire ce changement ne
font pas bien confidérables , ou durent fi peu qu’il
n’en puiffe pas réfulter une altération pernicieufe
dans les humeurs faines ; laquelle ayant lieu , rendrait
néceffaire une évacuation fenfible de celles qui
feraient viciées.
C ’eft ce qui arrive dans tous les cas où fe fait la
coBion de la fécondé efpece , qui eft aufli toujours
J’effet de la fievre, c’eft-à-dire de l’a&ion de la vie
plus forte que dans l’état de fanté : dans cette dernière
coBion les fuites ne'font pas aufli falutaires que
dans la précédente ; le changement en quoi elle con-
fifte eft borné à donner à la caufe matérielle de la
maladie des qualités moins nuifibles à l’économie
animale , en détruifant celles qui lui étoient plus
contraires ; mais il ne rend jamais cette matière af-
fez différente d’elle-même pour qu’elle puiffe devenir
utile : toute la perfeôion dont elle eft fufceptible
ne fait que la rendre difpofée à être évacuée hors de
la cavité des vaiffeaux de la partie dont elle trouble
les fondions. .
C ’eft ainfi, par exemple, que dans les maladies
inflammatoires de la poitrine, les molécules des fluides
qui engorgent les extrémités des vaiffeaux artériels
des poumons , éprouvent un tel changement
par l’aftion de la fievre, qu’elles font féparées de la
maffe des humeurs faines avec la portion des foliées
, qui les contient par l’effort de la colonne des liquides
qui eft pouflée contre la matière engorgée ,
6c par la force de preflion collatérale des vaiffeaux
voifins ; & il fe forme de ce mélange de fluides & de
parties confiftantes broyées , rompues par l’effet de
toutes ces puiffances.combinées, une matière qui ne
tient plus rien de celles dont elle eft compofée ; qui
eft blanche, homogène, onélueufe; qui venant à fe
répandre dans les cellules pulmonaires & à fe mêler
avec la matière des crachats, eft évacuée avec elle
par l’expe&oration, qui eft fi fouvent le moyen par
lequel la nature termine heureufement les maladies
de la partie dont il s’agit.
Il réfulte de tout ce qui vient d’être dit, que c’eft
toûjours la fievre, ou l’aftion de la vie rendue plus
forte en général ou en particulier, qui produit la coction
de quelqu’efpece qu’elle foit ; c’eft elle qui eft
l’inftrument dont la nature fe fert , comme dit Sydenham
, fect. i.c . jv . pour féparer dans les humeurs
les parties impures des pures, pour évacuer les matières
hétérogènes nuifibles à l’économie animale.
C ’eft de ce principe qu’il inféré avec les plus grands
médecins, que la principale chofe que l’on doit faire
dans la cure des maladies, eft de régler l’aôion de
la v ie , les agitations de la fievre , de les tenir dans
une jufte modération , pour empêcher que par de
trop grands efforts les vaiffeaux du cerveau 6c des
poumons, qui font les plus délicats , ou ceux de toute
autre partie importante affoiblie par quelle caufe
que ce fo i t , ne fe rompent ou ne s’engorgent d’une
maniéré irréfoluble ; ou qu’au, contraire par trop
peu d’efforts, la matière morbifique ne foit mal digérée
, 6c fa coBion imparfaite : & dans le cas où l’action
dé la vie eft convenablement animée & exci-
tee, l’agitation fébrile fuffifant pour opérer une bonne
coBion, fans que l ’on ait rien à craindre de fes e f fets,
de laiffer à la nature le foin de la guérifon.
Hippocrate a donné l’exemple d’une pareille conduite
dans le traitement de plufieurs maladies, à l’égard
defquelles il lui arrivoit fouvent de fe tenir
dans l’ina&ion, & d’être fpe&ateur des opérations
de la nature lorfqu’elle n’avoit pas befoin d’être aidée.
Un des plus fideles & des plus prudens imitateurs
du pere de la Medecine, Sydenham, avoue ingénue-
ment s’être aufli très-bien trouvé d’avoir pris le parti
de ne rien faire dans certains cas, pour fe conformer
aux préceptes de fon maître, qui dit expreffément,
dans fon traité de articulis : Interdum enim optima
medicina ejt medicinam non facere. C ’eft aufli fur ce
fondement que Galien, de dieb. crit. lib. I . s’élève
contre les médecins , qui ne croyaient pas exercer
leur art félon les réglés , s’ils ne preferivoient toujours
quelques remedes à leurs malades, tels que la
faignée, les ventoufes, ou quelques Iavemens, purgations
, &c. 6c il dit que de pareils médecins ne s’approchent
des malades que pour commettre des fautes
aufli répétées que leurs vifites ; qu’il eft confé-
quemment impoflible que la nature fi fouvent interrompue
& troublée dans fon ouvrage, puiffe corriger
la matière morbifique, 6c parvenir à la guérifon
de la maladie : l’humeur viciée dont il faut que la
coBion fe faffe pour la procurer , demande plus ou
moins d’a&ion fébrile, félon qu’elle eft d’une nature
plus ou moins tenace ^ rebelle,
Ainfi
Àinfi dans les fievres éphemetes, & autres maladies
legeres ,1a nature n’a fouvent pas befoin de pro1
curer le pépafme , comme dans l’ekernple allégué
ci-deffus , où le vice ne confifte que dans une trop
grande abondance de chyle : la coBion qui s’en fait
eft femblable à celle de la digeftion ordinaire dans
' les fécondés voies ; elle n’eft qu’un peu plus labô-
rieufe ; c’eft le vrai pepjîs ; ou s’il faut quelque chô-
fe de plus, & que la coBion doive procurer quelque
élaboration, elle eft très-peu cônfidérable ; ce n’eft
qu’une tranfpiration plus forte, une petite fueur, ou
tout âu plus un leger cours de ventre. Dans les fièvres
putrides, dans les inflammatoires, la coBion demande
plus de travail ; la nature a fouvent befoin
d’être aidée, pour qu’elle puiffe venir à bout de préparer
la matière morbifique , & la difpofer à l’évacuation
, qui fouvent doit être très-copieùfe & à
plufièurs reprifes : c’eft le cas où l’on employé avec
luccès les moyens qui peuvent détremper, divifer j
atténuer les humeurs viciées, relâcher les folides,
afin qu’ils cèdent plus aifément ; ou leur donner dü
reflort, s’ils en manquent, afin que les voies foient
plus libres pour fàvorifer l’évacuation. Tels font
fur-tout les lavages, en bôiffon , en laveniént, qui
étant adminiftrés avec prudence, félon les indications
qui fe préfentent, peuvent fàtisfâire à ce que
recommande Hippocrate , lorfqù’il dit , apkor. j x .
feB. 2. Corpora cum quis pùrgare voluerit, ta Jtuxilïa
faciàt oportet : c’eft de cette maniéré qu’il convient
de faciliter la cbBion -, & la crife qui doit toûjours
’en être précédée.
Dans les fievres qu’on appéllè rhalignes , il y à
Une fi grande léfion de fonctions, & un vice fi difficile
à corriger dans la matière morbifiqué, que là nature
fuccombe bientôt fi elle n’eft puiffamment fe-
Courue, parce qu’il ne faut pas moins que la coBion
la plus forte pour détruire la caufe du mal. DanS
les fievres peftilèntielleS & la pefte, les fecours les
plus appropriés & les plus grands éfforts de la nature
font le plus fouvent infuffifans pôur opérer la
coBion, parce qüe lés forces de la vie font trop peu
attives à proportion de la réfiftance des délétères ,
& que lés mauvais effets de ceux-ci font fi prompts,
qu’ils ne laiffent ni à la nature ni à l’ârt le tems d’y
apporter remede ^ ou au moins d’en tenter quelqu’un.
Il réfültë dé cé qui a été dit jufqü’ïci dé la coBion
dans les maladies, qu’elle ne peut avoir lieu proprement
qüe darts celles qui font avec matière, félon
le langage de l’écôle, c’eft-à-dire qui font cau-
fées par un vice dans les humeurs ; dans toute aütré
il ne peut y avoir ni coBion ni crife. Voye^ Grise ,
Fievre-. Cet article ejt de M. d’A um on t 9 premier prô-
fejfeur de Medecine en U univerjite de Valence.
C o c t io n , ( Phartnac. ) mot générique exprimant
l’altération opérée fur un côrps folide par l’aûion
d’un liquide, excitée ou augmentée pat le fect.
Dans la coBion On n’a en vûe que le changement
opéré fur le corps qui en eft le fujet, fans s’embar-
raffér de ce que le liquide qu’on lui applique en peut
extraire ; 6c c’eft en cela précifément que la coBion
pharmaceutique différé dé la décO&iort , dans laquelle
c’eft cette feule extràâion qu’on fe prdpofe;
Voye[ D é c o c t io n ;
On fait la toBiori des racines d*eriula campana *
pour les ramollir & les rendre propres à être réduites
en pulpe, afin d’en former enfuite une conferVe ;
& on fait la décoétion des mêmes racines pour
charger l’eau qu’on y employé de leurs parties ex-
traâives, qu’on rapproche enfuite ou qu’on réduit
en confîftance d’extrait. Voye\ Ex t r a it .
Les oignons de lis, defeylies, & quelques autres
corps très-aqueux qu’on fait ramollir fous la cendre
chaude, doivent être rangés parmi les fujets de la
coBion pharmaceutique ; ils ne different des autres?
dont nous venons de parler, qu’en ce qu’ils portent
avec eux-mêmeS le liquide qu’on eft obligé d’appliquer
aux corps qui font plus durs & plus fecs.
Le mot cuite n’eft pas fynonyme en Pharmacie aU
mot coBion. Voye%_ C u it e .
C o c t io n ,(.Alchim.') ce mot eft employé communément
dans le langage des Alchimiftes, pour exprimer
la longue digeftion à laquelle ils expofent la
précieufe matière du grand oeuvre, dans le deffeirt
de lui faire éprouver cette altération graduée 6c in-
fenfible qui doit la conduire enfin à la maturation ou
à la perfeâion. (£•)
CO C Y T E f. m. ( Mytk. ) un des quatre fleuves
des enfers ; fleuve d’Epyre, ou plùtôtde la Thefpro-
tie qui en étoit une partie ; il tomboit avec le Pyri-
phlégeton dans le marais Achérufia. Sôn étymologie
6c fon voifinage de l’Achéron, l’ont fait mettre par
les poètes grecs au nombre des fleuves des enfers;
En effet cocyte veut dire pleurs, gémiffemeris, de nc-
vMiv, gémir. Il a donné fon nom aux fêtes cocytien-
nes ’qu’on célébrait en l’honneur de Proferpine.
Je crois que le Co'cyt'e des poètes latins étoit le
ruiffeau de ce nom qui couloit en Italie près du lac
d’Averne, & fe déchargeoit dans le lac Lucrin, lequel
fut enfin prefque comblé par une nouvelle montagne
de cendres qu’on vit s’élever du fond de ce
lac dans Un tremblement de terre arrivé le 19 Septembre
1538.
Ce n’eft donc pas feulement de l’Epyre que les
Poètes ont tiré l’idée des fleuves de l’enfer ; le lac
d’Averne d’Italie, & les fontaines d ’eaux chaudes
qui étoient aux environs , y ont également donné
lieu. Tous ces endroits étoient fi couverts de bois
depuis Bayes & Pouzzol, que les eaux y croupiffant ±
paffoient pour être des plus mal-faines ; outre que
la vapeur qui fortoit des mines de foufre & de bitume
qui y font en grand nombre, ne pouvoit pas s’exhaler
aifément.
Agrippa favori d’Aügufte , 6c rempli d’amour du
bien public, fit couper ces bois & nettoyer fi bien
les lieux voifins, que depuis les eaux devinrent claires
& nettes , au rapport de Strabon. Mais c’eft pour
cela même que les Poètes ornèrent leurs écrits des
anciehnés idées qu’on avoit du Cocyte. Horace, ode
xjv. liv. II. v. ï-8. & Virgile , Ænéid. hv. VI. V .J2J.
n’y manquèrent pas.
Le premier,dans cette ode àPofthume,où la moi
raie eft fi bien cachée, où la verfification eft fi belle *
rappelle poétiquement à fon ami la néceflité de
mourir :
Vifendus ater jlurnine languide
Co'cytus errans.
Article de M. le Chevalier DE Ja u c o ü R'î'.
CODAGA-PALE , ( Bot. escot. ) arbriffeaii des
Indes orientales peu connu j 6c qui n’eft pas fanS
vertus utiles eh Medecine : deux raifons fuffifantes
pour en faire mention;
Voici les noms qu’il a dans nos ouvrages de Botanique;
Codaga-pala, H. Mal; part. I. p. 85. tab. 47.
■ Nzrium hidicurfi, Jiliquis angufiis, ereBis , longis £
geminis, Burm. Thef. Zeyl. tSy. tab. yy.
Apocynum ereBum Malabaricum , jrutefeens , }afmini
jlore tandido -9 Par. Bat. 44.
ArboY Malabarica laBèfcens -, jafminiflore odorato ±
Jiliquis oblongis i Syen. in not. ad H. M.
Conejji, aB. Edimb. tome I I I .p . 32.
Cet arbriffeau vient fréquemment dans le Malabar
6c dans l’île de Ceylan. Sa racine eft peu pr<£
fonde ; elle répand beaucoup de fibres. Son écOfcè
éft d’un rouge brun 6c de lait. Son goût- eft amer 6c
peu piquant, Les tiges en font fermes, ligneufes *
C C c c