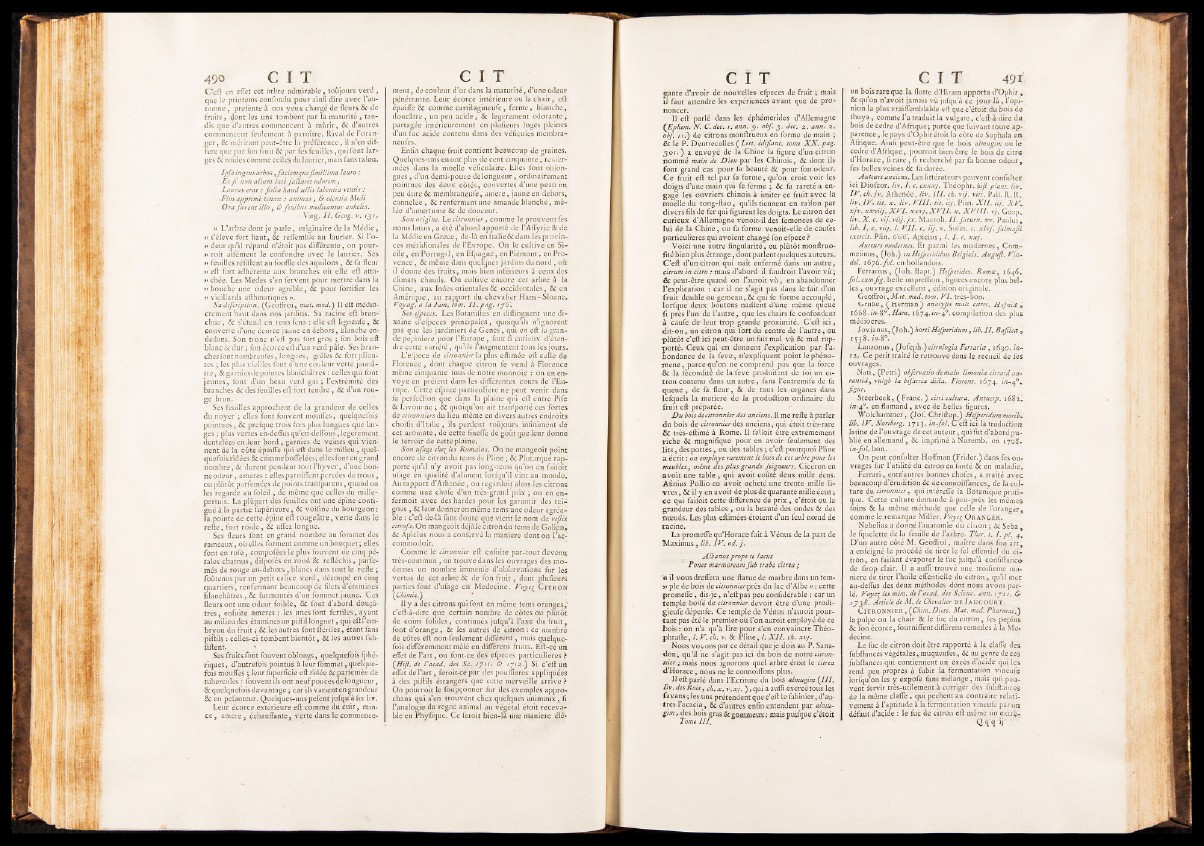
49° C I T
C ’eft en effet cet arbre admirable, toujours verd ,
que le printems confondu pour ainfi dire avec l’automne
, prefente à nos yeux chargé de fleurs & de
fruits, dont les uns tombent par la maturité , tandis
que d’autres commencent à mûrir, & d’autres
commencent feulement à paroître. Rival de l’oranger,
& méritant peut-être la préférence, il n’en différé
que par fon fruit & par fes feuilles, qui font lar-*-
ges & roides comme celles du laurier, mais fans talon.
Ipfaing ensarbos,faciemque fimillima lauro :
jEt Ji non altum lacé jactaret odorcm,
Laums erat : folia haud ullis labentia venus :
Flos apprimé tenax : animas , & oleniia Midi
Ora fovent illo , & fenibus medicantur ankelis.
Virg. I I . Geog. v. 131.
« L ’arbre dont je parle, originaire de la Médie,
» s’élève fort haut, & reffemble au- laurier. Si l?o-
» deur qu’il répand n’étoit pas différente, on pour-
» roit aifément le confondre avec le laurier. Ses
» feuilles réfiftent au fouffle des aquilons, & fa fleur
» eft fort adhérente aux branches où elle eft attâ-
» chée. Les Medes s’en fervent pour mettre dans la
» bouche une odeur agréble, & pour fortifier les
»vieillards afthmatiques ».
Sa defeription. (Géoffroi, mat. mod.') Il eft médiocrement
haut dans nos jardins. Sa racine eft bran-'
chue, & s’étend en tous fens : elle eft ligneufe, &
couverte d’une écorce jaune en-dehors, blanche en-
dedans. Son tronc n’eft pas fort gros ; fon bois eft
blanc & dur ; fon écorce eft d’un verd pâle. Ses branches
fontnombreufes, longues, grêles & fort pliantes
; les plus vieilles font d’une couleur verte jaunâtre,
& garnies de pointes blanchâtres : celles qui font
jeunes, font d’un beau verd gai ; l’extrémité des
branches & des feuilles eft fort tendre, & d’un rouge
brun.
Ses feuilles approchent de la grandeur de celles
du noyer ; elles font fouvent mouffes, quelquefois
pointues, & prefque trois fois plus longues que larges
; plus vertes en-deffusqu’en-deffous,legerement
dentelées en leur bord, garnies de veines qui viennent
de la Cote épaiffe qui eft dans le milieu, quelquefois
ridées & comme boffelées; elles font en grand
nombre, & durent pendant toutl’hyver, d’une bonne
odeur, ameres : elles paroiffent percées de trous,
ouplûtôt parfemées de points tranfparens, quand on
les regarde au foleil, de même que celles du millepertuis.
La plupart des feuilles ont une épine contiguë
à la partie fupérieure, & voifine du bourgeon :
la pointe de cette épine eft roûgeâtre, verte dans le
refte, fort roide , & affez longue.
Ses fleurs font en grand nombre au fommet des
rameaux , où elles forment comme un bouquet ; elles
font en rofe, cômpofée's le plus fouvent de cinq pétales
charnus, difpofés en rond & réfléchis, parfe-
més de rouge en-dehors , blancs dans tout le refte ;
foûtenus par un petit calice v erd , découpé en cinq
quartiers, renfermant beaucoup de filets d’étamines
blanchâtres, & furmontés d’un fommet jaune. Ces
fleurs ont une odeur foible, & font d’abord douçâ-
tres, enfuite ameres : lés unes font fertiles, ayant
au milieu des étamines un piftil longuet, qui eft l’embryon
du fruit ; & les autres font ftériles, étant fans
piftils ; celles-ci tombent b ientôt, & les autres fub-
fiftent.
Ses fruits font fouvent ôblongs, quelquefois fphé-
riques, d’autrefois pointus à leur fommet, quelquefois
mouffes ^ leur fuperficie eft ridée & parlemée de
tubercules : fouvent ils ont neuf pouces delongueur,
& quelquefois davantage ; car ils varient en grandeur
& en pefanteur. Quelques-uns pefent jufqu’àfix lir.
Leur écorce extérieure eft comme du cuir, mince
, amere, échauffante, verte dans le commence-
C I T
ment, de couleur d’or dans la maturité, d’une odeur
pénétrante. Leur écorce intérieure ou la chair, eft
épaiffe & comme cartilagineufe, ferme, blanche,
doueâtre, un peu acide , & legerement odorante ,
partagée intérieurement en plufieurs loges pleines
d’un fue acide contenu dans des véficules membra-
neufes.
Enfin chaque fruit contient beaucoup de graines.
Quelques-uns en ont plus de cent cinquante, renfermées
dans la moelle véficulaire. Elles font oblon-
gues , d’un demi-pouce de longueur, ordinairement
pointues des deux côtés, couvertes d’une peau un
peu dure & membraneufe, amere, jaune en-dehors,
cannelée, & renfermant une amande blanche, mêlée
d’amertume & de douceur.
Son origine. Le citronnier, comme le prouvent fes
noms latins, a été d’abord apporté de l’Affyrie & de
la Médie en Grece, de-là en Italie & dans les provinces
méridionales de l’Europe. On le cultive en Sicile
, en Portugal, en Efpagne, en Piémont, en Provence
, & même dans quelques jardins du nord , où
il donne des fruits, mais bien inférieurs à ceux des
climats chauds. On cultive encore cet arbre à la
Chine, aux Indes orientales & occidentales, & en
Amérique, au rapport du chevalier Hans-Sloane.
Voyag. à la Jam. tom. I I . pag. lyG.
Ses efpeces. Les Botaniftes en diftinguent une di-
xaine d’efpeces principales, quoiqu’ils n’ignorent
pas que les jardiniers de Genes, qui en eft la grande
pepiniere pour l’Europe, font fi curieux d’étendre
cette variété, qu’ils l’augmentent tous les jours.
L’efpece de citronnier la plus eftimée eft celle de
Florence, dont chaque citron fe vend à Florence
même cinquante fous de notre monnoie : on en envoyé
en préfent dans les différentes cours de l’Europe.
Cette efpece particulière ne peut venir dans
fa perfeétion que dans la plaine qui eft entre Pife
& Livourne ; & quoiqu’on ait tranfporté ces fortes
de citronniers du lieu même en divers autres endroits
choifis d’Italie , ils perdent toujours infiniment de
cet aromate, de cette fineffe de goût que leur donne
le terroir de cette plaine.
Son ufage chejes Romains. On ne mangeoit point
encore de citrondu tems de Pline ; & Plutarque rapporte
qu’il n’y avoit pas Iong-tems qu’on en faifoit’
ufage en qualité d’aliment Iorfqu’il vint au monde.
Au rapport d’Athenée, on regardoit alors les citrons
comme uue chofe d’un très-grand prix ; on en en-
fermoit avec des hardes pour les garantir des teignes
, & leur donner en même tems une odeur agréable
: c’eft de-là fans doute que vient le nom de vefiis
çitrofa. On mangeoit déjàle citrondu tems de G alien,
& Apicius nous â confervé la maniéré dont on l?ac-
commodoit.
Comme le citronnier eft enfuite par-tout devenu
très-commun , on trouve dans les ouvrages des modernes
un nombre immenfe d’obfervations fur les
vertus de cet arbre & de fon fru it, dont plufieurs
parties font d’ufage en Medecine. Foye^ C itron
('Chimie.)
Il y a des citrons qui font en même tems oranges,1
c’eft-à-dire que certain nombre de côtes ou plûtôt
de coins folides, continués jufqü’à l’axe du fruit,
font d’orange, & les autres de citron1: ce nombre
de côtes eft non-feulement différent, mais quelquefois
différemment mêlé en différens fruits. Eft-ce un
effet de l’art, ou font-ce des efpèces particulières ?
(Hijl. de Vacad. des Sc. 1 y 11. & iy/2.') Si c’eft un
effet de l’art, feroit-cepar des pouflîeres appliquées
à des piftils étrangers que cette merveille arrive }
On pourroit le foüpçonner fur des exemples appro-
chans qui s’en trouvent chez quelques animaux, fi
l’analogie du régné animal au végétal étoit recevable
en Phyfique. Ce feroit bien-là une maniéré élé-
C I T
gante d’avoir de nouvelles efpeces de fruit ; mais
il faut attendre les expériences avant que de prononcer.
Il eft parlé dans les éphémerides d’Allemagne
( Ephem. N. C. dec. 1. ann. c>. obf. 3 .'dec. 2. ann. 2.
obf. //.) de citrons monftrueux en forme de main ;
& le P. Dentrecolles ( Lett. édifiant, tome X X . pag.
Sou") a envoyé de la Chine la figure d’un citron
nommé main de Dieu par les Chinois, & dont ils
font grand cas pour fa beauté & pour fon odeur.
C e fruit eft tel par fa forme, qu’on croit voir les
doigts d’une main qui fe ferme ; & fa rareté a engagé
lès ouvriers chinois à imiter ce fruit avec la
moelle du tong-ftao, qu’ils tiennent en raifon par
divers fils de fer qui figurent les doigts. Le citron des
curieux d’Allemagne venoit-il des femences de celui
de la Chine, ou fa forme venoit-elle de caufes
particulières qui avoient changé fon efpece ?
Voici une autre fingularité, ou plûtôt monftruo-
fitébien plus étrange, dont parlent quelques auteurs.
C ’eft d’un citron qui naît enfermé dans un autre,
citrum in citro : mais d’abord il faudroit l’avoir vû ;
•& peut-être quand on l’auroit v û , en abandonner
l ’explication : car il ne s’agit pas dans le fait d’un
fruit double ou gemeau, & qui fe forme accouplé,
lorfque deux boutons naiffent d’une même queue
fi près l’un de l’autre, que les chairs fe confondent
à caufe de leur trop grande proximité. C ’eft i c i ,
dit-on, un citron qui fort du centre de l’autre, ou
plûtôt c’eft ici peut-être un fait mal vû & mal rapporté.
Ceux qui en donnent l’explication par l’abondance
de la feve, n’expliquent point le phénomène
, parce qu’on ne comprend pas que la force
& la fécondité de la feve produifent de foi un citron
contenu dans un autre, fans l’entremife de fa
queue , de fa fleur, & de tous les organes dans
lefquels la matière de la produftion ordinaire du
fruit eft préparée.
Du bois de citronnier des anciens. Il me refte à parler
du bois de citronnier des anciens, qui étoit très-rare
& très-eftimé à Rome. Il falloit être extrêmement
riche & magnifique pour en avoir feulement des
lits , des portes, ou des tables ; c’eft pourquoi Pline
a écrit : on employé rarement le bois de cet arbre pour les
■ meubles^ même des plus grands feigneurs. Cicéron en
a v o i t une table, qui avoit'coûté deux mille écus.
Afinius Pollio en avoit acheté une trente mille libres
, & il y en avoit de plus de quarante mille écus ;
•ce qui faifoit cette différence de prix , c’étoit ou la
grandeur des tables , ou la beauté des ondes & des
noeuds. Les plus eftimées étoient d’un feul noeud de
racine.
La promeffe qu’Horace fait à Vénus de la part de
Maximus, lib. IF . od. j .
Albanos prope te lacus
Ponet marmoreatn fub trabe citrêa ;
’« il vous dreffera une ftatue de marbre dans un tem-
» pie de bois de citronnier près du lac d’Albe » : cette
promeffe, dis-je, n’eft pas peu confidérable : car un
temple boifé de citronnier devoit être d’une prodi-
gieufe dépenfe. Ce temple de Vénus n’auroit pourtant
pas été le premier où l’on auroit employé de ce
kois : on n’a qu’à lire pour s’en convaincre Théo-
phrafte, l. V. ch. v. & Pline, l. X I I . ch. xvj.
Nous voyons par ce détail que je dois au P. Sana-
don, qu’il ne s’agit pas ici du bois de notre citronnier
; mais nous ignorons quel arbre étoit le citrea
d’Horace, nous ne le connoiffons plus.
Il eft parlé dans l’Ecriture du bois almugim (JII.
liv. des Rois, ch. x . v .xj. ) , qui a aufli exercé toiis les
favans ; les üns prétendent que c’eft le fabinier, d’autres
l’acacia, &; d’autres enfin entendent par almtt-
gimy des bois gras & gommeux ; mais puifque c’étoit
Tome I I I .
C I T 4 9 i
un bois rare que la flotte d’Hiram apporta d’Ophir,
& qu’on n’avoit jamais vû jufqu’à ce jour-là, l’opinion
la plus vràiffemblable eft que c’étoit du bois de
thuya, comme l’a traduit la vulgate, c’eft-à-dire du
bois de cedre d’Afrique; parce que fuivant toute apparence
, le pays d’Ophir étoit la côte de Sophala en
Afrique. Ainfi peut-être que le bois almugim ou le
cedre d’Afrique, pourroit bien être le bois de citre
d’Horace, fi rare, fi recherché par fa bonne odeur,
fes belles veines & fa durée.
Auteurs anciens. Les littérateurs peuvent confulter
ici Diofcor. liv. I. c. cxxxj. Théophr. hifl. plant, liv.
IF . ch.'jv. Athenée, liv. III. ch. vij. vïij. Pall. R . R .
Liv.jF. tit. x. liv. F III. lit. iij. Plin. X I I . iij. X F .
xjv. xxviij. X F I . xxvj. X F I I . x. X F I I I . vj. Geop.
liv. X. c. vij. viij.jx . Macrob. Il.Jaturn. xv. Paulus,
lib. I . c. viij. I, F II. c. iij. v. Solin. c. xlvj. falmafii
exercitr Plin.- Apicius, A I. c. xx j.
Auteurs modernes. Et parmi les modernes, Com-
melinus, (Joh.) in Hefperidibus Belgicis. Augufi, Fin-
del. 167(3. fol. en hollandois.
Ferrarius, (Joh. Bapt.) Hefperides. Romce, 1646.'
fol. cum fig. belle impreflion, figures encore plus belles
, ouvrage excellent, édition originale.
Géoffroi, Mat. med. tom. FI. très-bon.
Grube, ( Herman ) analyfis malt citrei. Hafnia
1668. in-%°,Ham. 1674.^/2-4°. compilation des plus
médiocres.
Jovianus, (Joh.) horti Htfperidum , lib. II. Bafilece9
1538. i/t-8°.
Lanzonus., (Jofeph.) citrologia Ferrarice, 1690. in-
12. Ce petit traité fe retrouve dans le recueil de fes
ouvrages.
Nati, (Pétri) obfervatio demalo limonia citratâ au-
rantiây yulgb la btfarria dicta. Florent. 1674. 2/2-4°*
fi§ur'
Steerbeek, (Franc.) citricultura. Antuerp. 1682.
//z-40. en flamand, avec de belles figures.
Wolchammer, (Jof. Chriftop.) Hefperidummorib
lib. IF . Noriberg. 1713. in-fol. Ç ’eft ici la traduction
latine de l’ouvrage de cet auteur, qui fut d’abord pu-,
blié en allemand, ÔC imprimé à Nuremb. en 1708*
in-fol. bon.
On peut confulter Hoffman (Frider.) dans fes ouvrages
fur l’utilité du citron en l'anté & en maladie.
Ferrari , enttfautres bonnes chofes, a traité avec
beaucoup d’érudition & deconnoiffances, de la culture
du citronnier, qui intéreffe la Botanique prati-.
que. Cette culture demande à-peu-près les mêmes
foins & la même méthode que celle de l’oranger,
comme le remarque Miller. Foye[ O ranger.
Nebelius a donné l’anatomie du cition ; & Seba ,
le fquelette de la feuille de l’arbre. Tker. t. I. pl. 4.
D’un autre côté M. Géoffroi, maître dans fon art,
a enfeigné le procédé de tirer le fel eflèntiel du citron,
en faifant évaporer le fuc julqu’à confiftanc©-
de firop clair. Il à aufli’trouvé une troifieme maniéré
de tirer l’huile effentielle du citron,, qu’il mer
au-deffus des deux méthodes dont nous avons parlé.
Foye£ lesmém’. del'acad. des Scienc. ann. 1721. &■
iy j8 . Article de M. le Chevalier de Ja u co u r t .
CITRONNIER, (Chim.Dicte. Mat. med.PharmacJ
la pulpe ou la chair & le fuc du citron, fes pépins
& fon écorce, fourniffent différens remedes à la Médecine.
Le fuc de citron doit être rapporté à la claffe des
fubftances végétales, muqueufes, & au genre de ces
fubftances qui contiennent un excès d’acide qui les
rend peu propres à fubir la fermentation vineufç
ïorfqu’on les y expofe fans mélange, mais qui peuvent
fervir très-utilement à corriger des fubftances
de la même claffe , qui pechent au contraire relativement
à l’aptitude à la fermentation vineufe par un
défaut d’acide : le fuc de citron eft même un extrè-
Q q q ï j " -