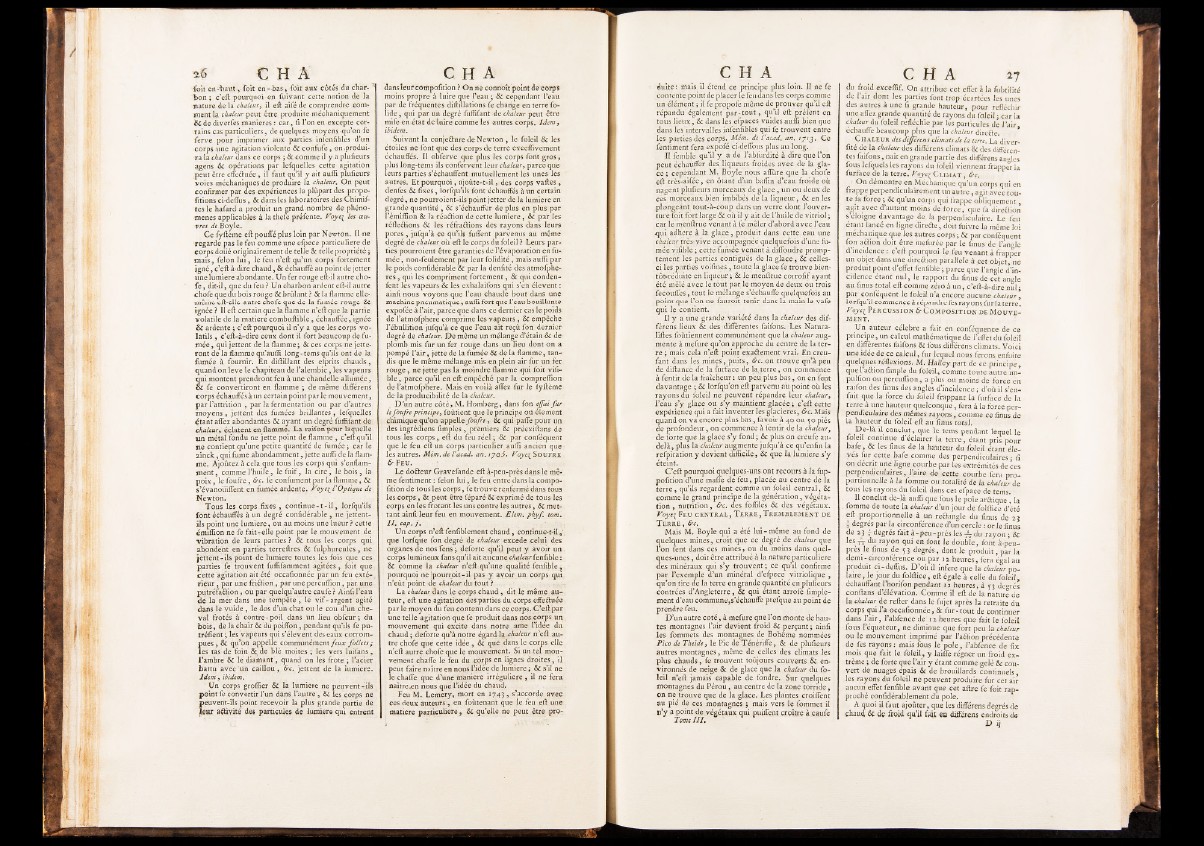
/
foit en -'h a u t fo it en-bas , -foit aux côtés du char- *
b o n ; c’eft.pourquoi en fuivant cette-notion de la
nature de la chaleur, il eft aifé de comprendre com?
ment la chaleur peut être produite méchaniquement
Bc de diverfes maniérés : car , fi l’on en excepte certains
cas particuliers, de quelques moyens qu’on fe
ferve pour imprimer aux parties inienfibles d’un
corps une agitation violente & co n fu fe , on .produira
la chaleur dans ce corps ; & comme il y a plufieurs
agens & opérations par lefquelles cette agitation
.peut être effectuée, il faut qu’il y ait auffi plufieurs
voies méchaniques de produire la chaleur, On peut
confirmer par des expériences la plûpart des proportions
ci-deffus, & dans les laboratoires des Chimif-
tesle hafard a produit un grand-nombre de phénomènes
applicables à la thefe préfente, Foyc^ les oeuvres
de-Boyle.
Ce fyftème eft pouffé plus loin par Newton. Il ne
regarde pas le feu comme une efpece particulière de
corps doiié originairement de telle & telle propriété ;
mais, félon lu i, le feu n’eft qu’un corps fortement
igné, c’eft-à-dire chaud, & échauffé au point de jetter
une lumière abondante. Un-fer rouge eft-il autre cho-. ï
f e , dit-il, que du feu ? Un charbon ardent eft-il autre
chofe que du bois rouge & brûlant ? & la flamme elle-
même eft-elle autre chofe que de la fumée rouge &
ignée ? Il eft certain que la flamme n’eft que la partie
volatile de la matière combuftible, échauffée, ignée
& ardente ; c’eft pourquoi il n’y a que les corps vo latils
, c’eft-à-dire ceux dont il fort beaucoup de fumée
, qui jettent de la flamme ; & ces corps ne jetteront
de la flamme qu’auflî long-tems qu’ils ont de la
fumée à fournir. En diftillant des efprits chauds,
quand onleve le chapiteau de l’alembiç, les vapeurs
qui montent prendront feu à une chandelle allumée,
ce fe convertiront en flamme ; de même différens
corps échauffés à un certain point par le mouvement,
par l’attrition , par la fermentation ou par d’autres
moyens , jettent des fumées brillantes , lesquelles,
étant affez abondantes & ayant un degré fuflifant de
chaleur, éclatent en flamme. La raifon pour laquelle
un métal fondu ne jette point de flamme , c’eft qu’il
ne contient qu’une petite quantité de fumée ; car ie
zinck , qui fume abondamment, jette aufli de la flamme.
Ajoutez à cela que tous les corps qui s'enflant-; ;
ment, comme l’huile, le fu if , la cire, le bois , la
p o ix , le foufre, &c. fe confument par la flamme, &
s’évanoiiiffent en fumée ardente. Voye^ l'Optique de
Newton.
Tous les corps fixes , continu e-1-il, lorfqu’ils
font échauffés à un degré confidérable , ne jettent-
ils point une lumière, ou au moins une lueur ? cette
émiflion ne fe fait-relle point par le mouvement de
vibration de leurs parties ? & tous les corps qui
abondent en parties terreftres & fulphureufes, ne
jettent - ils point de lumière toutes les fois que ces .
parties le trouvent fuffifamment agitées, foit que
cette agitation ait été occafionnée par un feu exté-,
r ieur, par une friélion, par une pereuflion, par une
putréfaûion, ou par quelqu’autre caufe ? Ainfi l’eau
de la mer dans une tempête , le v if - argent agité
dans.le-vuide, le dos d’un chat ou le cou d’un chev
al frotés à contre - poil dans un lieu obfcur ; du
bois, dé là chair & du poiffon, pendant qu’ils fe putréfient
; lés vapeurs qui s’élèvent des eaux corrompues
, & qu’on appelle communément feux follets;
les tas de foin 8^ de blé moites ; les vers luifans,
l ’ambre &C le diamant, quand on les frot.e ; l’acier
battu avec'ün caillou, &c, jettent de la lumière.
Idem , ibidem.
Un Corps groflier & la lumière ne peuvent -ils
point fe convertir l’un dans , l’autre , & les corps ne
peuvent-ils point recevoir la plus grande partie de
leur activité des particules de lumière qui entrent
dans leur côtftpofition ? On ne connoît point de eofpî
moins propre à luire que l’eau ; & cependant l’eau
par de fréquentes diftillations fe change en terre fo-
lid e , qui par un degré fuflifant de chaleur peut être
mife en état de luire comme les autres corps. Idem,
ibidem.
Suivant la conjeâure de Newton , le foleil & les
étoiles ne font que des corps de terre exeeffivement
échauffés. Il obferve que plus les corps font gros,
plus long-tems ils confervent leur chaleur, parce que
leurs parties s’échauffent mutuellement les unes les
autres. Et pourquoi, ajoute-t-il, des corps vaftes,
denfes & fixes, lorfqu’ils font échauffés à un certain
degré, ne pourroient-ils point jetter de la lumière en
grande quantité , & s ’échauffer de plus en plus par
l’émiffion & la réaûion de cette lumière, & par les
réfleftions & les réfraûions des rayons dans leurs
pores, jufqu’à ce qu’ils fuffent parvenus au même
degré de chaleur oit eft le corps du foleil ? Leurs parties
pourroient être garanties de l’évaporation en fumée
, non-feulement par leur folidité, mais auffi par
le poids confidérable & par la denfité des atmofphe-
re s , qui les compriment fortement, & qui eonden-
fent les vapeurs & les exhalaifons qui s’en élevent :
ainfi nous voyons que l’eaù chaude bout dans une
machine pneumatique, auffi fort que l’eau bouillante
expofée à l’air, parce que dans ce dernier cas le poids
de l’atmofphere comprime les vapeurs, & empêche
l’ébullition jufqu’à ce que l’eau ait reçu fon dernier
degré de chaleur. De même un mélange d’étain & de
plomb mis fur un fer rouge dans un lieu dont on a
pompé l’air, jette de la fumée & de la flamme, tandis
que le même mélange mis en plein air fur un fer
rouge, ne jette pas la moindre flamme qui foit vifi-
b le , parce qu’il en eft empêché par la compreffion
de l’atmofphere. Mais en voilà affez fur le lyftème
de la producibilité de la chaleur.
D|un autre côté, M. Homberg, dans fon effai fur
le foufre principe, foûtient que le principe ou element
chimique qu’on appelle foufre , & qui paffe pour un
des ingrédiens fimples , prèmiers & préexiftans de
tous les corps, eft du feu réel ; & par conféquent
que le feu eft un corps particulier auffi ancien que
les autres. Mêm. de Tacad. an. tyoS. Voyei Soufre
& Feu .
Le do&eur Gravefande eft à-peu-près dans le même
fentiment : félon lui, le feu entre dans la compo-
lition de tous les corps, fe trouve renfermé dans tous
les corps, & peut être féparé & exprimé de tous les
corps en les frotant les uns contre les autres, & mettant
ainfi leur feu en mouvement. Elem, phyf tom.
I I . cap.y . .
Un corps n’eft fenfiblement chaud, continue-t-il,'
que lorfque fon degré de chaleur excede celui des
organes de nos fens ; deforte qu’il peut y avoir un
corps lumineux fans qu’il ait aucune chaleur (erxÇAAe :
& comme la chaleur n’eft qu’une qualité fenfible;
pourquoi ne jpourroit-il pas y ayoir un. corps qui
n’eût point de chaleur Au tout? ..
La chaleur dans le corps chaud, dit le même auteur,
eft une agitation des parties du corps effectuée
par le moyen du feu contenu dans ce corps. C ’eft par
une telle agitation que fe produit dans nos corps un
mouvement qui excite dans notre ameT idée du
chaud; deforte qu’à notre égard la,chaleur n’eft autre
chofe que cette idée , & que dans le corps elle
n’eft autre chofe que le mouvement. Si un tel mouvement
chaffe le feu du corps en lignes droites, il
peut faire naître en nous l’idée de lumière ; & s’il ne
le chaffe que d’une maniéré irrégulière , il ne fera
naître ,ep nous que l’idée du chaud.
Feu M. Lemery, mort en 1743 ? s’accorde avec
ces deux auteurs', en ,fpûtenant que le feu eft une
matière particulière, & qu’elle ne peut être pro-.
duite ï mais il étend ce principe plus loin. 11 11e fé
contente point de placer le feu dans les corps comme
un élément ; il fe propofe même de prouver qu’il eft
répandu également p a r-tou t, qu’il eft préfent en
tous lieux, & dans les espaces vuides auffi bien que
dans les intervalles infenfiblps qui fe trouvent entre
les parties des corps. Mêm. de Vacad. an. 1713. Ce
fentiment fera expofé ci-deffous plus au long.
Il femble qu’il y a de l’abfurdité à dire que l’on
peut échauffer des, liqueurs froides avec de la glac
e ; cependant M. Boyle nous affûre que la chofe
eft très-àifée, en ôtant d’un baffin d’eau froide oîi
nagent plufieurs morceaux de glace , un ou deux de
cês morepaux bien imbibés de la liqueur, & en les
plongeant tout-à-coup dans un verre dont l’ouverture
foit Fort large & oit il y ait de l ’huile de vitriol ;
car le menftrue venant à fe mêler d’abord avec l’eau
xpii adhéré à la gla.ee, produit dans cette eau une
chaleur très-yive accompagnée quelquefois d’une fumée
vifible ; cette fupee venant à diffoudre promptement
les parties contiguës de la g lace , & celles-
ci les parties voifines, toute la glace fe trouve bien-
tôttréduite en liqueur ; & le menftrue corrofif ayant
été mêlé avec le tout par le moyen de deux ou trois
fecouffes., tout le mélange s’échauffe quelquefois au
point que l’on ne fauroit tenir dans la main le vafe
qui le contient.
Il y a une grande variété dans la chaleur des différens
lieux & des différentes faifons. Les Natura-
liftes foûtiennent communément que la chaleur augmente
à mefure qu’on approche du centre de la terre
; mais cela n’eft point exactement vrai. En creu-
fant dans les. mines, puits, &c.,on trouve qu’à peu
de diftancè de la turface de la je r re , on commence
à fentir de la fraîcheur : un pë^.plus bas, on en fept
davantage ; & lorfqu’on eft parvenu au point où les
rayons du foleil ne peuvent répandre leur chaleur,
l ’eau s’y glace ou s’y maintient glacée ; c’eft cette
expérience qui a fait inventer les glacières, &c. Mais
quand on va encore plus bas, favoir à 40 ou 50 piés
de profondeur, on commence à fentir de la chaleur,
de forte que la glace s’y fond ; & plus on creufe au-
delà , plus la chaleur augmente jufqu’à ce qu’enfin la
refpiration y devient difficile, & que la lumière s’y
éteint.
C ’eft pourquoi quelques-uns ont recours à la fup-
pofition d’une malle de feu , placée au centre de la
terre, qu’ils regardent comme un foleil central, &
comme le grand principe de la génération, végétation
, nutrition, &c. des foffiles & des végétaux.
Voye{ Feu c e n t r a l , T erre, T remblement de
T erre , &c.
Mais M. Boyle qui a été lui - même au fond de
quelques mines, croit que ce degré de chaleur que
l’on lent dans ces mines, ou du moins dans quelques
unes , doit être attribué à la nature particulière
des minéraux qui s’y trouvent ; ce qu’il confirme
par l’exemple d’un minéral d’efpece vitriolique ,
qu’on tire de la terre en grande quantité en plufieurs
contrées d’Angleterre, & qui étant arrofé Amplement
d’eau commune,s’échauffe prefque au point de
prendre feu.
D’un autre co té, à mefure que l’on monte de hautes
montagnes l’air devient froid & perçant ; ainfi
les fommets des montagnes de Bohême nommées
Pico de Theide, le Pic de Ténériffe, & de plufieurs
autres montagnes, même de celles des climats les
plus chauds, fe trouvent toujours couverts & environnés
de neige & de glace que la chaleur du foleil
n’eft jamais capable de fondre. Sur quelques
montagnes du Pérou, au centre de la zone torride,
on ne trouve que de la glace. Les plantes crojffent
au pié de ces montagnes ; mais vers le fommet il
ji’y a point de végétaux qui puiffent croître à caufe
Tome I II.
du ftoid eXceffif. On attribue cet effet à la fubtilité
de 1 air dont les parties font trop écartées les unes
des autres a une fi grande hauteur, pour réfléchir
une affez grande quantité de rayons du foleil ; car la
chaleur du foleil refléchie par les particules de l ’air
échauffe beaucoup plus que la chaleur directe*
C haleur des différens climats de la terre. La diver-
fité de la chaleur des différens climats & des différentes
faifons, naît en grande partie des différens angles
fous lefquels les rayons du foleil viennent frapper la
furface de la terre. Voye^ C lim at , &c.
* On démontré en Mechanique qu’un corps qui en
frappe perpendiculairement un autre, agit avec toute
fa force ; & qu’un corps qui frappe obliquement
agit avec d’autant moins.de force, que fa direttion
s’éloigne davantage cle la perpendiculaire. Le feu
étant lancé en ligne direéle, doit fuivre la même loi
méchanique que les autres corps; & par conféquent
fpn aélion doit être mefurée par le finus de l’angle
d incidence : c’eft pourquoi le feu venant à frapper
un objet dans une dire&ion parallèle à cet objet, ne
produit point d’effet fenfible ; parce que l’angle d’incidence
étant nul, le rapport du finus de cet angle
au finus total eft comme zéro à un, c’eft-à-dire nul •
par conféquent le foleil n’a encore aucune chaleur \
lorfqu’il commence à répandre fes rayons fur la terre.
Foyéi Percussio n & C om po s it io n de M o u v e m
en t.
Un auteur Célébré a fait en conféquence de ce
principe, un calcul mathématique de l’effet du foleil
en différentes faifons & fous.différens climats. Voici
une idée de ce calcul, fur lequel nous ferons enfuite
quelques réflexions. M. Halley part de ce principe ,
que l’aftion fimple du foleil, comme toute autre im-
piilfion o.u pereuflion, a plus ou moins de force en
raifon des finus des angles d’incidence ; d’où il s’enfuit
que la force du foleil frappant la furface de la
terre à une hauteur quelconque, fera à la force perpendiculaire
des mêmes rayons, comme ce finus de
la hauteur du foleil eft au finus total.
De-là il conclut, que le tems pendant lequel le
foleil continue d eclairer la terre, étant pris pour
bafe, & les finus de la hauteur du foleil étant élevés
fur cette bafe comme des perpendiculaires; fi
on décrit une ligne courbe par les extrémités de ces
perpendiculaires, l’aire de c.ette courbe fera proportionnelle
à la fomme ou totalité dé la chaleur de
toùs les rayons du foleil dans cet efpace de tems. j
Il conclut de-là auffi que fous le pôle ar&ique , la
fomme de toute la chaleur d’un jour de folftice d’été
eft proportionnelle à un re&angle du finus de 23
ï degrés par la circonférence d’un cercle : or le finus
de 23 j degrés fait à-peu-près les ± du rayon ; &
les du rayon qui en .font le double, font à-peu-
près le finus de 53 degrés , dont le produit, par la
demi-circonférence ou par 12 heures, fera égal au
produit ci-deffus. D ’où il inféré que la chaleur polaire,
le jour du folftice, eft égale à celle du foleil,
échauffant l’horifon pendant 12 heures, à 53 degrés
conftans d’élévation. Comme il eft de la nature de
la chaleur de refter dans le fujet après la retraite du
corps qui l’a occafionnée, & fur - tout de continuer
dans l’air , l’abfence de 12 heures que fait le foleil
fous l’équateur, ne diminue que fort peu la chaleur
ou le mouvement imprimé par l’a&ion précédente
de fes rayons : mais fous le pôle, l’abfence de fix
mois que fait le foleil, y laiffe régner un froid extrême
; de forte que l’air y étant comme gelé & couvert
de nuages épais & de brouillards continuels,
les rayons du foleil ne peuvent produire fur cet air
aucun effet fenfible avant que cet aftre fe foit rapproché
confidérablement du pôle.
A quoi il faut ajoûter, que les différens degrés de
chaud & de froid qu’il fait eu différens endroits de
D ij