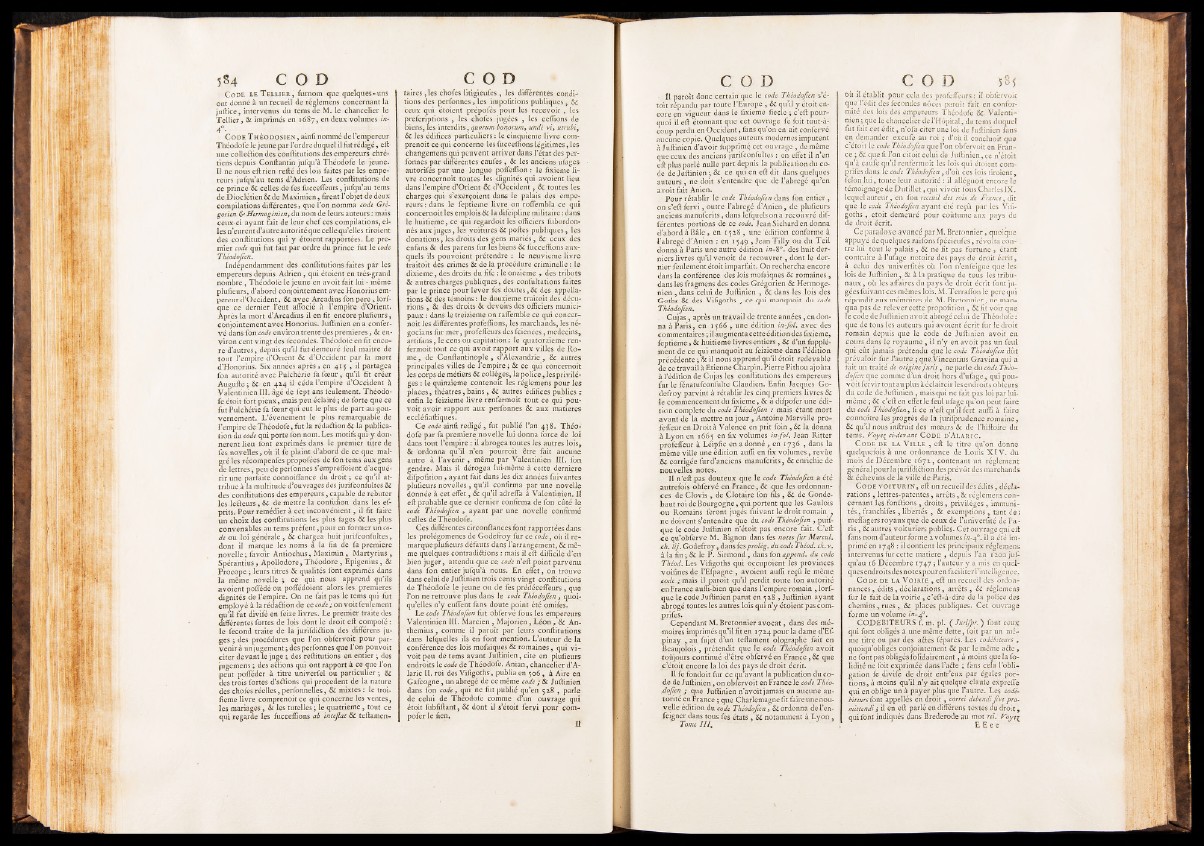
C ode l e T el lier, furnom que quelques-uns
ont donné à un recueil de réglemens concernant la
juftice, intervenus du tems de M. le chancelier le
Tellier * & imprimés en 1687, en deux volumes in-
4 °* . , ;
C ode T héodosien , ainfi nomme de 1 empereur
Théodofe le jeune par l’ordre duquel il fut rédigé, eft
une collettion des conftitutions des empereurs chrétiens
depuis Conftantin jufqu’à Théodofe le jeune.
Il ne nous eft rien relié des lois faites par les empereurs
jufqu’au tems d’Adrien. Les conftitutions de
ce prince & celles de fes fucceffeurs, jufqu’au tems
de Dioclétien & de Maximien, firent l’objet de deux
compilations différentes, que l’on nomma code Grégorien
& Hermogénien, du nom de leurs auteurs : mais
ceux-ci ayant fait de leur chef ces compilations, el-t
les n’eurent d’autre autorité que celle qu’elles tiroient
des conftitutions qui y étoient rapportées. Le premier
code qui fut fait par ordre du prince fut le code
Théodojîen.
Indépendamment des conftitutions faites par les
empereurs depuis Adrien, qui étoient en très-grand
nombre, Théodofe le jeune en avoit fait lui - même
plufieurs, d’abord conjointement avec Honoriusempereur
d’Occident, & avec Arcadius fon pere, lorf-
que ce dernier l’eut affocié à l’empire d’Orient.
Après la mort d’Arcadius il en fit encore plufieurs,
conjointement avec Honorius. Juftinien en a confer-
v é dans fon code environ trente des premières, & environ
cent vingt des fécondés. Théodofe en fit encore
d’autres, depuis qu’il fut demeuré feul maître de
tout l’empire d’Orient &, d’Occident par la mort
d’Honorius. Six années après, en 415 , il partagea
fon autorité avec Pulchérie fa foeu r, qu’il fit créer
Augufte ; & en 414 il céda l ’empire d’Occident à
Valentinien III. âgé de fept ans feulement. Théodofe
étoit fort p ieux, mais peu éclairé ; de forte que ce
fut Pulchérie fa foeur qui eut le plus de part au gouvernement.
L’évenement le plus remarquable de
l ’empire de Théodofe, fut la rédaftion & la publication
du code qui porte fon nom. Les motifs qui y donnèrent
lieu font exprimés dans le premier titre de
fes novelles, ou il fe plaint d’abord de ce que malgré
les récompenfes propofées de fon tems aux gens
de lettres, peu de perfonnes s’empreffoient d’acquérir
une parfaite connoiffance du droit ; ce qu’il attribue
à la multitude d’ouvrages des jurifconfultes &
des conftitutions des empereurs, capable de rebuter
les leâeurs, & de mettre la confufion dans les ef-
prits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire
un choix des conftitutions les plus lages & les plus
convenables au tems préfent ,pour en former un code
ou loi générale , & chargea huit jurifconfultes,
dont il marque les noms à la fin de fa première
novelle; favoir Antiochus, Maximin , Martyrius ,
Spérantius, Apollodore, Théodore , Epigenius, &
Procope ; leurs titres & qualités font exprimés dans
la même novelle ; ce qui nous apprend qu’ils
avoient poffédé ou poffédoient alors les. premières
dignités de l’empire. On ne fait pas le tems qui fut
employé à la rédaÛion de ce code ; on voit feulement
qu’il fut divifé en feize livres. Le premier traite des
différentes fortes de lois dont le droit eft compofé :
le fécond traite de la jurifdiélion des différens juges
; des procédures que l’on obfervoit pour parvenir
à un jugement ; des perfonnes que l’on pou voit
citer devant le juge ; des reftitutions en entier ; des
jugemens ; des a&ions qui ont rapport à ce que l’on
peut pofféder à titre univerfel ou particulier ; &
des trois fortes d’attions qui procèdent de la nature
des chofes réelles, perfonnelles, & mixtes : le troi-
lieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes,
les mariages, & les tutelles ; le quatrième, tout ce
qui regarde les fucceffions ab intefiat & teftamentaires,
les chofes litigieufes , les différentes conditions
des perfonnes, les impofitions publiques, &c
ceux qui étoient prépofés pour les recevoir , les
preferiptions , les chofes jugées , les cefîions de
biens, les interdits, quorum bonorum, undè vi, utrubi9
fte. les édifices particuliers : le cinquième livre comprenoit
ce qui concerne les fucceffions légitimes, les
changemens qui peuvent arriver dans l’état des perfonnes
par différentes caufes , & les anciens ufages
autorifés par une longue pofleffion : le fixieme livre
concernoit toutes les dignités qui avoient lieu
dans l’empire d’Orient &C d’Occident, & toutes les
charges qui s’exerçoient dans le palais des empereurs
: dans le feptieme livre on roffembla ce qui
concernoit les emplois & la difeipline militaire : dans
le huitième, ce qui regardoit les officiers fubordon-
nés aux juges, les voitures & polies publiques, les
donations, les droits des gens mariés, & ceux des
enfans & des parens fur les biens ÔC fucceffions auxquels
ils pouvoient prétendre : le neuvième livre
traitoit des crimes & de la procédure criminelle : le
dixième, des droits du fife : le onzième , des tributs
& autres charges publiques, des confultations faites
par le prince pour lever fes doutes,& des appellations
& des témoins : le douzième traitoit des décurions
, & des droits & devoirs des officiers municipaux
: dans le treizième on raffemble ce qui concernoit
les différentes profeffions, les marchands, les né-
gocians fur mer, profeffeurs des fciences., médecins,
artifans, le cens ou capitation : le quatorzième ren-
fermoit tout ce qui avoit rapport aux villes de Rome
, de Conftantinople , d’Alexandrie , & autres
principales villes de l’empire ; & ce qui concernoit
les corps de métiers & collèges, la police, les privilèges
: le quinzième contenoit les réglemens pour les
places, théâtres, bains, & autres édifices publics r
enfin le feizieme livre renférmoit tout ce qui pou-
voit avoir rapport aux perfonnes & aux matières
eccléfiaftiques.
Ce code ainfi rédigé , fut publié l’an 438. Théodofe
par fa première novelle lui donna force de loi
dans tout l’empire : il abrogea toutes les autres lois,
& ordonna qu’il n’en pourroit être fait aucune
autre à l ’avenir , même par Valentinien III. fon
gendre. Mais il dérogea lui-même à cette derniere
difpofition , ayant fait dans les dix années fuivantes
plufieurs novelles , qu’il confirma par une novelle
donnée à cet effet, & qu’il adrefla à Valentinien. Il
eft probable que ce dernier confirma de fon côté le
code Théodojîen , ayant par une novelle confirmé
celles de Théodofe.
Ces différentes circonftances font rapportées dans
les prolégomènes de Godefroy fur ce code, oii il remarque
plufieurs défauts dans l’arrangement, & même
quelques contradictions : mais il eft difficile d’en
bien juger, attendu que ce code n’eft point parvenu
dans fon entier jufqu’à nous. En effet, on trouve
dans celui de Juftinien trois cents vingt conftitutions
de Théodofe le jeune ou de fes prédéceffeurs , que
l’on ne retrouve plus dans le code Théodojîen, quoiqu’elles
n’y euffent fans doute point été omifes.
Le code Théodojîen fut obfervé fous les empereurs
Valentinien III. Marcien , Majorien, Léon , & An-
themius, comme il paroît par leurs conftitutions
dans lefquelles ils en font mention. L’auteur de la
conférence des lois mofaïques & romaines, qui vi-
voit peu dé tems avant Juftinien, cite en plufieurs
endroits le code de Théodofe. Anian, chancelier d’A-
laric IL roi des Vifigoths, publia en 506, à Aire en
Gafcogne, un abrégé de ce même code ; & Juftinien
dans fon code, qui ne fut publié qu’en 528 , parle
de celui de Théodofe comme d’un ouvrage qui
étoit fubfiftant, ôc dont il s’étoit fervi pour com-
pofer le fien,
II
Il pâroît donc certain'que le code Théodojîen s*é-.
toit répandu par toute l ’Europe , & qu’il y étoit encore
en vigueur dans le fixieme fiecle ; c’eft pourquoi
il eft étonnant que cet ouvrage fe foit tout-à-
coup perdu en Occident, fans qu’on en ait confervé
aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent
à Juftinien d’avoir fupprimé cet ouvrage , de même
que ceux des anciens jurifconfultes : en effet il n’en
eft plus parlé nulle part depuis la publication du code
de Juftinien ; & ce qui en eft dit dans quelques
auteurs, ne doit s’entendre que de l’abrégé qu’en
avoit fait Anien.
Pour rétablir le code Théodojîen dans fon entier ,
on s’eft fe rv i, outre l’abrégé d’Anien, de plufieurs
anciens manuferits, dans lefquelsona recouvré différentes
portions de ce code. Jean Sichard en donna
d’abord à B â le, en 1528 , une'édition conforme à
l’abrégé d’Anien : en 1549 , Jean T illy o u du Teil
donna à Paris une autre édition in-2°. des huit derniers
livres qu’il venoit de recouvrer , dont le dernier
feulement étoit imparfait. On rechercha encore
dans la conférence des lois mofaïques & romaines ,
dans les fragmens des codes Grégorien & Hermoge-
nien , dans celui de Juftinien , & dans les lois des
Goths & des Vifigoths , ce qui manquoit du code
Théodojîen.
Cu jas, après un travail de trente années, en donna
à Paris, en 1566 , une édition in-fol. avec des
commentaires ; il augmenta cette édition des fixieme,
feptieme, & huitième livres entiers , & d’un fupplé-
ment de ce qui manquoit au feizieme dans l’édition
précédente ; & il nous apprend qu’il étoit redevable
de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajouta
à l’édition de Cujas les conftitutions des empereurs
fur le fénatufconfulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy
parvint à rétablir les cinq premiers livres &
le commencement du fixieme, & à difpofer une édition
complété du code Théodojîen : mais étant mort
avant de la mettre au jour , Antoine Marville pro-,
feffeur en Droit à Valence en prit foin , & la donna
à Lyon en 1665 en fix volumes in-fol. Jean Ritter
pro feffeur à Léipfic en adonné , en 1736 , dans la
même ville une édition auffi en fix volumes, revûe
& corrigée fur d’anciens manuferits, & enrichie de
nouvelles notes.
Il n’eft pas douteux que le code Théodojîen a été
autrefois obfervé en France, & que les ordonnances
de Clovis , de Çlotaire fon fils , & de Gonde-
haut roi de Bourgogne, qui portent que fes Gaulois
o u Romains feront juges fuivant le droit romain ,
ne doivent s’entendre que du code Théodojîen , puif-
que le code Juftinien n’étoit pas encore fait. C ’eft
ce qu’obferve M. Bignon dans fes notes fur Mar cul.
.ch. lij. Godefroy, dans fes prolég. du code Théod. ch. v.
à la fin ; & le P. Sirmond, dans fon append. du code
Théod. Les Vifigoths qui occupoient les provinces
.voifines de l’Efpagne , avoient auffi reçu le même
.code ; mais il paroît qu’il perdit toute fon autorité
en France auffi-bien que dans l’empire romain , lorf-
que le code Juftinien parut en 528 , Juftinien ayant
abrogé toutes les autres lois qui n’y étoient pas com-
prifes.
Cependant M. Bretonnier a voca t, dans des mémoires
imprimés qu’il fit en 1724 pour la dame d’Ef-
pinay , au fujet d’un teftament olographe fait en
Beaujolois, prétendit que le code Théodojîen avoit
toûjours continué d’être obfervé en France, & que
c ’étoit encore la loi des pays de droit écrit.
Il fe fondoit fur ce qu’avant la publication du code
de Juftinien, on oblervoit en France le code Théo-
dojîen ; que Juftinien n’a voit jamais eu aucune autorité
en France ; que Charlemagne fit faire une nouvelle
édition du code Théodojîen , & ordonna del’en-
feigner dans tous fes états , ôc notamment à L y on ,
Tom e I II,
oit il établit pour cela des profefteurs : il obfervoit
que l’édit des fécondés noces paroît fait en conformité
des lois dés empereurs Théodofe & . Valentinien
; que le chancelier de l’Hôpital, du tems duquel
fut fait cet éd it, n’ofa citer une loi de Juftinien lans
en demander exeufe au roi ; d’où il concluoit que
c’étoit le code Théodojîen que l’on obfervoit en France
; & que fi l’on citoit celui de Juftinien, ce n’étoit
qu’à caüfe qu’il renfermoit les lois qui étoient com-
prifes dans le code Théodojîen, d’où ces lois tiroient,
félon lui, toute leur autorité : il alléguoit encore le
témoignage de Dutillet, qui vivoit fous Charles IX.
lequel auteur, en fon receuil des rois de France, dit
que le code Théodojîen ayant été reçu par les Vifigoths
, etoit demeuré pour coutume aux pays de
de droit écrit.
Ce paradoxe avancé parM. Bretonnier, quoique
appuyé de quelques raifons fpécieufes, révolta con- .
tre lui tout le palais , & ne fit pas fortune , étant
contraire à l’uiage notoire des pays de droit é crit,
à celui des univerfités où l’on n’enfeigne que les
lois de Juftinien, & à la pratique de tous les tribunaux
, où les affaires du pays de droit écrit font jugées
fuivant ces mêmes lois. M. Tcrraffon le pere qui
répondit aux mémoires .de M. Bretonnier, ne manqua
pas de relever cette propofition , & f it voir que
le code de Juftinien avoit abrogé celui de Théodofe:
que de tous les auteurs qui avoient écrit fur le droit
romain depuis que le code dé Juftinien avoit eu
cours dans le royaume , i l n’y en avoit pas un feul
qui eût jamais prétendu que le code Théodojîen dut
prévaloir fur l’autre ; que.Vincentius Gravina qui a
fait un traité de origine ju ris, ne parle du code Théo-
dojîen que comme d’un droit hors d’ufage, qui pou-
voit fervir topt au plus à éclaircir les endroits obfcurs
du code de Juftinien , mais qui ne fait pas, loi par lui-
même ; & c’eft en effet le feul ufage qu’on peut faire
du code Théodojîen, fi ce n’eft qu’il fert auffi à faire
connoître les progrès de la jurifprudence romaine,
& qu’il nous inftruit des moeurs & de l’hiftoire du
tems. Voye%_ ci-devant C ode d’A l a r ic .
C ode de l a V ille , eft le titre qu’on donne
quelquefois à une ordonnance de Louis X IV . du
mois de Décembre 1672, contenant un réglement
général pour la jurifdidtion des prévôt des marchands
& échevins de la ville de Paris.
C ode v o it ü r in , eft im recueil des édits, déclarations
, lettres-patentes, arrêts, & réglemens concernant
lesifonftio'ns , droits, privilèges , immunités
, franchifes , libertés , & exemptions , tant de ;
meffagers royaux que de ceux de l’univerfité de Paris
, & autres; voituriers, publics. Cet ouvrage qui eft
fans nom d’auteur forme 2 volumes ï/z-40. il a été imprimé
en 1748 : il contient les principaux réglemens
intervenus fur cette matière , depuis l’an 1200 ju fqu’au
16 Décembre 1747 ; l’auteur y a mis en quelques
endroits des notes pour en faciliter l’intelligence.
C ode de l a V o irie , eft un recueil des ordonnances
, édits, déclarations, arrêts , & réglemens
fur le fait de la voirie , c ’eft-à-dire de la policé des
chemins,. rues , & places publiques. Cet ouvrage
forme un volume in-40.
CODÉBITEURS f. m. pl. ( Jurifpr. ) font ceux
qui font obligés à une même dette, foit par un même
titre, ou par des actes féparés. Les codébiteurs ,
quoiqu’obligés conjointement & par le même a été ,
ne font pas obligés folidairement, à moins quelafo-
lidité ne foit exprimée dans l’aéle ; fans cela l ’obligation
fe divife de droit éntr’eux par égales portions,
à moins qu’il n’y ait quelque claute expreffe
qui en oblige un à payer plus que l’autre. Les codébiteurs
font appellés en droit , correi debendi jive pro-
mittendi ; il en eft parlé en différens textes du droit,
qui font indiqués dans Brederode au mot rei. Voye\